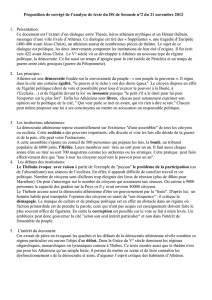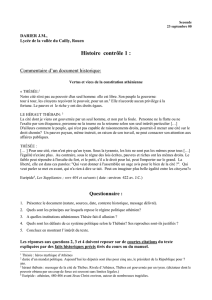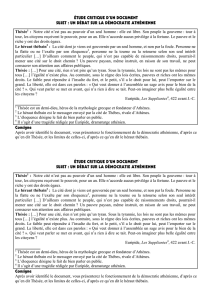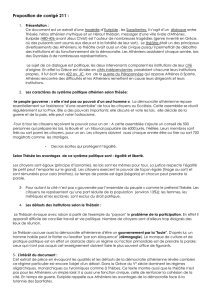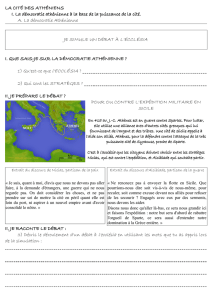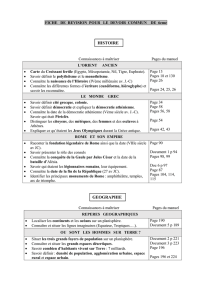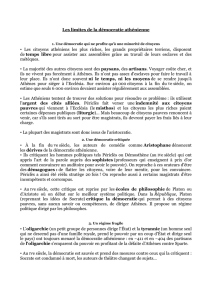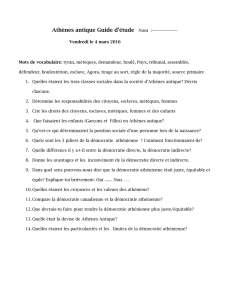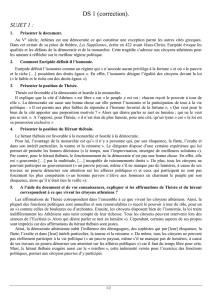CORRIGE ETUDE DE DOC

CORRIGÉ - ÉTUDE CRITIQUE D’UN DOCUMENT
SUJET Š UN DÉBAT SUR LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE
Introduction
Le texte qui nous est proposé est un extrait d’une pièce de théâtre, plus précisément une tragédie, rédigée
par le dramaturge athénien Euripide. Il a vécu au V
ème
siècle avant J.-C., au moment de l’apogée de la
démocratie athénienne. Ce passage, extrait de la pièce intitulée Les Suppliantes, date de 422 avant J.-C. : c’est
une période où Athènes est en pleine guerre du Péloponnèse contre Sparte. Il s’agit donc plutôt d’une période
de crise pour la cité. Dans cet extrait, un débat oppose deux personnages, Thésée, demi-dieu considéré comme
le fondateur d’Athènes dans la mythologie grecque, et un messager issu de la cité de Thèbes qui était
l’ancienne rivale d’Athènes (avant Sparte). Ici, le héraut thébain est une personnification de Sparte. Thésée
présente ici les bienfaits de la démocratie athénienne alors que le héraut thébain en souligne les limites, en
vantant les mérites de la cité dont il est originaire.
Après avoir mis en évidence le fonctionnement de la démocratie athénienne, d’après les dires de Thésée
(I), on montrera quelles critiques le héraut thébain formule contre elle (II).
Développement
Citation Reformulation Explication
1. Le fonctionnement de la démocratie athénienne selon Thésée
« Notre cité n’est pas au pouvoir d’un
seul homme : elle est libre » (ligne 1)
« Tour à tour, les citoyens reçoivent le
pouvoir, pour un an » (lignes 1-2)
« Le pauvre et le riche y ont des droits
égaux » (lignes 2-3) ou « Riches et
pauvres ont les mêmes droits » (lignes
10-11)
« Qui veut parler se met en avant, qui
n’a rien à dire se tait » (lignes 12-13)
Pas de reformulation
nécessaire ici
Pas de reformulation
nécessaire ici
Ici, les adjectifs
« riche » et « pauvre »
ne font référence
qu’aux citoyens.
Pas de reformulation
nécessaire ici
- La démocratie est le pouvoir exercé
par les citoyens qui votent les lois,
élisent ou tirent au sort les dirigeants de
l’armée et de l’État.
- Les fonctions exercées par les citoyens
sont renouvelées chaque année par vote
ou tirage au sort : c’est le cas de
Périclès, élu stratège 15 fois d’affilée.
- Tous les citoyens, qu’ils soient riches
ou pauvres ont les mêmes droits
(prendre la parole à l’Ecclésia, voter les
lois, voter pour les dirigeants de la cité
ou de l’armée, se présenter aux
élections, se marier, posséder un bien et
le transmettre à ses héritiers)
- Dans la démocratie athénienne, ce sont
les citoyens qui proposent les lois et en
débattent à l’Ecclésia.
2. Les limites de la démocratie athénienne selon le héraut thébain
« Personne ne la flatte ou ne l’exalte
par son éloquence, personne ne la
tourne ou la retourne selon son intérêt
particulier » (lignes 4-6)
« D’ailleurs, comment le peuple, qui
n’est pas capable de raisonnements
droits, pourrait-il mener une cité sur le
droit chemin ? » (lignes 6-7)
« Un pauvre paysan, même instruit, en
raison de son travail, ne peut consacrer
son attention aux affaires publiques »
(lignes 7-8)
Ici, l’article « la »
désigne la foule, c’est-
à-dire l’ensemble des
citoyens (= démos)
Ici, les
« raisonnements
droits » désignent
l’intelligence des
citoyens
Pas de reformulation
nécessaire ici
- La démocratie athénienne permet
l’accès au pouvoir de citoyens
facilement manipulables par de « beaux
parleurs », qu’on appelle à l’époque les
démagogues.
- La démocratie athénienne permet
l’accès de tous les citoyens aux prises
de décisions et au pouvoir, y compris
ceux qui ont un faible niveau
d’instruction et ne sont donc pas
capables de gérer la cité.
- Certains citoyens se désintéressent de
la vie politique de la cité (parce qu’ils
n’ont pas le temps ou parce qu’ils vivent
loin du centre de la cité) : c’est la raison
pour laquelle Athènes a mis en place le
misthos (une indemnité financière pour
inciter à la participation des citoyens) en
450 avant J.-.C.
1
/
1
100%