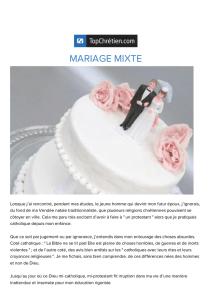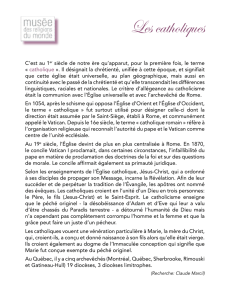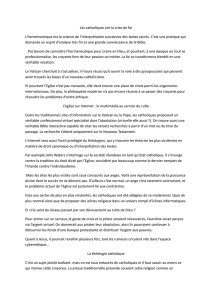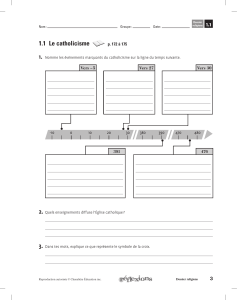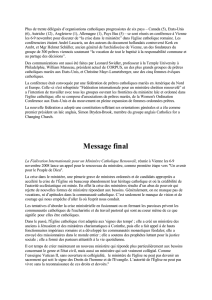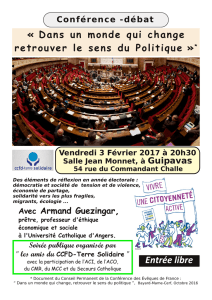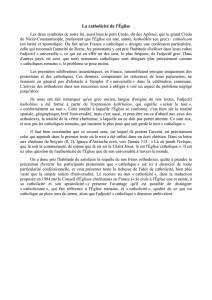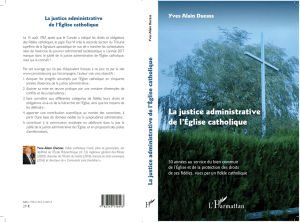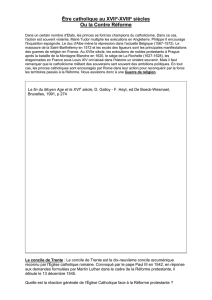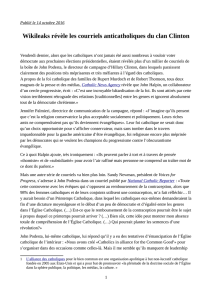L`église catholique une présenceréelleet méconnue

dossier
11
/ mars 2013 / n°429
Par Mgr Claude Dagens
Évêque d’Angoulême, de l’Académie
française
« Notre combat est
indivisible : nous nous
savons appelés à manifester,
à promouvoir, à défendre la
dignité de toute personne
humaine, et d’abord de
celles qui sont confrontées à
des situations de détresse ou
de peur, de celles qui sont
l’objet de discriminations
scandaleuses et intolérables,
de celles que l’on manipule
comme des pions ou comme
des objets, en fonction des
impératifs exclusifs de la
rentabilité financière ou
technique, ou de celles
dont les activités, aussi bien
économiques que sexuelles,
ne sont déterminées que
par les lois du marché. »
L’Église catholique qui est en France,
en ce début du XXIe siècle, on croit la
connaître, parce qu’elle fait partie de notre
histoire commune. Voyez la cathédrale de
Notre-Dame de Paris, qui est là depuis
850 ans, avec sa façade royale et ses
neuf nouvelles cloches, et n’oubliez pas
toutes les célébrations nationales qui s’y
sont déroulées, parmi lesquelles on peut
mentionner le Te Deum de la victoire, le
26 août 1944, devenu un Magnificat, et
les hommages solennels
aux présidents de la
Ve République, Charles de
Gaulle, Georges Pompidou
et François Mitterrand,
en attendant les autres !
Et aux monuments de
Paris, il faudrait ajouter
des abbayes illustres,
d’autres cathédrales
superbes, comme celle
d’Angoulême, qui est
romane, et des hauts lieux
de prière et de rassemblement, de Reims à
Lourdes et de Rouen à Marseille !
Par-delà les images d’Épinal
Mais cette perception exclusivement
patrimoniale de la présence actuelle de
l’Église catholique en France peut être
dangereuse. Car elle vient alimenter des
représentations collectives qui ont la vie
dure et qui ne sont pas conformes à la
réalité. On dirait parfois que la mémoire
du catholicisme français s’est arrêtée
aux débuts de la IIIe République ou aux
lendemains de la loi de Séparation entre
l’Église et l’État, précisément à ces heures
éprouvantes où s’exacerbait la guerre des
deux France, la catholique et la laïque, la
monarchiste et la républicaine. Quelle erreur
et quelle sottise !
Car il faut dépasser résolument ces images
d’Épinal, à partir desquelles on conçoit la
religion catholique comme une menace
latente et même déclarée à la laïcité de
l’État. J’ai écouté avec attention le discours
par lequel notre ministre de la Justice,
Mme Taubira, a ouvert à l’Assemblée
nationale, le 29 janvier 2013, la discussion
sur le projet de loi qui ouvre le mariage et
l’adoption aux couples de
même sexe. Ce discours
est remarquablement
pensé : il montre comment
l’institution du mariage
civil est une conquête de
la Révolution en 1791, et
plus tard, en 1884, de la
République laïque. Vive
donc le mariage civil à
l’intérieur de notre société !
Mais pourquoi voudrait-
on que le sacrement du
mariage soit l’ennemi du mariage civil,
comme si l’on ignorait qu’à partir du Haut
Moyen Âge (que j’ai quelques raisons de
connaître), c’est l’Église catholique qui a
défendu le consentement mutuel et libre
des époux, contre toutes les traditions
qui ne concevaient l’union de l’homme
et de la femme que comme un système
d’arrangements tribaux, familiaux
et financiers ! Et qui pourrait nier qu’à
l’heure actuelle, l’Église catholique est
la seule institution, en France, qui veille
effectivement à préparer au mariage ceux
et celles qui le choisissent, et il s’agit,
en même temps, du mariage civil et du
mariage religieux ?
De grâce, Madame le Ministre (comme on
L’église catholique
dans la société française :
une présence réelle et méconnue
Il faut dépasser ces
images d’Épinal, à
partir desquelles on
conçoit la religion
catholique comme
une menace latente
et même déclarée à
la laïcité de l’État

Les religions et le monde moderne
dossier
12 / mars 2013 / n°429
dit à l’Académie française), ne réveillons pas
les vieux réflexes guerriers qui sommeillent
dans notre inconscient collectif et demandez
à votre collègue Manuel Valls pourquoi il
était présent l’autre jour à l’intérieur de la
cathédrale Notre-Dame de Paris, pour la
messe qui inaugurait son 850e anniversaire,
et ensuite à l’extérieur, pour prononcer un
discours également remarquable sur les
relations actuelles entre l’Église et l’État,
fondées sur la séparation, la différence
et le respect mutuel ! Et le respect inclut
et exige la connaissance des réalités, et
en particulier de tout ce qui concerne la
présence actuelle de l’Église catholique à
l’intérieur de la société française.
À l’intérieur de la société
française
Je sais bien : un certain nombre de
catholiques rêvent encore ou à nouveau
de camper en dehors de la cité commune,
pour mieux critiquer ses métamorphoses et
pour être ainsi des spectateurs prêts à tous
les combats qu’ils jugeraient nécessaires.
À moins que – mais le résultat serait le
même – ils ne s’imaginent être enfermés
dans une citadelle assiégée en attendant
l’assaut des barbares ! La posture serait la
même, guerrière, avec un mélange d’actions
défensives et offensives.
Quelle stupidité ! Comme si nous n’étions
pas tous et toutes des citoyens français, tout
en étant des membres de l’Église catholique,
et si nous ne devions pas souffrir ensemble,
avec ceux et celles qui ne croient pas au
ciel de Dieu, à cause de tout ce qui tend à
déshumaniser et à déréguler notre société
si fragile, et si dure en même temps, avec
tant de phénomènes de fragmentations, de
séparations, de violences parfois.
Ce n’est donc pas l’heure de nous situer
à l’extérieur de notre société. D’autant
plus que le qualificatif de catholique,
parfois si déprécié aux yeux mêmes de
certains catholiques, inclut une ouverture
primordiale à l’universel, ou plus exactement
une participation à l’ouverture même du
Dieu vivant, le Père de Jésus, quand il vient
« chercher et sauver ce qui était perdu »
(Luc 19,10).
Et c’est à la lumière de ce qualificatif
respectable et non pas dangereux qu’il faut
comprendre le combat intransigeant que
l’Église catholique pratique et pratiquera en
France pour être « l’avocate de l’humanité
de toute personne humaine », comme disait
jadis le cardinal Lustiger. À commencer
par les plus fragiles, ceux et celles qui ne
crient pas, qui ne manifestent pas, mais
qui s’enferment dans leur solitude, plus
ou moins liée à l’aggravation si réelle de la
pauvreté, aux conséquences du chômage,
aux déchirures du tissu
social dans les grands
ensembles urbains et aussi
dans des zones rurales en
voie de désertification.
J’aime le redire ici avec
insistance, parce qu’il
me semble que l’Église
catholique est parfois
maladroite ou timide pour
le faire entendre comme
il faudrait. Le plus grave,
c’est évidemment la crise économique dont
les effets sont maintenant de plus en plus
sensibles et l’un de ces effets est la perte
ou la dissolution de l’espoir, parce que le
temps n’est plus porteur de promesses,
comme il semblait l’être au temps des
Trente glorieuses, que beaucoup de jeunes
ne savent pas quel métier ils pourront
exercer demain après leurs études et que
beaucoup de parents ou de grands-parents
se demandent souvent comment ils pourront
nourrir convenablement leurs enfants le soir,
après les repas pris à la cantine, si encore
ils ont les moyens de payer la cantine,
aussi bien dans les établissements de
l’enseignement catholique que dans ceux
de l’enseignement public.
Beaucoup de catholiques sont conscients
de ces réalités qui atteignent des personnes
concrètes. Et ils agissent discrètement
pour faire face à des situations de misère,
à travers de multiples associations
d’obédience catholique ou laïque. Et, bien
entendu, ils n’oublient pas la parabole du
Bon Samaritain, que le pape Benoît XVI
proposait comme modèle de son message
pour le Carême de cette année 2013. Et
tous les diocèses de France se préparent
actuellement à ce que l’on appelle dans
notre jargon l’opération Diaconia 2013,
qui a pour but de faire apparaître que la
charité est constitutive, autant que la foi,
de l’identité catholique, comme au temps
de saint Martin, de saint Vincent de Paul
ou du bienheureux Frédéric Ozanam.
Oui, notre combat est indivisible : nous nous
savons appelés à manifester, à promouvoir,
à défendre la dignité de toute personne
humaine, et d’abord de celles qui sont
confrontées à des situations de détresse
ou de peur, de celles qui sont l’objet de
discriminations scandaleuses et intolérables,
de celles que l’on manipule comme des
pions ou comme des objets, en fonction
des impératifs exclusifs
de la rentabilité financière
ou technique, ou de
celles dont les activités,
aussi bien économiques
que sexuelles, ne sont
déterminées que par les
lois du marché.
Et en agissant ainsi, nous
ne nous prenons pas pour
la conscience critique d’un
monde sans conscience.
Nous tenons simplement, comme l’avait
affirmé en 1996 la Lettre aux catholiques
de France (que j’ai bien des raisons de
connaître par le cœur puisque je l’avais
conçue et rédigée avec des amis), « à être
reconnus, nous catholiques en France, non
seulement comme des héritiers, solidaires
d’une histoire nationale et religieuse, mais
aussi comme des citoyens qui prennent part
à la vie actuelle de la société française, qui
en respectent la laïcité constitutive et qui
désirent y manifester la vitalité de leur foi. »
(Lettre aux catholiques de France, Paris,
éditions du Cerf, 1996, p. 28).
La vitalité de la foi et de la
charité
Au sujet de cette vitalité de notre foi, il y
aurait beaucoup à dire, et en particulier
ceci, qui est fondamental : en deçà ou par-
delà l’affaiblissement évident de beaucoup
d’institutions catholiques (lié à la baisse
de la pratique religieuse, au vieillissement
des prêtres, à la pénurie des vocations), se
produit un renouvellement en profondeur du
tissu de l’Église catholique en France. Il n’y
a pas seulement des églises fermées. Il y
a beaucoup d’églises ouvertes, notamment
les 410 églises romanes du diocèse
d’Angoulême, parce que des élus locaux,
des municipalités comprennent que ces
bâtiments ne sont pas comme les autres,
et que des catholiques ont à cœur non
seulement de les entretenir, mais d’y prier
et d’y accueillir des pèlerins de passage.
Et surtout, dans un climat général
de désenchantement et parfois de
Beaucoup de
catholiques sont
conscients de
ces réalités qui
atteignent des
personnes concrètes

dossier
13
/ mars 2013 / n°429
désespérance, on peut percevoir parmi
nous de réelles attentes spirituelles, que
des jeunes et des adultes ne savent pas
exprimer avec les mots de la Tradition,
mais dont nous sommes témoins, si nous
le voulons bien.
Autrement dit, la sécu-
larisation n’entraîne
pas automatiquement
l’effacement des traces et
des mémoires catholiques
dans notre pays. Elle
oblige les catholiques et
toutes les communautés
chrétiennes à se réveiller,
à se convertir au mystère
du Dieu vivant qui fait
alliance avec nous et à se manifester
autrement dans notre société démocratique
et pluraliste : non pas comme des groupes
d’influence ou de pression, mais comme des
sources de vie sensée, de compréhension
du monde, d’engagements tenaces et de
réel don de soi.
J’entends à ce sujet les avertissements
raisonnables de Marcel Gauchet beaucoup
plus que les analyses désespérantes de
Danièle Hervieu-Léger : « Les institutions
religieuses partent avec l’avantage d’une
position privilégiée. Dans
un monde détraditionalisé,
elles sont les seules
institutions à entretenir un
rapport direct et constitutif
avec le passé, à côté des
musées et des institutions
patrimoniales en général.
Sauf que les musées et les
institutions de mémoire
ne font que conserver,
alors que les institutions
religieuses font vivre. Elles perpétuent,
entretiennent, actualisent, enrichissent un
immuable message venu du fond des âges.
Elles sont, dans un monde détraditionalisé,
le seul bastion de tradition qui surnage,
parce que précisément cette tradition ne
se transmet pas seulement par la coutume
et l’héritage, mais passe par l’explicitation
du Livre, l’exposition de la foi et son
enseignement. Elles forment le seul site
où la notion de tradition conserve son sens
plein et actuel. Cette singularité les désigne
pour une fonction plus vaste à l’échelle
de la collectivité : celle de gardienne et de
passeuse de l’histoire profonde où nous
avons nos origines. » (Marcel Gauchet, Un
Monde désenchanté ?, Paris, éditions de
l’Atelier, 2004, p. 246.)
Je n’aime pas du tout l’image du bastion.
Je crois plutôt qu’il faut raser les bastions,
comme l’écrivait dans les années 1960 le
grand théologien suisse Urs von Balthasar.
J’aime beaucoup plus les images de
l’Évangile, celles par lesquelles Jésus
appelle ses disciples à être inlassablement
« sel de la terre et lumière du monde »
(cf. Matthieu 5,13-14). C’est cette
dynamique de présence et d’inscription que
l’Église catholique est appelée à pratiquer
dans la société française, en ces temps
d’incertitude. ■
J’aime beaucoup
plus les images de
l’Évangile, celles
par lesquelles Jésus
appelle ses disciples
à être inlassablement
« sel de la terre et
lumière du monde »
1
/
3
100%