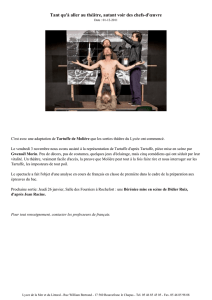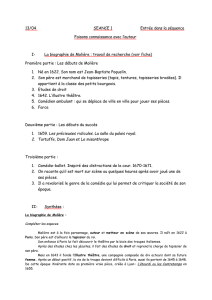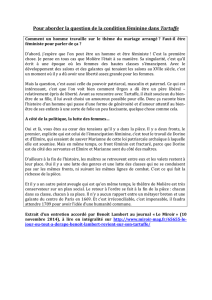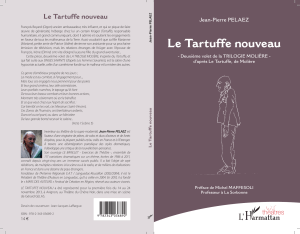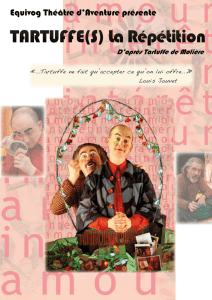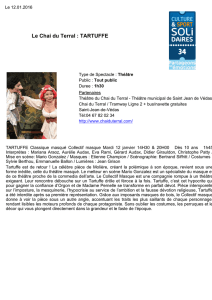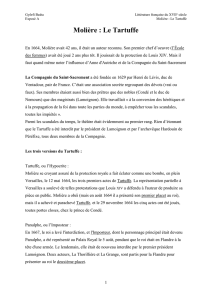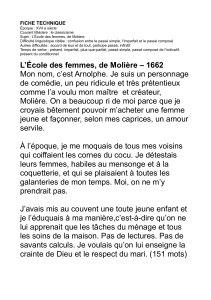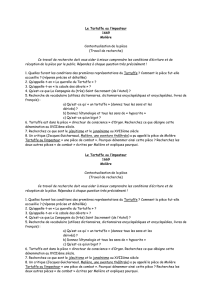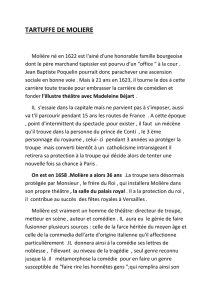Dossier de presse tartuffe


LE TARTUFFE
DE MOLIERE
Mise en scène Jean-Vincent BRISA
Costumes Marion MERCIER
Eclairages Julien MENUT
Avec
TARTUFFE : Jean-Marc GALERA
ORGON : Pierre DAVID-CAVAZ
DORINE : Nicole VAUTIER
MADAME PERNELLE : Danièle KLEIN
CLÉANTE : en cours
ELMIRE : en cours
DAMIS : en cours
MARIANE : en cours
VALÈRE : en cours
MONSIEUR LOYAL : en cours
UN EXEMPT : en cours
FLIPOTE : en cours
Création à l’AGORA de Saint-Ismier
Répétitions août et octobre 2016
Représentations début novembre 2016
Ce spectacle est proposé en tournée toute la saison 2016/2017
PRODUCTION
EN SCENE ET AILLEURS - Compagnie théâtrale
Mairie de Saint-Ismier – Le Clos Faure – 38330 Saint-Ismier
Tél. 06 08 84 81 82
Mail : [email protected] et [email protected]
Association loi 1901
SIRET 404 280 687 00025 - APE 1009 Z
Licence de spectacle n° 2-1000433 et 3-1000474

La pièce
Le Tartuffe occupe à différents égards dans l'œuvre de Molière une place
exceptionnelle. On a souvent répété à raison que la hauteur universelle de sa visée,
la peinture d'un vice éternel, l'hypocrisie, mettait cette pièce à l'abri du
vieillissement ; il n'est pas de spectateur qui ne soit sensible aux questions
fondamentales que tout homme se pose sur l'être et le paraître, ou sur la tentation du
désir scandaleux. Mais Le Tartuffe est en outre une œuvre engagée, qui s'enracine
profondément dans l'histoire religieuse et politique de son temps, en même temps
qu’une œuvre d’art achevée.
Un faux dévot, Tartuffe, qui passe aux yeux du bourgeois Orgon et de sa mère
Madame Pernelle pour un saint homme, s’est impatronisé dans sa famille. Malgré
l’hostilité des siens, Orgon entend le marier à sa fille Mariane, mais le faux dévot est
surpris par Damis, le fils de la famille, aux pieds d’Elmire, la seconde femme
d’Orgon. Faisant preuve d’une habileté diabolique, le faux dévot retourne cependant
la situation en sa faveur, fait chasser Damis, et accepte la donation de tous les biens
d’Orgon, ainsi que la garde de papiers compromettants. Devant l’aveuglement
obstiné d’Orgon, Elmire tend un piège à l’hypocrite et oblige son mari à se cacher
sous la table. Tartuffe est enfin démasqué, mais il est maître de tous les biens
d’Orgon ; seule l’intervention d’un exempt, envoyé par le souverain, permet
d’arrêter Tartuffe et sauve la famille d’un désastre.
En 1664, une première version du Tartuffe ou l’Imposteur, pièce qui met en scène un
personnage de dévot hypocrite, fut interdite à la demande de l’archevêque de Paris.
L’année suivante, Dom Juan ou le Festin de pierre, qui reprenait certains des thèmes
de Tartuffe (l’impiété et l’hypocrisie), fut abandonné après la relâche de Pâques,
malgré cinq semaines de triomphe.
La bataille de Tartuffe dura près de cinq ans.
Remaniée, la pièce fut à nouveau interdite en août
1667, mais on la représenta chez le Grand Condé,
qui soutenait Molière, en présence du frère du roi,
preuve du crédit dont le dramaturge jouissait
auprès de certains membres influents de la cour. En
1664, Louis XIV lui-même avait accordé à Molière
une pension et parrainé son enfant ; l’année
suivante il avait décidé de prendre officiellement
Molière sous sa protection, décernant à ses
comédiens le titre de troupe du roi. En 1669,
l’interdiction finit par être levée, et les nombreuses
représentations du Tartuffe donnèrent la plus forte
recette jamais enregistrée au théâtre du Palais
Royal.

Molière, Préface de Tartuffe
Voici une comédie dont on a fait beaucoup de bruit, qui a été
longtemps persécutée ; et les gens qu’elle joue ont bien fait voir
qu’ils étaient plus puissants en France que tous ceux que j’ai
joués jusque ici. Les marquis, les précieuses, les cocus et les
médecins ont souffert doucement qu’on les ait représentés, et ils
ont fait semblant de se divertir, avec tout le monde, des
peintures que l’on a faites d’eux ; mais les hypocrites n’ont
point entendu raillerie ; ils se sont effarouchés d’abord, et on
trouve étrange que j’eusse la hardiesse de jouer leurs grimaces
et de vouloir décrire un métier dont tant d’honnêtes gens se
mêlent. C’est un crime qu’ils ne sauraient me pardonner ; et ils se sont tous armés
contre ma comédie avec une fureur épouvantable. Ils n’ont eu garde de l’attaquer
par le côté qui les a blessés : ils sont trop politiques pour cela, et savent trop bien
vivre pour découvrir le fond de leur âme. Suivant leur louable coutume, ils ont
couvert leurs intérêts de la cause de Dieu ; et Le Tartuffe, dans leur bouche, est une
pièce qui offense la piété. Elle est, d’un bout à l’autre, pleine d’abominations, et l’on
n’y trouve rien qui mérite le feu. Toutes les syllabes en sont impies ; les gestes même
y sont criminels ; et le moindre coup d’œil, le moindre branlement de tête, le
moindre pas à droite ou à gauche y cache des mystères qu’ils trouvent moyen
d’expliquer à mon désavantage. J’ai eu beau la soumettre aux lumières de mes amis,
et à la censure de tout le monde, les corrections que j’y ai pu faire, le jugement du roi
et de la reine, qui l’ont vue, l’approbation des grands princes et de messieurs les
ministres, qui l’ont honorée publiquement de leur présence, le témoignage des gens
de bien, qui l’ont trouvée profitable, tout cela n’a rien de servi. Ils ne veulent point
démordre ; et, tous les jours encore, ils font crier en public des zélés indiscrets, qui
me disent des injures pieusement, et me damnent par charité.
Je me soucierais fort peu de tout ce qu’ils peuvent dire, n’était l’artifice qu’ils ont de
me faire des ennemis que je respecte, et de jeter dans leur parti de véritables gens de
bien, dont ils préviennent la bonne foi, et qui, par la chaleur qu’ils ont pour les
intérêts du ciel, sont faciles à revoir les impressions qu’on veut leur donner. Voilà ce
qui m’oblige à me défendre. C’est aux vrais dévots que je veux partout me justifier
sur la conduite de ma comédie ; et je les conjure, de tout mon cœur, de ne point
condamner les choses avant que de les voir, de se défaire de toute prévention, de ne
point servir la passion de ceux dont les grimaces les déshonorent.
Si l’on prend la peine d’examiner de bonne foi ma comédie, on verra sans doute que
mes intentions y sont partout innocentes, et qu’elle ne tend nullement à jouer les
choses que l’on doit révérer ; que je l’ai traitée avec toutes les précautions que me
demandait la délicatesse de la matière et que j’ai mis tout l’art et tous les soins qu’il
m’a été possible pour bien distinguer le personnage de l’hypocrite d’avec celui du
vrai dévot. J’ai employé pour cela deux actes entiers à préparer la venue de mon
scélérat. Il ne tient pas un seul moment l’auditeur en balance, on le connaît d’abord
aux marques que je lui donne ; et, d’un bout à l’autre, il ne dit pas un mot, il ne fait
pas une action, qui ne peigne aux spectateurs le caractère d’un méchant homme, et
ne fasse éclater celui du véritable homme de bien que je lui oppose. (...)

Tartuffe séducteur ?... Jean Serroy :
Tartuffe séducteur ? Nombre des plus aiguës parmi les interprétations modernes
n’ont pas craint de pousser dans cette direction. Du coup, Tartuffe n’en finit pas de
rester une énigme. A ceux-là mêmes qui mettent en doute ses talents d’hypocrite, la
réception constamment renouvelée de l’œuvre et les interprétations les plus
contradictoires qui ont été données apportent un démenti évident : le personnage
n’en finit pas de tromper son monde, et, à qui croit le saisir, il échappe encore et
toujours.
La pièce de Molière avance masquée : c’est sa seule certitude avérée – Tartuffe, dès la
première version de la comédie, est « l’hypocrite », lié par l’étymologie même du
masque de théâtre –et sans doute est-ce là sa vérité profonde.
Enjeux de théâtre : le premier enjeu de la pièce est en effet théâtral. Le « Tartuffe »
n’est pas un accident dans la carrière de Molière, il s’inscrit dans une histoire et un
contexte qui expliquent à la fois la violence des réactions que la pièce a suscitées et la
volonté de Molière de réussir, coûte que coûte, à faire jouer sa comédie.
Curieusement, le contenu de la pièce en a souvent occulté la forme. Or, le scandale
du Tartuffe est d’abord lié à la nature spécifique de la pièce : une comédie. La
constance qu’apporte Molière à imposer celle-ci s’explique par tout autre chose que
par la volonté de faire triompher une idéologie, laquelle apparaît d’ailleurs
suffisamment brouillée pour qu’aujourd’hui encore elle soit susceptible
d’interprétations diverses et parfaitement « osées ».
De quoi est-il question ? De rien de moins, en fait, que de ce que Molière entend faire
de la grande comédie. Avec « L’Ecole des Femmes », ce qui s’annonçait déjà avec
Sganarelle et « L’Ecole des Maris » se confirme : Molière ose aborder, dans un genre
défini comme non sérieux, des questions qui, elles, le sont éminemment et dont le
fait même de les poser ébranle la stabilité sociale : l’éducation des filles, le mariage,
la place de la femme, sa liberté d’aimer. Aucune comédie ne s’était préoccupée
jusqu’ici de telles réflexions. La longue guerre comique qui se déclenche contre
Molière à la suite de la pièce réunit, fait symptomatique, tout autant les tenants de la
moralité que les partisans d’une séparation rigoureuse des genres.
C’est qu’en offrant à la comédie la possibilité de peindre tout l’homme et en lui
ouvrant la voie des grands sujets, Molière non seulement brouille le paysage théâtral,
mais il provoque directement les adversaires du théâtre, par le fait même qu’il
élargit et enrichit le champ dramatique. La multitude de réactions que suscite la
pièce montre bien à quel front commun il a désormais affaire : aux petits marquis et
aux prudes façonnières sont venus se joindre les comédiens des troupes rivales, les
confrères jaloux, les esprits doctrinaires, et surtout, plus dangereux parce que plus
puissants, les dévots, adversaires déclarés du théâtre.
Cette coalition quelque peu hétéroclite, à côté des moqueries et des attaques les plus
virulentes et les plus injurieuses, ne tarde pas à utiliser contre lui des accusations
autrement plus menaçantes.
La défense qu’il présente de la comédie face à la tragédie, la réhabilitation d’un rire
qui n’attente en rien à la morale, à travers cette étrange entreprise qui est «celle de
faire rire les honnêtes gens» : autant d’éléments qui illustrent que sa pratique
théâtrale se fonde sur une réflexion théorique approfondie, qui ne saurait céder aux
attaques de circonstance. C’est son art que Molière défend, autant dire sa raison
d’être.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%