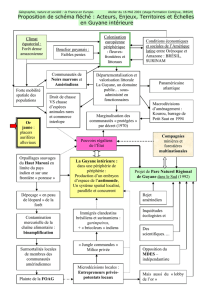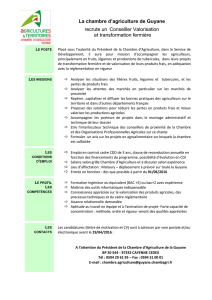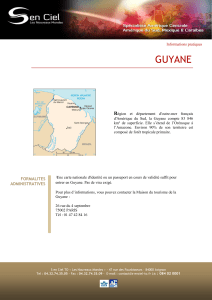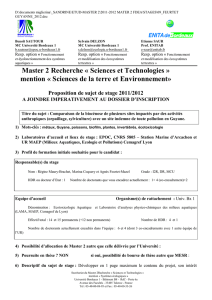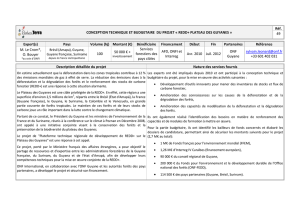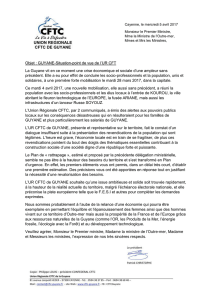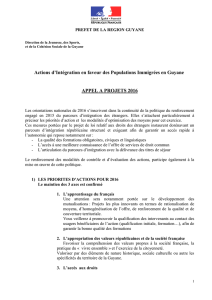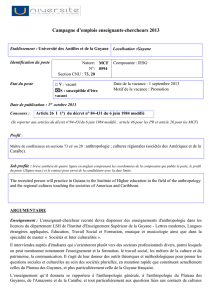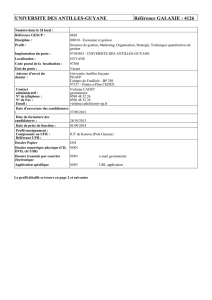Stratégies de partage et diffusion de données publiques

Netcom
Réseaux, communication et territoires
27-1/2 | 2013
Les données environnementales en libre accès
Stratégies de partage et diffusion de données
publiques environnementales
Cas d’étude en Amazonie française et brésilienne
Sandra Nicolle et Maya Leroy
Édition électronique
URL : http://netcom.revues.org/1265
DOI : 10.4000/netcom.1265
ISSN : 2431-210X
Éditeur
Netcom Association
Édition imprimée
Date de publication : 1 septembre 2013
Pagination : 60-87
ISSN : 0987-6014
Référence électronique
Sandra Nicolle et Maya Leroy, « Stratégies de partage et diffusion de données publiques
environnementales », Netcom [En ligne], 27-1/2 | 2013, mis en ligne le 11 juin 2014, consulté le 02
octobre 2016. URL : http://netcom.revues.org/1265 ; DOI : 10.4000/netcom.1265
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
Netcom – Réseaux, communication et territoires est mis à disposition selon les termes de la licence
Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Networks and Communication Studies,
NETCOM, vol. 27 (2013), n° 1-2
pp. 60-87
STRATÉGIES DE PARTAGE ET DIFFUSION
DE DONNÉES PUBLIQUES ENVIRONNEMENTALES :
CAS D’ÉTUDE EN AMAZONIE FRANÇAISE ET BRÉSILIENNE
NICOLLE SANDRA
1
, LEROY MAYA
2
Résumé
- Cet article se propose d’analyser les stratégies mises en œuvre en France et au
Brésil vis-à-vis de la production et de la diffusion de données de suivi de pressions anthropiques sur les
écosystèmes amazoniens, à savoir les impacts de l’orpaillage en Guyane française et du développement
agricole au Brésil. On montre qu’indépendamment de la législation en vigueur, les stratégies mises en
œuvre par les États sont très différentes et que cela influe de façon déterminante sur les
positionnements et revendications de la société civile vis-à-vis de ces données. Au cours de la dernière
décennie, le Brésil tend vers une ouverture croissante de l’accès aux données concernant la déforestation,
poussé à la transparence par la contre-expertise d’ONG nationales et par la pression internationale.
En Guyane, on constate au contraire un mouvement de fermeture des données concernant le suivi des
impacts de l’orpaillage, lié à une implication croissante des services d’État en charge de la sécurité
nationale dans le processus de suivi.
Mots-clés
– Données libres, stratégie environnementale, Amazonie, Brésil, Guyane
Abstract
- In this article, we analyse and compare the strategies implemented by France
and Brazil regarding the production and distribution of monitoring data concerning the impact of
human activities in an Amazonian context: gold mining impacts in French Guiana, and agricultural
development impacts in Brazil. We show that independently of the legislation, the strategies
implemented by each of the two countries are very different, with consequences on the positioning and
demands of civil society toward these data. Over the course of the last decade, the Brazilian
government showed a tendency towards the opening access to deforestation monitoring data, under the
pressure for transparency coming from national NGOs and from the international level. On the
1
Doctorante en sciences de gestion (option environnement), AgroParisTech, école doctorale
de l’Université Antilles-Guyane, OHM Oyapock (UPR 3456 CNRS-Guyane, UMR Ecofog,
EA 4557 MRM), sand.[email protected]
2
Enseignant-Chercheur en sciences de gestion, AgroParisTech, EA 4557 MRM, F- 34000
Montpellier, France, maya[email protected]

NETCOM, vol. 27, n° 1-2, 2013
61
contrary, in French Guiana, there is a reduction of information distribution concerning gold mining
impacts, linked to an increased involvement of national security state services in the monitoring
process.
Key words -
Open data, environmental strategy, Amazonia, Brazil, French Guiana
Resumo -
Neste artigo, analisamos as estratégias implementadas pelo Brasil e a
França em relação á produção e divulgação de dados ambientais de monitoramento de pressões
antrópicas no contexto amazônico. Estudamos o monitoramento da garimpagem na Guiana francesa
e o monitoramento do desmatamento no Brasil. Mostramos que independentemente da legislação, as
estratégias dos governos são muito diferentes e que tem uma influência sobre o posicionamento e as
reivindicações da sociedade civil em relação aos dados considerados. Nas ultimas décadas, o governo
brasileiro abriu o acesso livre aos dados de monitoramento do desmatamento, influenciado pela pressão
de ONG’s nacionais pedindo transparência, e também pela pressão internacional. Na Guiana
francesa, ocorreu pelo contrario um movimento de bloqueio de acesso aos dados sobre a garimpagem,
vinculado com a crescente implicação dos serviços governamentais tratando da segurança nacional no
processo de monitoramento.
Palavras-chave -
Dados livres, estratégia ambiental, Amazônia, Brasil, Guiana
francesa
INTRODUCTION
Le Brésil et la France ont tous deux une part importante de leur territoire en
forêt amazonienne : l’Amazonie légale brésilienne a une superficie de 5 217 423 km2
(soit environ 60 % de son territoire et 40 % concernés par le biome amazonien) et la
Guyane française est la plus grande région de France, avec une superficie de 83 846
km2 (soit environ 12 % du territoire si l’on intègre la superficie des départements
d’outre-mer) Ces deux pays font face à la pression internationale au regard de leur
capacité à préserver les écosystèmes amazoniens : le Brésil est considéré comme
principal responsable d’un patrimoine mondial inestimable qu’il convient de préserver
(Léna, 1999), et la France, en tant que pays européen, annonce la mise en œuvre d’une
gestion environnementale modèle de la forêt tropicale sur son territoire (Groupe
national sur les forêts tropicales, 2012).
Pourtant, les pressions sur ces écosystèmes sont extrêmement fortes. Au
Brésil, la pression principale est liée à la conversion massive de la forêt tropicale en
terres agricoles (Fearnside, 2008). Environ 71 millions d’hectares de la couverture
initiale de forêt amazonienne ont été détruits (données INPE 2011), causant une forte
perte de biodiversité via la destruction totale des habitats forestiers. En Guyane
française, la pression principale sur la forêt tropicale est liée aux activités d’extraction
aurifère, l’orpaillage (WWF, 2008; Charles-Dominique, 2005). Si une filière
d’extraction aurifère légale est encadrée par le code minier depuis 1998 et soumise à
certaines contraintes environnementales, une large part des impacts proviennent d’une

NETCOM, vol. 27, n° 1-2, 2013
62
filière illégale ayant des conséquences graves sur les écosystèmes (destruction des
ripisylves, destruction du lit mineur des cours d’eau, augmentation importante de la
turbidité, pollution au mercure) mais également au niveau social (climat d’insécurité,
trafics de drogue et d’armes, prostitution,…). Ces activités d’orpaillage illégal sont
alimentées par des flux de migratoires irréguliers essentiellement en provenance du
Brésil. Au Brésil comme en France, les gouvernements annoncent une prise en charge
de ces problèmes, également dénoncés par les acteurs de la société civile.
Pour suivre les impacts de ces activités sur la forêt, des dispositifs de suivi
satellitaire ont été mis en place par les autorités publiques dans les deux pays : au
Brésil, l’Institut national de recherches spatiales (INPE) suit régulièrement les
avancées de la déforestation depuis les années 1980 ; en Guyane, l’Office national des
forêts (ONF) a commencé à produire des suivis de la déforestation et de la turbidité
des cours d’eau liées à l’orpaillage depuis la fin des années 1990.
Ces données sont également importantes pour la société civile puisqu’elles
permettent d’une part de suivre l’évolution de l’état des écosystèmes amazoniens et
d’autre part d’avoir un regard sur l’efficacité des actions entreprises par les pouvoirs
publics face à ces dégradations. En outre, elles répondent à des enjeux juridiques
croissants concernant l’obligation de mise à disposition et de diffusion des données
environnementales (et a fortiori publiques) pour l’ensemble de la population
(traduction législative de la convention d’Aarhus en France, et loi n° 10 650 de 2003
au Brésil).
Considérant que la mise en lisibilité des impacts anthropiques sur un
territoire et ses écosystèmes est primordiale pour une prise en charge efficace des
enjeux environnementaux et qu’elle nécessite l’existence et la mise à disposition de
données concrètes de suivi de la qualité des écosystèmes, nous nous positionnons ici
dans une logique d’évaluation de l’action publique menée en faveur de
l’environnement, basée sur l’analyse des choix stratégiques réalisés par les acteurs
publics français et brésiliens pour la production et la diffusion de données
environnementales (Mermet et al., 2010).
Notre étude vise en particulier à analyser de façon comparée les stratégies de
production et de diffusion de données issues des suivis satellitaires réalisés par le
Brésil et la France (en Guyane) sur les thématiques de conversion agricole et
d’orpaillage en forêt amazonienne et leurs conséquences sur les stratégies des autres
acteurs intéressés par les données d’expertise produites sur l’état des écosystèmes
amazonien, principalement des organisations non gouvernementales d’environnement
(ONGE).
1. CADRAGES THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIE
Le travail mobilise principalement deux grilles d’analyse. L’analyse
stratégique de la gestion environnementale (ASGE) proposée par Mermet et al. (2005)
nous permet d’observer et d’évaluer les politiques publiques mises en œuvre au regard
d’objectifs environnementaux. On s’intéresse en particulier ici à comprendre comment
les acteurs annonçant une prise en charge des questions environnementales

NETCOM, vol. 27, n° 1-2, 2013
63
s’organisent autour de la question de la production et de la diffusion des données de
suivi des écosystèmes pour une plus grande efficacité environnementale.
Nous avons, de façon complémentaire, mobilisé partiellement une grille de
lecture proposée par Chignard (2012b), qui permet, elle, de comparer plus
spécifiquement les stratégies mises en œuvre par les acteurs en ce qui concerne la
diffusion et l’ouverture des données.
1.1. Une évaluation stratégique de la place des données dans l’action
publique en environnement
Mermet et al. (2010) proposent, en s’appuyant sur l’analyse stratégique pour
la gestion environnementale (Mermet et al., 2005), un cadre d’analyse pour l’évaluation
des politiques environnementales et des dispositifs de gestion qu’elles contribuent à
mettre en œuvre. La base de la réflexion est qu’il est nécessaire d’évaluer les politiques
annonçant une visée environnementale au regard d’objectifs clairs en termes de
résultats sur les écosystèmes. Il s’agit donc de reconstruire une analyse de situation de
gestion à partir d’une préoccupation environnementale clairement exprimée. Cela
implique d’une part de traduire les engagements politiques en objectifs concrets, et
d’autre part d’identifier les indicateurs qui permettent de suivre ces objectifs. Ces
indicateurs doivent être les plus pertinents possibles en se basant sur les données les
plus simples à produire pour avoir l’information nécessaire pour agir (Leroy, 2006;
Leroy et Mermet, 2012). Dans notre cas les objectifs environnementaux sont de
stopper la conversion massive de la forêt amazonienne pour l’Amazonie brésilienne,
et d’éradiquer l’activité d’orpaillage illégal en Guyane française. Actuellement, les
données et indicateurs mobilisés par les services publics sont principalement basés sur
l’analyse d’images satellites (Landsat et C-bers au Brésil ; Spot en Guyane).
La suite de l’analyse proposée par l’ASGE consiste à comprendre les jeux
d’acteurs influant sur l’état de l’écosystème au regard des objectifs environnementaux
retenus, en analysant d’une part le rôle des acteurs impliqués dans les processus
technico-économiques et sociopolitiques qui produisent les dommages, et d’autre part
le rôle des acteurs de changement qui développent une stratégie en faveur de la
préservation des écosystèmes.
En Amazonie brésilienne, ce cadre d’analyse a déjà été mobilisé par
Taravella (2008; 2010; Taravella et Arnauld de Sartre, 2012) pour faire un diagnostic
approfondi des processus de déforestation en Amazonie orientale et pour comprendre
les stratégies qui ont permis de limiter les dommages sur ce front pionnier en Terra do
Meio. Dans notre cas, nous proposons de nous focaliser uniquement sur la façon dont
les données produites sur les écosystèmes pour suivre l’évolution de leur dégradation
sont partagées et diffusées, en les considérant comme une ressource spécifique et
stratégique pour les acteurs d’environnement, nécessaire à l’action et à l’évaluation.
Notre analyse se concentrera sur les données publiques produites dans la prise en
charge de la déforestation liée au développement agricole et de l’orpaillage, et sur
l’influence de leur diffusion sur les stratégies des acteurs qui se mobilisent sur ces
questions.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%