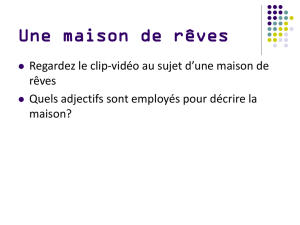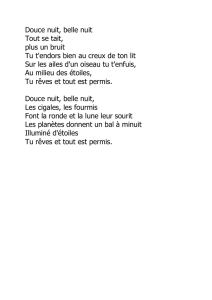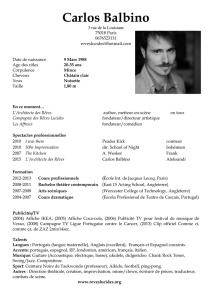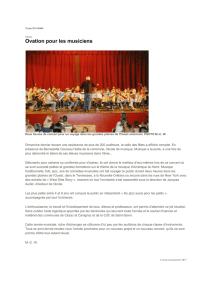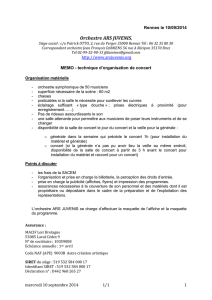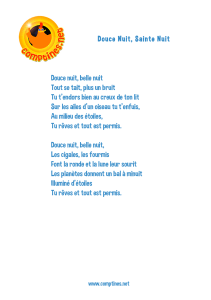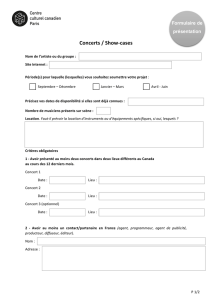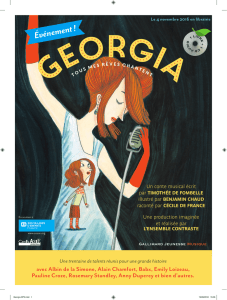Envolées, lyriques, les pieds sur terre Aleksi Barrière La shaman

Envolées, lyriques, les pieds sur terre
Aleksi Barrière
La shaman mexicaine María Sabina accédait, grâce à ses
décoctions de champignons hallucinogènes héritées d’une tradition
très ancienne, au monde des rêves : « Je suis la femme qui vole / je
suis la femme-aigle sacrée », chantait-elle. Un demi-siècle plus tôt,
malheureusement né dans une société tristement industrielle plutôt
que dans la Sierra Mazateca qui aurait mieux convenu à son
tempérament, le poète autrichien Rainer Maria Rilke aspirait à une
communion totale avec le cosmos. Il se plaisait à entrer en dialogue
avec celui qu’il appelait « l’Ange », une entité extérieure à toute
religion connue mais capable de lui ouvrir l’« espace intérieur du
monde », celui qui permet de faire l’expérience de l’univers à
travers la mémoire, le rêve et la poésie. Dans un de ses Sonnets à
Orphée, il médite sur l’aéroplane, cet « engin qui a réussi » [à
réaliser le désir humain universel de voler], mais qui est incapable
pour l’instant de dépasser sa nature d’exploit technique pour, avec
insouciance et légèreté, « ne faire plus qu’un, enfin, avec son vol ».
Loin de l’ermitage secret où se cloîtrait le poète, le film The
Aviator – dont l’action est, cependant, quasi contemporaine de
Rilke et des prouesses machiniques de son époque – nous offre une
variation sur le mythe d’Icare, et cette ivresse de l’homme qui, par
sa fortune, transforme ses rêves en caprices, et brûle sa vie par les
deux bouts entre passions amoureuses et suractivité débordante,
aspirant à devenir un oiseau solaire, avant de vivre lui aussi sa
chute, et une sans doute inévitable réclusion.

Ces trois expériences d’extase aérienne sont au cœur du
concert de ce soir. Elles ne trahissent pas simplement le motif
récurrent, dans nos mythes, notre progrès technique, et jusque dans
nos rêves, du désir de nous élever dans les airs : elles donnent à ce
vol le pouvoir de franchir la frontière du visible, de crever l’écran
du réel tel que nous le connaissons, pour accéder à une réalité plus
profonde, où les choses ont enfin un sens. Shamanisme, méditation
poétique et passion amoureuse retrouvent donc ici la même image,
qui ramène l’homme, ses villes et ses machines à leur grisante
petitesse – ce qu’a bien compris Morton Feldman en faisant du
sonnet de Rilke que nous citions une petite mélodie pour voix
seule, qui semble narguer ce vaisseau de technique musicale qu’est
un orchestre.
Si chaque concert ne peut avoir l’intensité de ces trois
communions mystiques, la musique est pourtant intimement liée à
chacune d’entre elles, comme élément rituel, essence poétique ou
intensificateur émotionnel. La musique peut prétendre relever du
désir de voler, et c’est pourquoi tous les autres arts, selon le mot de
l’essayiste Walter Pater, « aspirent constamment à la condition de
la musique ». Si l’importance de la « bande originale » même dans
les plus grandes productions hollywoodiennes ne suffisait pas à le
montrer, la mode récente des films projetés avec
l’accompagnement d’un orchestre live, renouant avec le statut de la
musique de film à l’époque du cinéma muet, le confirme – sans
parler de la pratique, courante dans bien des régions du monde, de
convoquer les spectateurs à une séance en plein air où les films sont
doublés et sonorisés en direct, rendant à des séances qui pourraient,
à l’âge de l’automatisation, abdiquer leur humanité, leur fonction
d’événements conviviaux et vivants.
Sentant le danger de voir les concerts classiques devenir de
purs rassemblements d’esthètes enclins à n’écouter la musique que
comme du beau son, et de « professionnels de la profession » venus
se retrouver entre collègues, plusieurs compositeurs ont tenté de
retrouver l’esprit des séances, au sens humain du terme. Et pour
cela, puiser dans la musique folklorique s’est avéré une nécessité
depuis la période romantique, et surtout au tournant du 20e siècle,
quand le rituel du concert se figeait dans la forme que nous lui
connaissons aujourd’hui. Pour les œuvres que nous entendrons ce
soir, Federico Mompou, dans la revendication de son identité
catalane, a beaucoup puisé dans le chant traditionnel, celui qui
rassemblait de petits groupes le temps d’une soirée de partage.
Mais le folklore n’est pas seulement une réalité à
retranscrire – ce qui signifierait qu’on ne pourrait en être que les
fossoyeurs en l’amenant dans une salle de concert. Il est une terre
de fantasme, dont le compositeur ne peut se rapprocher qu’en
ajoutant, à chaque note qu’il écrit, une distance supplémentaire
entre elle est lui, comme l’avait compris Bartók, inventeur de
l’ethnomusicologie qui s’est servi du folklore pour enfoncer les
portes de la modernité, ou même, avant lui, Bizet, qui faisait
chanter sa habanera reconstituée à l’Opéra-Comique par Carmen :
le folklore « est un oiseau rebelle, / que nul ne peut apprivoiser, / et
c’est en vain qu’on l’appelle / s’il lui convient de refuser » – il se
dérobe quand on veut le saisir, mais nous attire dans ses cadences
quand on croit lui tourner le dos. C’est ce même caractère qui a
fasciné Debussy dans la musique espagnole, et les préludes qui s’en
font l’écho ne prétendent bien sûr pas tant reconstituer ou fixer que
réinventer et réactiver un état d’esprit.
Cette séduction du folklore joue un rôle particulièrement
important pour les compositeurs du Nouveau Monde, pris en étau
dans la double difficulté de s’ancrer dans une identité mal définie
tout en s’inscrivant dans la tradition musicale « savante » classique
– plus encore que leurs homologues européens, ces musiciens

cherchent donc à s’approprier un matériau populaire et à lui donner
une légitimité que prolongeront les transcriptions orchestrales de ce
soir. Ruth Crawford Seeger illustre bien cette démarche, elle qui a
mené de front une recherche musicale inscrite dans la continuité de
Schönberg et un travail de terrain sur le folklore populaire
américain. La même tendance se retrouve chez le mexicain
Silvestre Revueltas qui associe les timbres des mariachis à ceux de
l’orchestre symphonique, ou chez le canado-étatsunien Robert
Nathaniel Dett, qui a tant œuvré pour la reconnaissance de la
tradition des negro spirituals de ses ancêtres, tout en se voulant
disciple de Dvořák. Une démarche qui ne relève pas seulement de
parcours personnels, puisque des compositeurs appartenant à une
lignée tout ce qu’il y a de plus classique s’en saisissent aussi : ainsi
George Crumb, un des auteurs les plus caractéristiques de la
musique américaine contemporaine, ou avant lui le canadien Ernest
Gagnon, qui rend dans Stadaconé hommage au village iroquois de
ce nom, celui où Jacques Cartier avait en son temps abordé le
Nouveau monde, et où devait peu à peu s’édifier la ville de Québec.
Même Calixa Lavallée, compositeur policé et somme toute très
« européen », a cherché à composer une musique qui incorpore les
littératures et les traditions de son Canada natal.
Au-delà des mouvements historiques qu’elles
accompagnent, ces musiques ne servent pas seulement un
programme politique – dont elles deviennent par ailleurs
symboliques, comme Mompou pour les Catalans, Dett pour les
Afro-américains, ou Lavallée pour les Canadiens qui choisiront
dans son catalogue leur hymne national. Ou plutôt, le projet
politique qu’elles sous-tendent dépasse les questionnements
identitaires, communautaires et patriotiques, il touche à la nature
même du fait politique, en mettant en question le rassemblement
convivial suscité par le concert. Les musiques dans lesquels ces
compositeurs puisent ne sont pas affaire de mélomanes, leur origine
se trouve au coin d’un feu de joie, ou dans un rituel précolombien
au sens aujourd’hui perdu dont il ne nous reste plus que les rythmes
contagieux, voire dans la « Juba », danse des esclaves des champs
de coton, remise à l’honneur par Dett.
Ces musiques, fantasmées et réinventés, ont vocation non
seulement à rassembler, mais surtout à faire tourner les regards vers
un même ailleurs. Rêves d’amour, rêves d’émancipation, ou rêves
d’arrière-mondes sont toujours des rêves d’une vie autre que la
survie, et affirmation que le monde ne se limite pas au visible et
aux formes instituées de commerce entre les hommes. Les
compositeurs de cinéma, en charge de la part invisible de ce
médium qui est par excellence celui de l’image et de l’apparence,
partagent finalement ce projet, et il est fascinant de voir à quel
point leurs idiomes puisent eux aussi autant dans le grand legs
symphonique que dans différents folklores qui leur permettent
d’être évocateurs avec une grande économie de moyens. Ce soir,
toutes ces musiques peuvent, si nous le voulons bien, projeter en
nous des films qui sont laissés à notre discrétion.
Ce faisant, nous avons la possibilité, en découvrant dans ce
cocktail inédit toutes ces tentatives appartenant à des univers si
contrastés, de rendre hommage à leur projet commun de concevoir
le concert comme une véritable séance de rêve collectif. L’évasion
dont on les crédite souvent un peu facilement est surtout, comme le
montre leur histoire et leur démarche profonde, un désir de
repenser le réel dans de nouvelles combinaisons, pour l’enrichir et
le transformer – ce que font, quand nous baissons notre garde, nos
rêves. / Mai 2015
1
/
3
100%