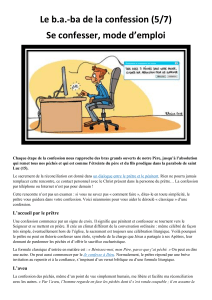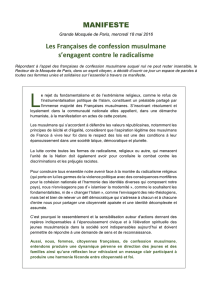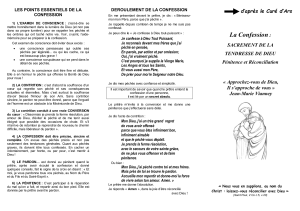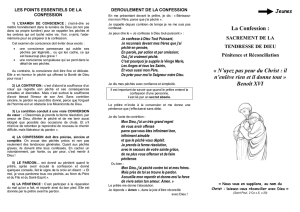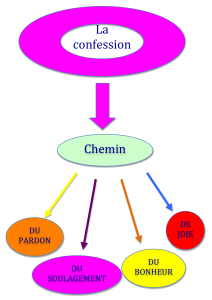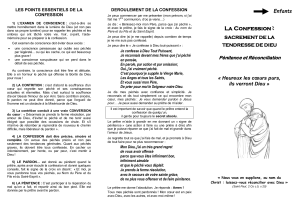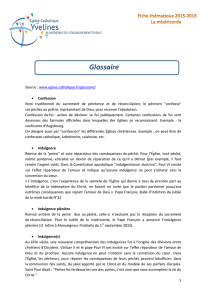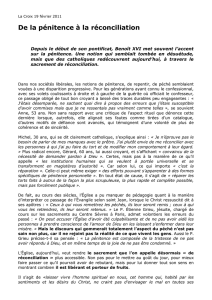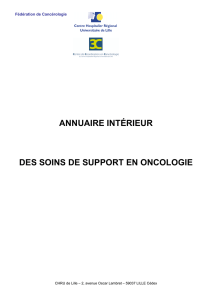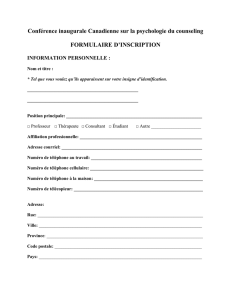Leung_fr

Commentaire
Bénissez-moi, parce que j’ai péché ...
Changement comportemental et confessionnal
Fok-Han Leung MD MHSc CCFP Andrew Leung MDiv
Au cours de la dernière décennie, les frontières de
la pratique médicale se sont élargies pour inclure
certains aspects de la psychologie et du change-
ment comportemental1,2. Plus les médecins s’impliquent
dans le changement comportemental, plus les patients
attendent du counseling de leur part1, en particulier de
leurs médecins de famille. Les patients consultent leur
médecin de famille non seulement pour faire soigner
leurs maladies physiques, mais aussi pour régler leurs
problèmes spirituels et mentaux. La médecine fami-
liale devient plus holistique et complète et la gamme
des problèmes que présentent les patients suit la même
tendance. Parallèlement, la pratique religieuse est en
déclin3 tout comme le nombre de personnes qui vont au
confessionnal4,5. À bien des égards, les médecins, sur-
tout les médecins de famille et les psychiatres, devien-
nent les «confesseurs» de leurs patients. De quelle autre
source que l’Église catholique, l’une de plus anciennes
organisations humaines, pouvons-nous le plus appren-
dre au sujet de la confession, où elle est pratiquée depuis
près de 2 000 ans?
Confession
On désigne maintenant à meilleur escient la confession
sous le nom de réconciliation. La racine latine du mot
réconciliation est reconcilius: con signifiant avec. Cilius
veut dire cheveu ou cil. Ensemble, la signification devient
«ciller», tandis que ré confère le sens de «répétition».
Quand nous cillons, nous nettoyons nos yeux pour voir
plus clairement. Par conséquent, réconciliation se ren-
drait par ciller pour nettoyer ses «yeux spirituels» ou son
âme afin de voir à nouveau avec une clarté, une harmo-
nie et une vision renouvelées6.
Depuis des siècles, les catholiques romains se confes-
sent dans leur cheminement vers une vie plus vertueuse
et, en définitive, pour être sauvés. Aux tout débuts de
l’Église, pour faire pardonner ses péchés, il fallait se
repentir publiquement7. Au VIe siècle, le repentir public
a progressivement été remplacé par la confession indi-
viduelle à un guide spirituel comme un moine ou un
prêtre4,7. La conception que se fait l’Église moderne de
la confession demeure traditionnelle dans sa doctrine,
mais elle se concentre maintenant plus sur ses aspects
pastoraux et spirituels4,8.
Parallèles
Examinons les étapes de la confession. D’abord, il y a
l’examen de conscience, puis la confession elle-même
et enfin un acte de contrition et la pénitence4-8. Existe-t-
il des parallèles entre un prêtre et un pénitent au confes-
sionnal et un médecin et un patient dans le cabinet du
médecin?
Dans l’examen de conscience avant la confession,
les pénitents sont appelés à examiner de manière rigou-
reuse et structurée chaque aspect de leur vie en fonction
des écritures, des commandements et des enseigne-
ments chrétiens. Parallèlement, les méthodes de coun-
seling médical envisagent aussi un examen structuré; les
préoccupations comportementales sont analysées sous
l’angle du fonctionnement domestique, familial et occu-
pationnel. Cet exercice permet au patient et au méde-
cin de mieux cibler le problème et indique au médecin
l’orientation à donner au counseling1.
Après l’examen de conscience, la confession com-
mence. «Pardonnez-moi mon Père, parce que j’ai
péché…» Dans le cabinet du médecin, le patient, qui
a été invité à la discussion après quelques questions
ouvertes, commence à se confier. «En passant, docteur,
je suis inquiet de…»
«Ma dernière confession remonte à…», poursuit le
pénitent. On incite les catholiques à se confesser le plus
souvent possible, tant la confession des péchés graves
que la confession dévotionnelle (péchés véniels)8; cette
pratique met en évidence l’importance de la régula-
rité, de la rigueur, de l’habitude et de la structure. La
confession s’apparente au counseling en soins de santé
en ce sens qu’un suivi régulier est souvent nécessaire,
parce qu’une exploration en profondeur de problèmes
psychosociaux complexes en une seule visite n’est pas
raisonnable1.
«Ma situation personnelle est…» Avec la descrip-
tion de la situation de vie du pénitent (p. ex., marié,
enfants, emploi), le prêtre peut mettre la confession en
contexte, car diverses circonstances et milieux de vie
présentent aux pénitents différentes tentations et occa-
sions de pécher8,9. Pour le pénitent, cette réflexion sur sa
situation de vie lui apprend à mieux se connaître8. Pour
le médecin, elle est pareillement utile pour obtenir du
patient qu’il explique comment il comprend son propre
contexte et ainsi manifester sa motivation, son intelli-
gence et son intuition, qui sont tous d’importants fac-
teurs à considérer dans le counseling1.
«…et voici mes péchés.» Suit alors une liste des
péchés (p. ex., la confession réelle et des «excuses» pour
les fautes commises)4,6-8. Même sans s’aventurer dans
la théologie de la confession, sa nature cathartique est

Commentaire
évidente. Sans interruption, le pénitent se confesse jus-
qu’au bout de sa liste. Cette même catharsis et libération
se produisent quand un patient dévoile ses désappointe-
ments, ses anxiétés et ses échecs perçus. La leçon à
tirer ici pour les médecins, c’est d’accorder du temps au
patient sans interruption avant de répondre1,2.
À la fin de la confession, le pénitent récite l’acte de
contrition8: «Mon Dieu, j’ai l’extrême regret… je prends
la ferme résolution de ne plus vous offenser et de faire
pénitence». Dans la perspective de la psychothérapie,
l’acte de contrition est la déclaration d’un engagement
à changer9. Mais, bien avant l’actuel modèle transthéo-
rique10-13, sur lequel repose la compréhension par la
profession médicale de la relation entre le counseling
et le changement comportemental, le confessionnal de
l’Église, à toutes fins pratiques, se servait de stratégies
cognitives et fondées sur le rendement pour aider les
pénitents à en arriver à un équilibre décisionnel. Les
patients qui consultent un médecin de famille pour avoir
un counseling médical ressemblent aux pénitents qui
vont se confesser, parce qu’ils doivent eux aussi faire
leur examen de conscience et surmonter la résistance
à se confier et à discuter. C’est là une progression du
«précontemplatif» au «contemplatif». Une autre ressem-
blance avec le modèle du counseling médical se situe
dans la suggestion d’une pénitence par le prêtre; en
proposant une pénitence, les prêtres font en fait passer
les pénitents de la «contemplation» à «l’action», et par
conséquent, font pencher la balance décisionnelle en
faveur du changement comportemental.
Véhicules de changement
La médecine a abordé le changement comportemental
à la suite d’études rigoureuses14-16. L’Église catholique a
abordé le changement comportemental en se fondant
sur des siècles de réflexion sur l’expérience pratique
des confessions entendues7. Que peuvent apprendre la
médecine et l’Église l’une de l’autre?
Si l’absolution spirituelle ne relève pas de la méde-
cine, la médecine peut mettre davantage à contribution
le pouvoir de guérison des rituels. Au lieu d’être une
punition pour les péchés, les aspects rituels de la péni-
tence (p. ex., jeûne, offrandes et prière) peuvent en réa-
lité distraire la personne de ses péchés et l’aider à se
concentrer davantage sur faire le bien17. Cette dimension
curative et spirituelle de la pénitence offre des idées à la
profession médicale. La médecine devrait considérer le
potentiel thérapeutique de la pénitence et donner au
processus du counseling une dimension plus «sacrée».
Le counseling dans les soins de santé est souvent
axé sur les solutions. La question de culpabilité et l’idée
du «péché» sont rarement explorées5,8,9. C’est très dif-
férent du processus de la confession. Si la plupart des
médecins sont habituellement mal à l’aise ou peu habi-
les dans la discussion du péché ou de la culpabilité,
ces questions peuvent quand même peser lourd sur les
pénitents et sur les patients5. Comment la médecine
peut-elle mieux examiner et aborder les crises mora-
les des patients qui sont parfois à la source de leurs
autres présentations cliniques? Il existe des possibilités
en counseling médical d’étudier plus en profondeur les
confessions.
L’Église peut aussi apprendre de la compréhension
médicale contemporaine et de l’exécution du change-
ment comportemental; la formation dans les séminai-
res catholiques peut bénéficier d’un enseignement plus
rigoureux et structuré du changement comportemen-
tal. La formation actuelle des séminaristes et du clergé
est souvent faible et non systématique. Les théories du
counseling peuvent aider les prêtres à mieux compren-
dre les principes qu’ils appliquent au quotidien pour
mieux conseiller leurs pénitents.
Le confessionnal traditionnel cache à la fois le péni-
tent et le confesseur; un grillage de bois dissimule sou-
vent les 2 parties l’une à l’autre dans un lieu sombre.
Depuis la fin des années 1960, après le Concile Vatican
II, la plupart des prêtres entendent les confessions en
dehors du traditionnel confessionnal; le pénitent et le
confesseur se parlent face à face sans cacher leur iden-
tité. Comment cette pratique change-t-elle la dynamique
de la confession? L’Église peut bénéficier de la rigueur
de l’approche médicale pour répondre à ces questions.
La confession, ou sacrement de réconciliation, offre
aux pénitents la promesse de l’absolution. Le counse-
ling dans le cabinet du médecin offre aux patients la
promesse du changement d’un comportement malsain.
Il y a des parallèles et de la convergence dans le style, le
contenu et le processus. Les 2 sont des véhicules dans
lesquels les gens recherchent le «salut». La confession
est passée de la pénitence à la réconciliation; la méde-
cine est passée d’une approche centrée sur la maladie à
une approche holistique. Si de moins en moins de péni-
tents se confessent, de plus en plus de patients deman-
dent du counseling à leurs médecins. L’Église est aux
prises avec le défi de rendre le sacrement de la récon-
ciliation plus attrayant et efficace et la médecine doit
relever le défi d’accroître la pertinence et l’accessibilité
du counseling. L’Église et la médecine ont beaucoup à
apprendre l’une de l’autre.
Dr Leung est médecin membre du personnel et chargé de cours au
Département de médecine familiale et communautaire de l’University of
Toronto au St Michael’s Hospital en Ontario. Révérend Leung est pasteur
associé à la paroisse St Basil à l’University of St Michael’s College de l’Univer-
sity of Toronto.
Intérêts concurrents
Aucun déclaré
Correspondance
Dr Fok-Han Leung, St Michael’s Hospital, Département de médecine familiale
et communautaire, 30 Bond St, Toronto, ON M5B 1W8; téléphone 416 867-
7426; télécopieur 416 867-7498; courriel [email protected]
Les opinions exprimées dans les commentaires sont celles des auteurs. Leur
publication ne signifie pas qu’elles sont sanctionnées par le Collège des méde-
cins de famille du Canada.
Références
1. Harris RD, Ramsay AT. Health care counselling: a behavioural approach.
Sydney, Austral: Williams & Wilkins and Associates Pty Ltd; 1988.

Commentaire
2. Tim Bond. The nature and the role of counselling in primary care. Dans:
Keithley J, Bond T, Marsh G, rédacteurs. Counselling in primary care. 2e éd.
Oxford, RU: Oxford University Press; 2002. p. 3-24.
3. Center for Applied Research in the Apostolate [site Web]. Washington, DC:
Center for Applied Research in the Apostolate at Georgetown University;
2008. Accessible à: http://cara.georgetown.edu/bulletin/international.
htm. Accédé le 20 octobre 2008..
4. Anciaux P. The sacrament of penance. Londres, RU: Challoner Publications
Ltd; 1962.
5. Foley L. What’s happening to confession? Cincinnati, OH: St Anthony
Messenger Press; 1970.
6. Prieur M. Reconciliation. A user’s manual. Ottawa, ON: Novalis; 2002.
7. Martos J. Doors to the sacred. A historical introduction to sacraments in the
Catholic church. Liguori, MI: Liguori Publications; 2001.
8. Randolph F. Pardon and peace. A sinner’s guide to confession. San Francisco,
CA: Ignatius Press; 2001.
9. Walsh C. The untapped power of the sacrament of penance. A priest’s view.
Cincinnati, OH: St Anthony Messenger Press; 2005.
10. Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and processes of self-change of
smoking: toward an integrative model of change. J Consult Clin Psychol
1983;51(3):390-5.
11. DiClemente CC, Prochaska JO, Gibertini M. Self-efficacy and the stages of
self-change in smoking. Cognit Ther Res 1985;9(2):181-200.
12. Prochaska JO, Velicer WF, DiClemente CC, Fava J. Measuring processes
of change: applications to the cessation of smoking. J Consult Clin Psychol
1988;56(4):520-8.
13. Horwath CC. Applying the transtheoretical model to eating behavior
change: challenges and opportunities. Nutr Res Rev 1999;12(2):281-317.
14. Stein RE, Zitner LE, Jensen PS. Interventions for adolescent depression in
primary care. Pediatrics 2006;118(2):669-82.
15. Borkovec TD, Newman MG, Pincus AL, Lytle R. A component analysis of
cognitive-behavioural therapy for generalized anxiety disorder and the role
of interpersonal process. J Consult Clin Psychol 2002;70(2):288-98.
16. Gould RA, Otto MW, Pollack MH, Yap P. Cognitive behavioral and pharma-
cological treatment of generalized anxiety disorder: a preliminary meta-ana-
lysis. Behav Ther 1997;28(2):285-305. DOI:10.1016/S0005-7894(97)80048-2.
17. Coffey DM. The sacrament of reconciliation. Collegeville, MN: The Liturgical
Press; 2001.
1
/
3
100%