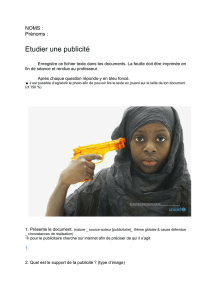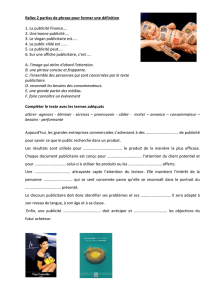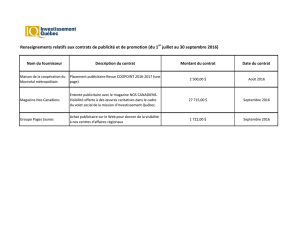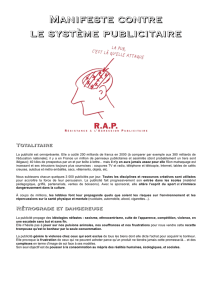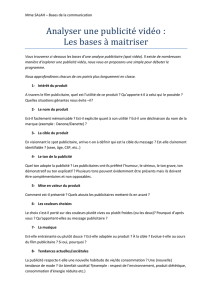Lire la suite

dossier
mots clés
Communication
Publicité
Hôpital
CSP
T2A
Établissement public de santé, personne morale de droit public soumis au contrôle
de l’État, l’hôpital dispose d’une autonomie financière et de gestion. Chaque
établissement est employeur, acheteur mais aussi producteur de soins, l’objectif
étant de produire du soin de qualité et d'en tirer un revenu, le tout financé par
l’Assurance Maladie, les patients et les mutuelles. Depuis une expérimentation
lancée le 1er janvier 2000 (1), le mode de financement des établissements publics de
santé ayant des activités de médecine, chirurgie et obstétrique, est la tarification
à l’activité (T2A) : une logique de recette se substitue à une logique de dépense.
Le financement se fondant sur le volume et la nature de leurs activités, l’image
des hôpitaux apparaît davantage décisive dans un secteur sanitaire de plus en plus
concurrentiel. Mais de quelle manière l’hôpital peut-il soigner son image et faire
connaître ses activités, sachant que la communication est autorisée et la publicité
en principe interdite, et que la frontière entre ces deux concepts est mince ?
JURIDIQUE
Communication/publicité
Où est la frontière ?
Publicité
Il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire
qui propose une définition de la publicité des établissements
publics de santé. Toutefois, par analogie, des définitions
peuvent être données.
»
Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, la
publicité correspond à « tout moyen d’information destiné
à permettre à un client potentiel de se faire une opinion
sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou
du service qui lui est proposé (2) ».
»
S’agissant de la publicité pour les médicaments à usage
humain, l’article L. 5122-1 du code de la santé publique
(CSP) précise : « On entend par publicité pour les médi-
caments à usage humain toute information, y compris
de démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à
promouvoir la prescription, la déli-
vrance, la vente ou la consommation
de ces médicaments, à l’exception
de l’information dispensée, dans
le cadre de leurs fonctions, par les
pharmaciens gérant des pharmacies
à usage intérieur.
Ne sont pas incluses dans le champ
de cette définition :
- la correspondance, accompagnée
le cas échéant de tout document non
publicitaire, nécessaire pour répondre
à une question précise sur un médi-
cament particulier ;
- les informations concrètes et les
documents de référence relatifs, par
exemple, aux changements d’embal-
lage, aux mises en garde concernant
les effets indésirables dans le cadre de
la pharmacovigilance, ainsi qu’aux
catalogues de ventes et listes de prix
s’il n’y figure aucune information
sur le médicament ;
- les informations relatives à la
santé humaine ou à des maladies
humaines, pour autant qu’il n’y ait
pas de référence même indirecte à
un médicament. »
Aussi, la publicité peut se définir
comme une forme de communica-
tion dont l’objectif est d’influencer les
consommateurs pour qu’ils adoptent
le comportement souhaité : acheter,
adhérer, plébisciter.
Manon Quillevere
Consultante
Centre de droit
JuriSanté, CNEH
gestions hospitalières n° 552 - janvier 2016 [dossier] 39

L’utilisation de la publicité est inter-
dite pour les établissements publics
de santé. En effet, il convient de se
référer à diverses dispositions légales
et réglementaires pour s’en apercevoir.
Tout d’abord, l’article L. 1110-8 du CSP
pose le principe selon lequel « le droit
du malade au libre choix de son pra-
ticien et de son établissement de san-
té est un principe fondamental de
la législation sanitaire ». Autrement
dit, un établissement public de santé
qui utiliserait un quelconque moyen
publicitaire dans le but d’influencer
les patients violerait le principe légal
énoncé précédemment.
Aussi, l’article L. 1211-3, alinéa 1 du
CSP ajoute : « La publicité en faveur
d’un don d’éléments ou de produits
du corps humain au profit d’une
personne déterminée ou au profit
d’un établissement ou organisme
déterminé est interdite. Cette inter-
diction ne fait pas obstacle à l’in-
formation du public en faveur du
don d’éléments et produits du corps
humain. »
Également, l’article R. 4127-19 du code
de la santé publique précise
(3) : « La
médecine ne doit pas être pratiquée
comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou
indirects de publicité et notamment
tout aménagement ou signalisation
donnant aux locaux une apparence
commerciale. »
La transgression à l’interdiction de la
publicité est susceptible de fonder une
condamnation à une peine, une amende,
au versement de dommages-intérêts
et une sanction disciplinaire (pour les
professionnels).
De plus, comme le précise l’Ordre natio-
nal des médecins, « la santé n’est pas
un bien marchand. L’acte médical
ne peut être considéré comme une
denrée, une marchandise échangée
pour une contrepartie financière. Le
médecin (et par extension les établis-
sements de santé) ne “vend” pas des
ordonnances ou des soins, ou des
cer tifi ca t s […]
(4) ».
Si les hôpitaux ne sont pas autorisés à
faire la publicité de leurs activités, pour
les raisons présentées précédemment,
il est tout de même nécessaire qu’ils
communiquent sur celles-ci.
Communication
Au même titre que la publicité, il n’existe aucune définition
légale, réglementaire ou jurisprudentielle de la notion de
communication. En reprenant les définitions de la publicité
présentées précédemment, il est toutefois possible de dire
ce que n’est pas la communication : elle ne doit pas avoir
pour objectif d’influencer les potentiels patients.
De même, il est possible de qualifier cette notion comme
étant une stratégie autour de l’image et de la notoriété,
celle-ci ayant pour objectif de bâtir un capital de confiance
fondé sur la ou les valeurs de l’établissement permettant
d’être apprécié, défendu ou choisi.
Compte tenu du silence des textes, contrairement à la
publicité, il convient d’admettre que l’utilisation d’une
stratégie de communication est admise pour les hôpitaux.
Ensuite, il faut préciser que celle-ci s’inscrit dans le cadre
de l’éducation sanitaire : la promotion de la santé publique
et l’éducation thérapeutique des patients.
De plus, comme précisé précédemment, avec l’apparition
du financement des établissements publics de santé à
l’activité, leur image et leur notoriété sont importantes.
Une stratégie de communication doit ainsi être mise en
place sans pour autant devenir de la publicité.
Ainsi, les établissements publics de santé n’hésitent pas
à changer leur nom afin de travailler leur image auprès
du public, provoquant parfois la polémique.
Communiquer
sans recourir à la publicité
S’il est nécessaire de communiquer sans pour autant
avoir recours à la publicité, la frontière entre ces deux
notions apparaît mince. Le commentaire figurant sous
l’article 20 du code de déontologie médicale identifie
deux critères pour les distinguer. Il est précisé en effet
que « l’appréciation du caractère publicitaire prend
en compte deux données :
- la volonté publicitaire utilisant l’information comme
prétexte ;
- la notion de proportionnalité, lorsque, dans le message
transmis, l’impact publicitaire submerge manifeste-
ment l’information elle-même ».
À la lecture de ce commentaire, deux critères permettant
de distinguer la publicité de la communication peuvent
être identifiés : l’intention et la proportionnalité.
Au regard de ces critères, il apparaît qu’aucune règle géné-
rale ne peut être établie. Il s’agit de cas d’espèce. Autrement
dit, pour qualifier une pratique de communication ou de
publicité, il convient d’une part de rechercher l’intention
de son auteur, d’autre part d’apprécier la proportionnalité
entre le( ou les moyens mis en œuvre et le but recherché.
Toutefois, il suffit de s’intéresser aux pratiques des éta-
blissements publics de santé pour comprendre que l’ap-
préciation de ces critères n’est pas simple. Par exemple :
»
chaque année, le magazine Le Point publie un numéro spé-
cial sur le palmarès des hôpitaux et cliniques. Officiellement,
ce dernier a pour objectif d’informer les personnes sur la
qualité des établissements de santé en France. Cependant,
NOTES
(1) Expérimentation de cinq ans
lancée par la loi n° 99-641 du
27juillet 1999 portant création
d’une couverture médicale
universelle. Celle-ci a été reprise
dans le plan Hôpital 2007.
(2) Cour de cassation, chambre
criminelle, 12 novembre 1986,
n° 85-95538.
(3) Le code de déontologie médicale
est ici cité compte tenu de sa place
particulière dans le monde
de la santé. Toutefois, il convient
de préciser qu’existent aussi les
codes de déontologie
des chirurgiens-dentistes,
des sages-femmes, des pharmaciens
et des masseurs-kinésithérapeutes.
(4) Commentaire sous l’article20
(art. R. 4127-19 du code de santé
publique) du code
de déontologie médicale.
40 [dossier] n° 552 - janvier 2016 gestions hospitalières

quels sont les impacts de ce palmarès sur l’image des éta-
blissements figurant dans le haut du tableau ?
»
Certaines inaugurations de service ou de plateau technique
sont relayées par la presse locale ou par des articles figurant
sur Internet. Ainsi, il arrive à la presse locale de relayer la
restructuration ou l’ouverture d’une maternité. L’objectif
d’une telle communication est l’information au public d’une
modification de l’offre de soins ou encore la mise en valeur
des élus locaux. Pour autant, dans le secteur concurrentiel
des maternités au sein d’un même bassin de santé, il peut
aussi s’agir d’une habile stratégie de communication…
Aussi est-il intéressant d’analyser des décisions de justice afin
d’apprécier les critères de distinction précédemment cités
et de comprendre les enjeux de la qualification de procédés
comme étant de publicité ou de communication (5) :
»
Cour de cassation, 1
re
chambre civile, 5 juillet 2006, n°04-
11.564. La clinique de médecine esthétique capillaire X…
demande l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes
de lui avoir ordonné, à la demande du Syndicat national
des médecins esthétiques, de cesser, sous astreinte, toute
publicité se rapportant aux micro-greffes et aux greffes
de cheveux et plus généralement aux actes médicaux et
de l’avoir condamnée à verser au syndicat 1€ au titre des
dommages et intérêts.
La première chambre civile de la Cour de cassation rejette sa
requête au motif que « les procédés de publicité auxquels
avait eu recours la clinique portaient sur des actes médi-
caux et bénéficiaient aux médecins exerçant en son sein
puisqu’ils permettaient d’attirer la clientèle ». Dès lors,
le juge qualifie le comportement de la clinique de déloyal au
regard de l’interdiction de tous procédés directs ou indirects
de publicité. En effet, la Cour de cassation confirme la position
de la cour d’appel de Rennes selon laquelle « l’interdiction
déontologique de faire de la publicité pour des actes
relevant du domaine de la médecine s’imposait non
seulement aux médecins mais également à la clinique ».
Il ressort de cette décision de justice :
•
que l’interdiction déontologique de faire de la publicité pour
des actes relevant du domaine de la médecine s’impose aux
médecins mais également aux structures qui les accueillent ;
• qu’au regard des procédés utilisés par la clinique, à savoir
attirer des patients, son comportement viole le principe
de l’interdiction de faire de la publicité et est qualifié par
le juge de déloyal.
»
Conseil d’État, 12 mars 2014, n° 361061. Un médecin généra-
liste a été sanctionné par la chambre disciplinaire de première
instance de Rhône-Alpes à trois mois d’interdiction d’exercer
la médecine pour avoir méconnu les règles de déontologie
notamment, en ayant eu recours à un procédé publicitaire
au titre d’un article paru dans la presse locale. Cet article
litigieux, paru dans Le Dauphiné libéré, présente le médecin
comme « le patron de la clinique des Deux-Alpes », avec
photo à l’appui montrant ce dernier auscultant un enfant.
Cette sanction a été confirmée par la chambre disciplinaire
nationale de l’Ordre des médecins. Le médecin généraliste
demande au Conseil d’État d’annuler la sanction prononcée.
Pour le juge administratif, cet article
consistait en un reportage sur les res-
sources médicales disponibles aux Deux-
Alpes pendant la saison de ski, intitulé
« Les Deux-Alpes : les médecins de
la station ne chôment pas ». De plus,
le Conseil d’État constate que, dans
cet article, la parole était donnée aux
médecins qui présentaient l’activité de
leurs cabinets respectifs. Par consé-
quent, selon le juge administratif, le
comportement du médecin dans l’article
litigieux ne présentait pas un caractère
publicitaire. La sanction est annulée.
Il ressort de cette décision qu’un article
paru dans la presse locale se bornant à
informer la population des ressources
médicales présentes sur le territoire
ne revêt pas un caractère publicitaire.
De la jonction de tous ces éléments, il
faut noter qu’il existe peu de différences
entre les notions de communication et de
publicité. Or, si la première est autorisée,
la seconde est interdite dans le milieu
hospitalier. Le dilemme auquel font
face les hôpitaux est donc de commu-
niquer sur leur image et leurs activités
sans pour autant faire de la publicité.
Effectivement, en cas de requalification
d’une stratégie de communication en
pratique publicitaire, l’établissement
encourt une condamnation à une
peine, une amende, au versement de
dommages-intérêts… Alors, communi-
cation habile… ou publicité déguisée ? l
«Si les hôpitaux ne sont
pas autorisés à faire la publicité
de leurs activités, pour les raisons
présentées précédemment,
il est tout de même nécessaire
qu’ils communiquent sur celles-ci.
NOTE
(5) Les décisions de justice
citées ne sont pas relatives aux
établissements publics de santé.
Toutefois, par analogie, il est
judicieux d’y faire référence.
gestions hospitalières n° 552 - janvier 2016 [dossier] 41
1
/
3
100%