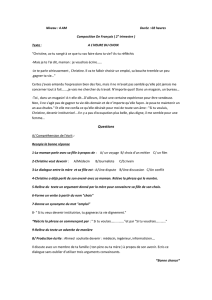Sur l`oppression des femmes – III – À propos de Christine Delphy et

URI : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article28097
Europe Solidaire Sans Frontières > Français > Théorie > Patriarcat, famille, féminisme > Sur
l’oppression des femmes – III – À propos de Christine Delphy et de « (...)
Sur l’oppression des femmes – III – À propos de
Christine Delphy et de « L’ennemi principal »
lundi 11 mars 2013, par ARTOUS Antoine (Date de rédaction antérieure : 1er novembre 1999).
Dans la série « Sur l’oppression des femmes », voir aussi
Sur l’oppression des femmes – I – Oppression des femmes et capitalisme (article 2758)
Sur l’oppression des femmes – II – Rapports de parenté et échange des femmes (article 28096)
Sur l’oppression des femmes – IV – Bibliographie (article 28101)
Sommaire
Un travail de déconstruction
Récuser toute approche historic
A propos de la « théorie de (...)
Une difficulté dans l’argumenta
Dans l’Ennemi principal, Christine Delphy entend fonder une analyse matérialiste de
l’oppression des femmes dans la société moderne sur une « économie politique du patriarcat ».
Poursuivant sa réflexion sur la spécificité de l’oppression des femmes sous le capitalisme,
Antoine Artous souligne l’intérêt du travail de déconstruction mené par Christine Delphy, tout
en débattant de sa théorie du mode de production domestique.
Le livre de Christine Delphy, L’Ennemi principal (Sylepse 1998 est un recueil d’articles ou de textes écrits
de 1970 à 1978. Le titre reprend celui d’un article publié en 1970 dans la revue Partisans et qui, à
l’époque, avait donné lieu à de nombreux débats. Il définissait les femmes, face aux hommes, comme une
classe objet d’une exploitation spécifique au sein de la famille, plus exactement caractérisée comme «
l’économie domestique ». D’où le sous-titre du livre : Economie politique du patriarcat.
À cette époque, l’élaboration de Christine Delphy s’inscrivait dans un mouvement plus vaste de réflexion
sur le travail domestique qui entendait mettre en œuvre une analyse matérialiste de la famille, donc de
l’oppression des femmes. Plutôt que d’en faire un compte rendu académique, c’est dans ce cadre que je
vais traiter de ce livre pour poursuivre le travail d’analyse de la famille moderne amorcé dans l’article
publié dans ce même numéro.
En commençant par un retour sur les discussions qui se sont alors déroulées à propos du travail
domestique eu égard à la théorie de la valeur de Marx. Une des particularités, parfois oubliée, de
l’approche de Christine Delphy est de remettre en cause ce cadre de discussion : son projet n’est pas de
démontrer que le travail domestique produit de la valeur. Un rappel rapide de ces discussions est pourtant
nécessaire, ne serait-ce que pour mieux comprendre le proiet de l’auteure.

Un travail de déconstruction
Dès son premier article de 1970, Christine Delphy traite de la question du travail domestique dans un
cadre différent de celui que je viens de rappeler. Elle entend « ne pas se laisser prendre au piège
classique de l’opposition entre valeur d’échange et valeur d’usage » (p. 7). Pour elle, la question n’est pas
d’essayer de montrer que le travail domestique dégage de la valeur. Les services domestiques fournis par
les femmes « sont exclus du domaine de l’échange et n’ont conséquemment pas de valeur » (p. 34).
Toutefois, si « la non-valeur marchande est caractéristique de l’économie familiale, elle ne signale pas
l’absence d’activité économique, mais la présence d’une économie autre » (p. 10). Son projet est
précisément de montrer « que la famille est le lieu d’une exploitation spécifique : celle des femmes » (p.
34). Pour ce faire, elle s’attelle à deux tâches. D’une part, un travail de déconstruction des discours
dominants qui masquent les caractéristiques des tâches dites ménagères. D’autre part, un travail
d’élaboration visant à produire la théorie de cette économie familiale dans laquelle les femmes sont
exploitées. Il s’agit du mode de production domestique, articulé à des rapports de production spécifiques.
Ce travail de déconstruction, Christine Delphy l’entreprend dès son premier article de 1970 et le poursuit
dans un texte de 1978. Schématiquement dit : l’auteure montre comment l’autoconsommation agricole,
bien qu’étant une production non-marchande, est considérée comme productive par les comptabilités
nationales, mais que ces mêmes comptabilités établissent une coupure non légitime dans les activités
nécessaires à cette autoconsommation. En effet ne sont pas comptabilisées dans ces dernières (et donc
considérées comme non-productives) une partie des tâches liées, par exemple, à la transformation d’un
cochon (préparation, cuisson, et services de côtelettes) sans lesquelles pourtant ce procès
d’autoconsommation n’aurait pas lieu. Ces activités, renvoyant à ce qu’il est convenu d’appeler le travail
ménager, devraient être considérées comme productives selon les critères des comptes nationaux. De
même que les activités domestiques réalisées dans un ménage urbain, car « c’est dans tous les ménages
que l’on cuit des côtelettes. Par conséquent tous les ménages, et non les seuls ménages agricoles,
produisent pour leur propre consommation » (p. 65).
Si, poursuit Christine Delphy, le travail ménager n’est pas considéré comme productif - et donc non
comptabilisé - c’est parce qu’il est effectué de façon gratuite. Et ceci non en raison de la nature des
services qui le composent ou de la personne qui les effectue (une employée de maison est payée pour le
même service), mais « en raison de la nature particulière du contrat qui lie la travailleuse – l’épouse – au
ménage, à son « chef » (p. 69). Il faut donc définir le travail ménager « comme une certaine relation de
travail, un certain rapport de production : comme tout travail effectué pour autrui dans le cadre du
ménage ou de la famille et non payé » (p. 72). Sous cet angle, il n’existe aucune différence entre le travail
dit ménager effectué par les femmes d’agriculteurs et d’autres activés comme celles jugées productives
par les comptabilités nationales. D’où la nécessité d’introduire le concept de « travail domestique afin de
désigner un objet d’étude précis : le travail gratuit effectué dans la domus au sens large et sociologique »
(p. 73).
Ces textes de Christine Delphy sont devenus des « classiques » et, avant de poursuivre, je ferai une
remarque. La démonstration – redoutable dans sa rigueur – porte sur les catégories mises en œuvre par
les comptabilités nationales, que l’auteure déconstruit à partir de la définition du travail productif établie
par ces mêmes comptabilités. Cette définition est légitime, explique-t-elle, car elle définit « comme
productif tout ce qui est surcroît de richesse » (p. 651). Reste que, ce faisant, la comptabilité nationale
prend en compte certaines activités ne produisant pas pour le marché. Du point de vue du fonctionnement
du système capitaliste (qui est le point de vue de Marx dans sa définition du travail productif), ce travail
n’est pas productif.
Christine Delphy le sait, mais - on retrouvera le problème - elle joue parfois sur l’ambiguïté. Surtout ce
type d’analyse a été assez souvent compris comme si la déconstruction ainsi faite permettait d’amener à
l’existence ce qui jusqu’alors avait été caché : le caractère productif du travail domestique, sa « réalité »
comme travail, au sens où l’on parle du travail d’un artisan, d’un salarié, etc. Or, la non-existence du
travail des femmes au foyer n’est pas une simple donnée idéologique. C’est la société capitaliste qui ne
fait pas de l’activité ménagère un travail socialement reconnu. Et c’est pour cela que cette activité n’a pas

les caractéristiques de ce qui dans notre société est reconnu comme du travail.
Récuser toute approche historico-génétique
Venons-en à la seconde dimension du travail de Christine Delphy : sa théorie du mode de production
domestique à travers laquelle elle entend rendre compte de la spécificité du travail domestique et de
l’exploitation des femmes à laquelle il donne lieu. L’auteur résume ainsi (p. 7) les trois thèses qu’elle
formule en 1970 :
« 1. Le patriarcat est le système de subordination des femmes aux hommes dans les sociétés industrielles
contemporaines.
2. Ce système a une base économique.
3. Cette base est le mode de production domestique ».
Il arrive souvent que l’on souligne l’intérêt de ses analyses du mode de production domestique comme
base du patriarcat, tout en lui reprochant de totalement autonomiser ce mode par rapport à la production
capitaliste devenue dominante et de sous-estimer la façon dont le capitalisme a pu le remodeler, le
transformer... Je ne suis pas certain que l’angle d’attaque soit le bon. D’abord, ce faisant, on ne discute
pas sur le fond de sa problématique ; ou seulement sous un aspect : la définition des femmes comme
groupe social en tant que classe. Ensuite, on oublie que l’une des particularités de Christine Delphy est de
récuser toute approche historico-génétique. Lorsqu’elle parle de patriarcat, elle étudie « non pas une
entité ahistorique qui se promènerait à travers les siècles, mais les sociétés industrielles contemporaines.
[...] Beaucoup de gens croient que quand on a retrouvé dans le passé la naissance d’une institution, on
possède la clé de son existence actuelle. En réalité on n’a expliqué ni son existence actuelle, ni même son
apparition passée. En effet il faut expliquer son existence à chaque moment par le contexte du moment »
(p. 18).
Cette remarque de méthode est très importante pour l’analyse des sociétés modernes. Et il faut souligner
qu’elle est en rupture avec une démarche dominante consistant à prendre comme point de départ
l’analyse du patriarcat comme forme précapitaliste, pour voir comment ce dernier a pu se le réapproprier
tout en le transformant. Mais, paradoxalement, c’est ce rappel de méthode qui me semble rendre très
aléatoire la référence à un « mode de production domestique » dont Christine Delphy a du mal à fonder le
statut. C’est cet aspect des choses que je voudrais traiter ici car, outre le fait que dans l’introduction de
son livre Christine Delphy donne beaucoup de place aux questions de méthode, cela recoupe des
problèmes auxquels j’ai été confronté dans mon propre travail d’élaboration.
A propos de la « théorie de la connaissance située »
Christine Delphy revendique la création du concept du mode de production domestique qui, par la suite,
aurait été repris par Marshall Sahlins et Claude Meillassoux, « mais dans des acceptions déformées » (p.
11). Je ne connais pas le détail de l’histoire de ce concept. Mais il est intéressant de voir comment il
fonctionne chez Claude Meillassoux dans Femmes, greniers et capitaux (1975). À travers lui, l’auteur
développe une approche historico-génétique (il faudrait nuancer) de la famille moderne puisqu’il en fait,
pour l’essentiel, une institution issue d’une forme précapitaliste : le mode de production domestique. En
revanche, il spécifie clairement ce que sont ses conditions historiques d’émergence : « L’organisation
sociale de la communauté agricole domestique est construite à la fois, et de façon indissociable, autour
des rapports de production, tels qu’ils s’édifient à partir des contraintes économiques imposées par
l’activité agricole, entreprises dans les conditions définies par le niveau des forces productives et autour
des rapports de reproduction nécessaires à la perpétuation de la cellule productive. » (p. 65)
On peut discuter de la pertinence du concept de mode de production domestique (par rapport à d’autres

approches de ces sociétés), mais la méthode mise en œuvre par Claude Meillassoux me semble légitime,
car l’objet historique à partir duquel il est construit est clairement spécifié : il s’agit de sociétés
précapitalistes dans lesquelles les rapports de parenté sont étroitement imbriqués dans les rapports de
production.
On rencontre ici une autre question de méthode à nouveau très importante dans les sciences sociales :
celle de « la spécification historique », pour reprendre une formule de Karl Korsch (1971). Christine
Delphy fait référence à une « théorie de la connaissance située » qui semble se réduire à la production
d’une analyse sociologique « des endroits précis de la hiérarchie sociale » occupés par un chercheur (p.
26). Ce type d’éclairage - s’il est fait avec prudence - est certes utile, mais du point de vue
épistémologique la question essentielle d’une « théorie de la connaissance située » se trouve ailleurs :
dans l’articulation entre les catégories d’analyse mises en œuvre et « la spécification historique » de
l’objet étudié, car le social n’est pas une donnée qui, dans ses formes de structuration, traverserait de
façon indifférenciée l’histoire des sociétés.
Parlant de son analyse de l’oppression des femmes dans les sociétés modernes en termes de mode de
production domestique, Christine Delphy écrit : « J’ai découvert un aspect de l’économie qui non
seulement n’était pas traité par l’économie politique, mais était considéré comme non-économique par
définition, l’économie étant, dans la définition de la science économique, consubstantielle avec le marché.
Etymologiquement, l’économie est la « règle » (nomos) de la « maison » (oikos) : la gestion du foyer, c’est-
à-dire l’unité de production » (p. 8). Christine
Delphy aurait donc mis à jour une dimension de l’objectivité économique moderne dissimulée, en quelque
sorte, par « la science économique ».
Il ne s’agit pas de prendre au pied de la lettre le discours de la « science économique », pour autant cette
mise en relation de l’activité économique avec le marché ne relève pas d’une « simple révolution
conceptuelle », comme l’écrit Christine Delply (p. 8). Elle est concomitante d’une généralisation des
rapports marchands, de la production pour le marché et d’une restructuration profonde de l’organisation
du social dans ses formes d’existence objectives. Marx a une perception très claire de ce mouvement
historique. Sa « critique de l’économie politique » ne considère pas qu’il s’agit d’une simple « révolution
conceptuelle », même si par ailleurs il remet en cause le discours de l’économie politique classique qui fait
de cette nouvelle sphère du social (l’activité de production pour le marché) un lieu débarrassé des
rapports d’exploitation, pour au contraire rendre compte de l’émergence d’une nouvelle forme
d’exploitation, historiquement inédite.
Cette réorganisation générale du social génère une famille qui n’est plus une oikos, une domus, une «
maison » ; la gestion du foyer devient une activité se réalisant « hors de la sphère économique ». C’est là
une conséquence de ce qui caractérise le capitalisme par rapport à toutes les formes précapitalistes : la «
dissociation » des rapports de parenté d’avec les rapports de production. « Cette révolution conceptuelle
(l’équation économie/marché) a coïncidé avec une transformation de la façon de concevoir les relations
familiales : les rapports affectifs qui en faisaient partie ont été mis au premier plan dans l’idée du mariage
et de la famille. » (p. 8). Ici encore, il ne s’agit pas de prendre au pied de la lettre le discours de la théorie
libérale faisant de la famille le lieu des relations privées, exemptes de rapports de domination et
totalement extérieures à l’État.
Pour autant, la mise en avant de ces « rapports affectifs » n’est pas un simple rideau de fumée, mais
renvoie bien à une profonde transformation des relations familiales à travers lesquelles on assiste à
processus d’mdividuation des différents membres (de « personnalisation » des relations) par rapport aux
familles précapitalistes dans lesquelles les individus sont avant tout spécifiés à travers des relations «
extraconjugales », dans le cadre de réseaux de socialisation spécifiques au groupe des hommes, des
femmes, des jeunes, etc. Nul angélisme dans ces remarques sur les « rapports affectifs » se construisant
dans « l’intimité » de la vie privée : la famille comme « nid de vipères » affectif est également une
invention de la modernité.
Il faut bien comprendre ce qui est en discussion. Il est traditionnel de dire que la famille économique a

perdu certaines fonctions économiques (unité de production), mais en a gardé d’autres (unité de
consommation). C’est l’approche classique d’une certaine sociologie empirique. Mais Christine Delphi
entend remettre en cause ce type d’empirisme pour construire théoriquement le concept d’un mode de
production, domestique en l’occurrence. Compte tenu de la « dissociation » dont je viens de parler, cela
ne va pas sans difficulté. Si l’on ne s’en tient pas à sa définition formelle, on peut repérer une double
argumentation.
Une difficulté dans l’argumentation
Dans la première apparaît une approche de type historico-génétique prenant pour point de départ les
formes précapitalistes. « Historiquement et étymologiquement la famille est une unité de production. [...]
Dans cette unité le père de famille est dominant [...] la famille étant basée sur l’exploitation par un
individu de ceux qui lui sont apparentés ou affiliés par le mariage, cette exploitation subsiste partout où le
mode de production reste familial. » (p. 37). « Avec l’industrialisation, la famille est dépossédée de sa
fonction d’unité de production sauf dans certains secteurs ». En conséquence : « Aujourd’hui,
l’appropriation (par les hommes) de la force de travail des femmes tend à se limiter à l’exploitation Ha
fourniture gratuite pour elles) du travail domestique et de l’élevage des enfants. » (p. 44)
Le processus historique est présenté de façon très linéaire, le passage de la famille précapitaliste à la
famille moderne se traduisant, en quelque sorte, par un simple rétrécissement du champ de l’exploitation
par l’homme de la force de travail des femmes. Disparaissent les ruptures instaurées par la famille
moderne qui concernent non seulement le statut du travail domestique par rapport à la production
sociale, mais également les formes de domination masculine et le statut des femmes. Il est vrai que pour
traiter de ces ruptures, on ne peut en rester au seul niveau dit « économique », il faut prendre en compte
la réorganisation de l’ensemble du corps social et la structuration à travers la famille moderne de cet
espace social historiquement inédit : « le privé », au sens moderne du terme.
Lorsqu’elle met en rapport la famille précapitaliste avec la famille moderne, c’est toute cette dimension
qu’occulte Christine Delphy dont l’analyse est marquée par une forme d’« économisme » que l’on retrouve
d’ailleurs dans son second type d’argumentation concernant l’existence du mode de production
domestique comme « base économique » du patriarcat « dans les sociétés industrielles contemporaines ».
Cette argumentation consiste à employer le terme économique dans son acception la plus courante. «
Toute société doit pour survivre créer des biens matériels (production) et des êtres humains
(reproduction) », explique Christine Delphy. Il s’agit alors de ne pas ignorer la « fonction économique » de
la famille, d’analyser « le travail domestique et l’élevage des enfants comme tâches productives » (p. 33,
34). Au sens très général du terme : découper un morceau de viande et le faire cuire, prodiguer des soins
aux enfants etc., sont des activités de production de biens matériels et de services, donc « économiques ».
Dans ce cas, il n’est plus question de la forme prise par l’activité de production sociale (celle que,
précisément, nos sociétés appellent activité économique) dans la société moderne, mais d’un discours
transhistorique sur l’économie. Dans toutes les sociétés « la parenté est une institution économique » (p.
9). Le travail de déconstruction sociale se réduit alors à démontrer que si « la base économique » de la
famille n’est pas prise en compte et si le travail domestique est perçu comme simples tâches ménagères et
non travail productif, c’est à cause, par exemple, d’une construction arbitraire de la comptabilité
nationale. Reste que, je l’ai déjà signalé, cela ne résout pas le statut « objectif » donné par le capitalisme
au travail domestique. Et, surtout, on voit mal comment passer de ce type d’empirisme sociologique et de
discours généraux transhistoriques sur l’économie à la construction du mode de production domestique,
de ses rapports de production spécifiques comme concepts...
Que faut-il entendre par analyse matérialiste ? « L’un des axiomes, sinon l’axiome fondamental de ma
démarche, est que les femmes et les hommes sont des groupes sociaux », explique à juste titre Christine
Delphy (p. 23). Il est donc nécessaire de rendre compte du rapport social qui structure les femmes comme
groupe social face aux hommes. Étant entendu que les groupes ne sont pas « sui generis, constitués avant
leur mise en rapport. C’est au contraire leurs rapports qui les constituent en tant que tels » (p. 29). Un
 6
6
1
/
6
100%
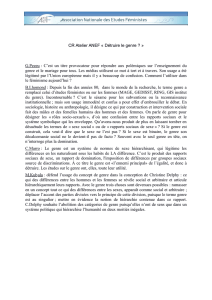
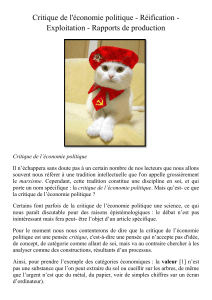

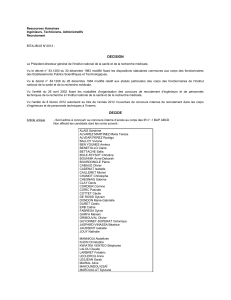
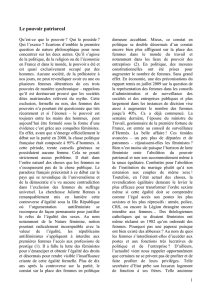
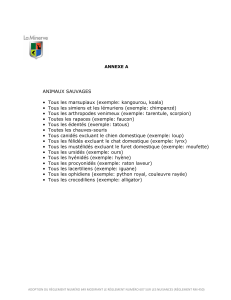
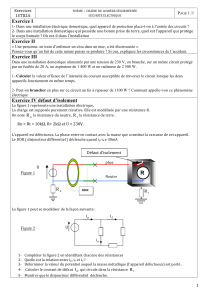
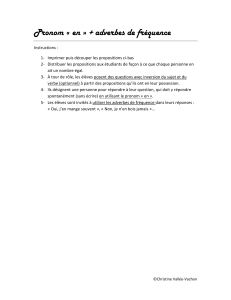
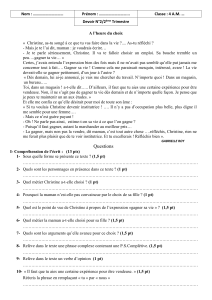
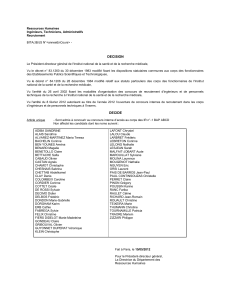
![Programme détaillé [PDF | 190,5 Ko. ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/004209984_1-201b6e73668b585a72cfe5de34f1e9ef-300x300.png)