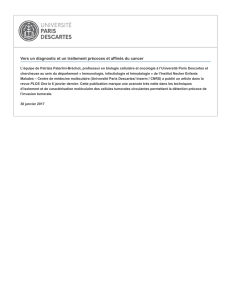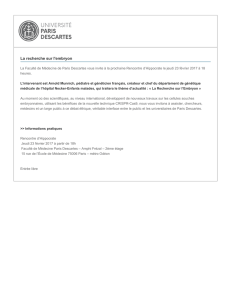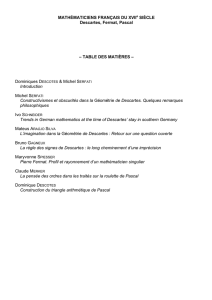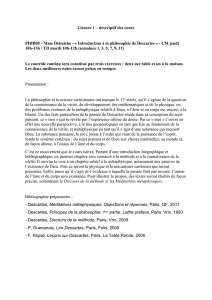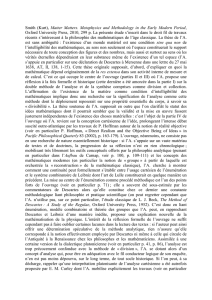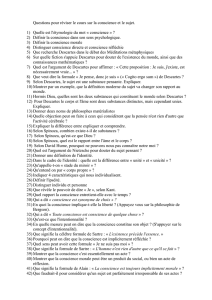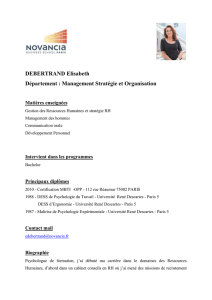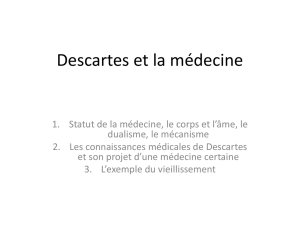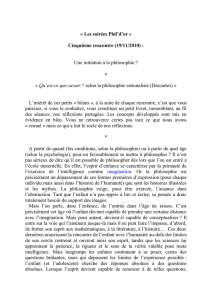Un récit de philosophie-fiction: Le Voyage du monde de M

UN RÉCIT DE PHILOSOPHIE-FICTION :
LE VOYAGE DU MONDE DE DESCARTES
DU PÈRE GABRIEL DANIEL
Jean-Luc SOLÈRE
C.N.R.S.
L
a philosophie est-elle liée à une forme d'expression définie?
Poser cette question revient à se demander ce qu'est la
philosophie: cela est bien trop ambitieux ici. Notons
simplement que, si le dialogue a ses lettres de noblesse, plus on
s'éloigne du simple échange d'arguments en progressant le long de
l'axe de la description, de la mise en scène, du concret, plus un texte
est censé perdre, sans doute à tort davantage qu'à raison, de sa tenue
philosophique. Il est vrai qu'il ne
s'agit
pas là simplement d'une
affaire de dosage du pittoresque dans le sérieux: le narratif tend
à remplacer l'argument par le fait. Peut-on prouver avec des faits
inventés ? Il faudrait se demander si un mythe, une pièce de théâtre,
une fable de La Fontaine, un film ne prouvent pas aussi bien, sinon
mieux, qu'un traité. Toujours est-il qu'à la frontière de la philosophie
et de la littérature, on reconnaît ordinairement que certaines œuvres
démontrent un équilibre heureux entre réflexion et fiction. Pour en
rester à l'âge classique, on pensera naturellement à Fontenelle et
Voltaire. Mais par ailleurs, certaines philosophies offrent mieux que
d'autres prise au travail de l'imagination narrative, à l'élaboration


romanesque, à la disposition de leur contenu en une histoire suivie.
Paradoxalement (du moins en apparence), le cartésianisme,
pourtant synonyme de rationalisme, et même de mécanisme, est de
celles-là. Il a certes pour conséquence de désenchanter le monde :
celui-ci n'est plus que rouages, cordes et poulies1. L'anti-
naturalisme de Descartes remplit le dessein de détruire l'admiration
vulgaire qui porte à s'étonner plus devant le spectacle du monde
que devant le Créateur. D'où la négation de toute force intérieure
à la Nature, au profit, du jeu purement spatial de forces étalées,
du mouvement communiqué de proche en proche, dans le plein,
comme pour un automate hydraulique. On ne saurait non plus
occulter dans les théories de Descartes la dimension de recherche
pragmatique de l'utilité et de l'efficacité, répondant à l'idéal
techniciste qui est le sien, de maîtrise et possession de la nature. Mais
c'est là que se produit un renversement du pour au contre:
l'imagination reprend ses droits, tout de même qu'elle a su s'entendre
avec la science de nos jours pour produire de la fiction.
Dans la physique cartésienne, en effet, on ne perdra plus son
temps à rechercher le principe qui agit dans les choses, on s'enquerra
des principes qui nous permettent d'agir sur les choses. Ou plutôt,
la science « ne se préoccupe pas de savoir ce que sont intrinsèquement
les choses telles que Dieu les a créées, mais de déterminer ce qu'il
suffirait de faire pour en produire de semblables»2. Le mécanisme,
artifice institué pour comprendre la nature et agir sur elle, «se
contente d'imiter ses effets par d'autres voies»3. D'où une
1 Fontenelle exprime à merveille cette nouvelle vision du monde : « Car représentez-vous
tous les sages à l'opéra, ces Pythagore, ces Platon, ces Aristote, et tous ces gens dont
le nom fait aujourd'hui tant de bruit à nos oreilles ; supposons qu'ils voyaient le vol
de Phaéton que les vents enlèvent, qu'ils ne pouvaient découvrir les cordes, et qu'ils ne
savaient point comment le derrière du théâtre était disposé. L'un d'eux disait : c'est une
certaine vertu secrète qui enlève Phaéton. L'autre : Phaéton est composé de certains
nombres gui le font monter. L'autre : Phaéton a une certaine amitié pour le haut du
théâtre; il n'est point à son aise quand il n'y est pas. L'autre
:
Phaéton n'est pas fait
pour voler, mais il aime mieux voler que de laisser le haut du théâtre vide (...) A la fin,
Descartes et quelques autres modernes sont venus, et ils ont dit : Phaéton monte, parce
qu'il est tiré par des cordes, et qu'un poids plus pesant que lui descend».
(Entretiens sur la pluralité des mondes habités, 1ère soirée).
2 N. Grimaldi, L'Expérience de la Pensée dans la Philosophie de Descartes, Vrin, 1978,
p.
180.
3 F. Alquié, La Découverte métaphysique de l'Homme chez Descartes, PUF, 2e éd., 1966,
p.
115.

disjonction entre l'ontologique et
l'objectif,
renforcée par la thèse
de la création des vérités éternelles
:
ce que nous connaissons comme
objet n'est pas l'être même, qui est radicalement transcendant. De
là une déréalisation certaine du monde, collaborant à son
explication4. Le mécanisme intégral est ce que nous appellerions
aujourd'hui un modèle : une structure d'intelligibilisation, non pas
une photographie, du réel. Il est
fictif,
non pas faux. Mais du fictif
à la fiction, il n'y a qu'un pas.
Dans son portrait peint par Weenix, Descartes choisit comme
devise, qui figure sur le livre qu'il tient ouvert, Mundus est fabula,
« le monde est une fable ». Il faut prendre au sérieux cet avertissement
des Principes
:
«je désire que ce que j'écrirai soit seulement pris pour
une hypothèse, laquelle est peut-être fort éloignée de la vérité
;
mais
encore que cela fût, je croirai avoir beaucoup fait, si toutes les choses
qui en seront déduites, sont entièrement conformes aux expériences :
car si cela se trouve, elle ne sera pas moins utile à la vie que si elle
était vraie, pource qu'on s'en pourra servir en même façon pour
disposer les causes naturelles à produire les effets qu'on désirera5».
Descartes va même jusqu'à annoncer : «Tant s'en faut que je croie
toutes les choses que j'écrirai que même je prétends en proposer
ici quelques unes que je crois absolument être fausses6». Il croit
vraie, en tant que chrétien, la description biblique d'un univers créé
dès son premier instant en un état de perfection, d'achèvement. Il
sait donc fausses ses «suppositions» d'une matière créée d'abord
uniforme, divisée seulement en parties égales, mues par Dieu d'un
mouvement constant, et d'un engendrement mécanique de la
configuration de l'univers7. Mais «leur fausseté n'empêche point
que ce qui en sera déduit ne soit vrai», c'est-à-dire qu'à partir de
l'irréel «chaos des poètes» («une entière confusion de toutes les
parties de l'univers»), «on pourrait toujours démontrer que, par
leur moyen, cette confusion doit peu à peu revenir à l'ordre qui est
à présent dans le monde8». De même le Traité du Monde se
4 Cf. F. Alquié, op. cit., tout le ch. VI.
5 III, 44, AT IX, 123. Nous citons Descartes d'après l'édition Ch. Adam-P. Tannery (notée
AT,
suivi du tome et de la page) des Œuvres de Descartes, Vrin-CNRS, 1964-1974.
6 III, 45, AT IX, 123.
7 III, 46, AT IX, 124-125.
8 III, 47, AT IX, 125-126.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%