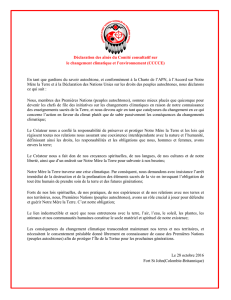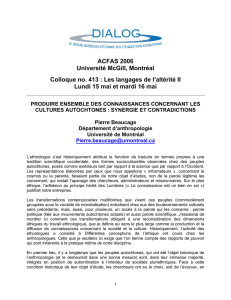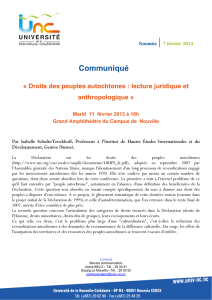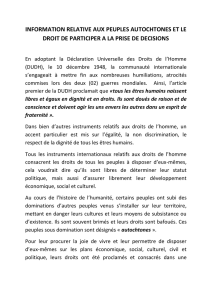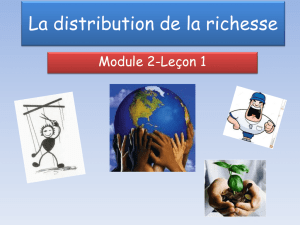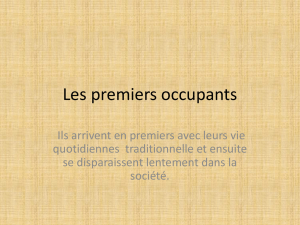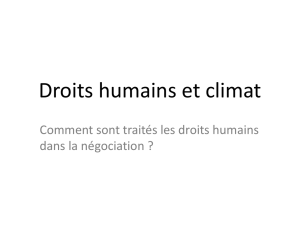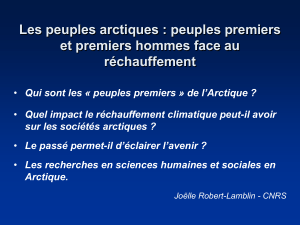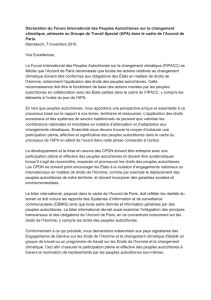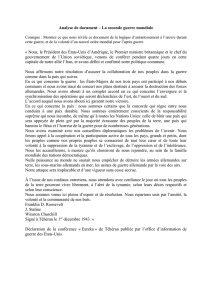Sadyaq Balae! L`autochtonie formosane dans tous ses états

Table des matières
Préface et remerciements............................... XI
Introduction ........................................ 1
L’anthropologie politique à l’ère de la mondialisation ......... 2
Anthropologie et autochtonie........................... 4
La nation et l’ État en anthropologie...................... 9
La question de Taïwan en anthropologie................... 12
Grille d’analyse...................................... 14
CHAPITRE 1
Les autochtones formosans ....................... 17
Les identités contestées ............................... 20
Les conditions sociales
des autochtones à Formose .......................... 28
Trois villages, un projet de recherche...................... 28
CHAPITRE 2
Formose comme terre d’Océanie ................... 35
L’Océanie en anthropologie : Big Men et chefferies ........... 37
Colonisation et décolonisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Les Sadyaqs : une société océanienne de Formose ............ 42
Politique du Formose océanien.......................... 43
Famille et rapports de sexe ............................. 46
Société de partage.................................... 51
Ancêtres et esprits : la sorcellerie ......................... 54
Gaya : la loi incorporée ................................ 57
Conclusion......................................... 62

VIII
SADYAQ BALAE !
CHAPITRE 3
L’histoire de la perte de souveraineté................ 65
Les Sadyaqs à l’aube de la colonisation .................... 67
Formose sous l’administration japonaise................... 71
Transition à la République de Chine...................... 79
Autochtonie en République de Chine..................... 82
Les mouvements sociaux
et la bureaucratisation de l’autochtonie ................. 85
Conclusion......................................... 88
CHAPITRE 4
La possession de la terre.......................... 91
Gaya et le système foncier sadyaq ....................... 93
Colonisation et nouveaux régimes territoriaux .............. 95
Le développement et l’arrivée des Taïwanais
dans les villages sadyaqs............................. 100
L’industrialisation des Tarokos .......................... 101
Skadang et Xoxos face à la colonisation.................... 106
« Rendez-nous nos terres ! » : manifestations contre
le parc national ................................... 109
La chasse autochtone ................................. 111
Conclusion......................................... 116
CHAPITRE 5
Élections sur le territoire autochtone ............... 119
Institutions coloniales et chefferies ....................... 122
Élections sous la République de Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Clientélisme et relations ethniques ....................... 125
Perspectives ethnographiques sur les élections locales ......... 127
2006 : conseil de canton ............................... 130
Élections à la mairie du village .......................... 134
Corruption et luttes entre factions à Ren’ai................. 136
Élections législatives et présidentielles ..................... 139
Conclusion......................................... 142

Table des matières IX
CHAPITRE 6
Développement et associations communautaires ...... 147
Une archéologie du développement ...................... 150
Les associations agricoles d’aujourd’hui.................... 154
Chômage et développement : l’énigme d’un projet d’emploi.... 161
Développement de l’écotourisme à la rivière Skadang......... 165
Les autres acteurs du développement ..................... 171
Conclusion......................................... 174
CHAPITRE 7
La rectification des noms et l’autonomie ............ 177
Archéologie de l’autodétermination autochtone ............. 179
Débats constitutionnels et législatifs sous l’administration
PDP, 2000-2008.................................. 185
Ethnogenèse I : les Tarokos ............................. 189
Ethnogenèse II : les Sediqs ............................. 196
L’avenir de l’autonomie autochtone ? ..................... 202
Conclusion......................................... 205
CHAPITRE 8
L’esprit international de l’autochtonie .............. 207
Autochtonie formosane et enjeux plus larges................ 210
L’internationalisation dans la longue durée ................ 212
Globalisation et rêves autochtones ....................... 217
Le Réseau de la durabilité autochtone à Taïwan ............. 219
Conclusion : Spiritualité et revendications autochtones........ 224
CONCLUSIONS
Conclusion scientifique ............................... 227
Conclusion morale .................................. 232
Références .......................................... 235

Introduction
Sadyaq balae ! Ces deux mots étranges, suivis d’un point d’exclamation,
signifient « les vrais hommes » dans la langue sadyaq. Cette phrase au
ton exotique, autrefois inconnue de la plupart des Taïwanais autant
que des Occidentaux, semble familière aux yeux des amateurs de cinéma
depuis les festivals du film de l’automne 2011. Un film portant le même
nom (Warriors of the Rainbow : Seediq Bale), tourné par le réalisateur taïwa-
nais Wei Te-sheng sur le sujet historique de l’incident de Musha (1930),
fut sélectionné pour un prix au Festival du film de Venise. Les organisa-
teurs de ce festival, certainement sous la pression diplomatique chinoise,
ont décrit le film et le réalisateur comme étant de « Taïwan, Chine », ce qui
provoqua immédiatement des protestations de la part du gouvernement à
Taipei (Frater, 2011). Les organisateurs trouvèrent finalement un
compromis en inscrivant : « Taipei cinese ». À Toronto, le film fut étiqueté
simplement comme venant de « Taïwan ».
L’incident de Musha, le sujet du film, était le soulèvement à Formose
d’un groupe aborigène contre les Japonais le 27 octobre 1930, et n’avait en
fait aucune relation avec la Chine. Depuis l’entrée en vigueur du traité de
Shimonoseki en 1895, l’île de Formose (Taïwan) faisait juridiquement
partie du Japon. Les aborigènes de l’île, qui avaient gardé leur autonomie
sous la dynastie Qing, n’avaient donc jamais de leur vie été soumis aux
institutions étatiques. Aussi ont-ils résisté avec acharnement à l’imposition
de l’État japonais jusqu’en 1914. Musha, habité par les anciens chasseurs
de têtes, était déjà perçu en 1930 comme un village modèle et la preuve
que l’administration japonaise était plus humaine et plus efficace que
l’administration britannique ou française dans les colonies d’outre-mer.
Au moment de l’incident de Musha en 1930, la grande majorité des
Sadyaqs ne parlaient alors que le sadyaq et le japonais. Si les dirigeants du
soulèvement étaient conscients de l’existence de la République de la Chine
– ce qui n’est même pas certain –, cet État ne représentait pour eux qu’un
pays lointain et étrange. Pour les Sadyaqs, les enjeux importants étaient
plutôt d’obtenir une récompense adéquate pour le travail de corvée et le
manque de respect des officiers japonais envers les femmes sadyaqs. Le
colonialisme japonais étant un affront aux valeurs égalitaires et sociales de

2
SADYAQ BALAE !
leur société sans État et à leur loi sacrée, la Gaya, leur résistance ne signifiait
aucunement un attachement aux grandes idéologies nationalistes de la
Chine. Les attentes de la Chine, en réclamant ce film comme chinois à
Venise, démontrent très bien les dimensions politiques des produits cultu-
rels, mais aussi de la mémoire sociale. Dans les interprétations nationalistes
postérieures à l’événement, l’incident de Musha était un acte de résistance
anticoloniale contre le Japon, donc simplement un chapitre du grand récit
de la lutte chinoise contre l’impérialisme japonais. Dans cette vision natio-
naliste, Formose faisait toujours partie intégrante de la Chine. Cette idéo-
logie ne représente pas les perspectives autochtones. Pour les Sadyaqs, à
l’instar des autres groupes autochtones de l’île, le noyau de l’histoire était
plutôt leur relation changeante avec les États successifs sur Formose, la
Chine étant une puissance coloniale au même titre que le Japon ou les
Pays-Bas.
Les Sadyaqs et leurs attentes envers l’État constituent donc le sujet
de ce livre. Cette ethnographie, le produit de 18 mois de recherche sur le
terrain à Taïwan entre 2004 et 2008, montre comment les Sadyaqs sont
devenus un peuple autochtone à travers leur relation historique avec les
États japonais et chinois depuis 1895. En effet, les Sadyaqs, qui sont origi-
nellement une société égalitaire, démocratique et sans institutions politi-
ques, ont développé des rapports particuliers avec l’État tout d’abord
japonais, puis chinois et, graduellement, taïwanais. Leur entrée dans
l’autochtonie internationale est le stade le plus récent de leur statut poli-
tique en évolution constante. L’étude de ce processus historique fait partie
de l’anthropologie politique.
L’ANTHROPOLOGIE POLITIQUE À L’ÈRE
DE LA MONDIALISATION1
L’anthropologie politique est l’étude du pouvoir, soit dans les petites
sociétés (ex. : Godelier, 1982 ; Sahlins, 1976), soit dans les États modernes
(ex. : Abélès, 1992), ou encore dans les relations conflictuelles entre les
1. Suivant Abélès (2008 : 8), j’emploie la notion de mondialisation pour les échanges
commerciaux et les relations politiques dans la longue durée historique, et cela
dans le sens braudélien d’économie-monde. La globalisation, dérivée de l’anglais
globalization, fait plutôt référence aux mutations économiques et politiques qui
accompagnent le nouveau système interétatique depuis 1945 et qui se sont inten-
sifiées à cause de la montée récente du néolibéralisme. Selon cette définition, les
activités mercantiles de la Vereenigde Oost-Indische Compagnie à Formose
pendant le e siècle faisaient partie de la mondialisation, tandis que la participa-
tion actuelle des autochtones formosans à l’ONU fait partie de la globalisation.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%