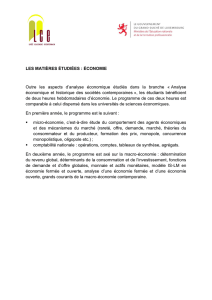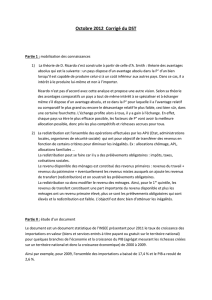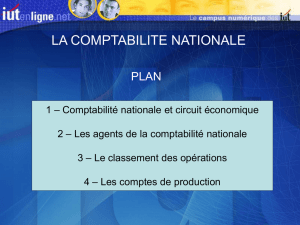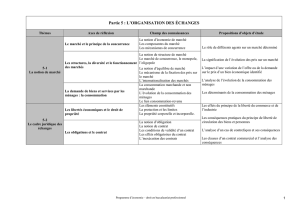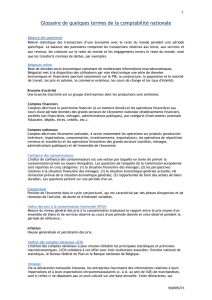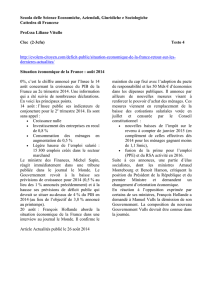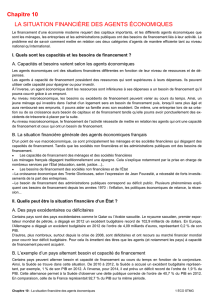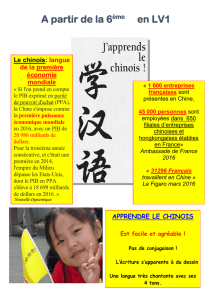cours macro LEA (partie 1)

UNIVERSITE DE PARIS X – NANTERRE
TELEDIX LEA 1
ER
CYCLE
B1LNTR24
INTRODUCTION A LA MACRO-ECONOMIE
Cours rédigé par Guillemette de LARQUIER
1
2004-2005
Avant-propos aux étudiants de Télédix............................................................................................................... 2
1. Introduction générale ....................................................................................................................................... 2
A – Micro-économie versus Macro-économie.................................................................................................... 3
B – L’économie résumée en un syllogisme......................................................................................................... 4
C – Un premier modèle macro-économique ....................................................................................................... 4
2. Agents et flux du circuit économique .............................................................................................................. 6
A – La double circulation des flux...................................................................................................................... 6
B – La représentation macro-économique selon la Comptabilité nationale........................................................ 8
1. Les catégories d’agents de la Comptabilité nationale................................................................................ 8
2. Les opérations et les agrégats de la Comptabilité nationale.................................................................... 10
3. Le calcul des soldes : capacités et besoins de financement ...................................................................... 12
C – La richesse nationale créée et à distribuer.................................................................................................. 14
D - Conclusion en une égalité fondamentale..................................................................................................... 19
3. Les fonctions de l’État .................................................................................................................................... 20
A – La fonction de production non marchande................................................................................................. 21
1. De l’État producteur aux dépenses gouvernementales............................................................................. 21
2. Les biens collectifs .................................................................................................................................... 21
B – La fonction de redistribution ...................................................................................................................... 24
1. Prélèvements et prestations....................................................................................................................... 24
2. Assistance versus Assurance ?.................................................................................................................. 26
C – Deux résultats des actions publiques.......................................................................................................... 29
1. La distribution des revenus....................................................................................................................... 29
2. L’équilibre budgétaire des APU :............................................................................................................. 31
4. Consommation, épargne et investissement ..............................................................Erreur ! Signet non défini.
A – L’arbitrage consommation/épargne....................................................................Erreur ! Signet non défini.
1. Définitions......................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
2. L’acte premier : consommer ou épargner ?...................................................... Erreur ! Signet non défini.
3. La propension à consommer est-elle immuable ?............................................. Erreur ! Signet non défini.
B - Investissement des entreprises ............................................................................Erreur ! Signet non défini.
1. Investissement de remplacement / investissement net ....................................... Erreur ! Signet non défini.
2. Pourquoi l’investissement est-il si fluctuant à court terme ?............................ Erreur ! Signet non défini.
5. Les politiques économiques et leurs théoriciens......................................................Erreur ! Signet non défini.
A – La croissance......................................................................................................Erreur ! Signet non défini.
1. Perspective historique....................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
2. Les facteurs de la croissance ............................................................................ Erreur ! Signet non défini.
B - Le carré « magique » de Kaldor..........................................................................Erreur ! Signet non défini.
1. Pourquoi éviter un solde commercial déficitaire ? ........................................... Erreur ! Signet non défini.
2. Deux fléaux macro-économiques : chômage et inflation .................................. Erreur ! Signet non défini.
C – Les grandes écoles de pensée économique et leurs prescriptions de politiques économiques.......... Erreur !
Signet non défini.
1. Physiocrates contre mercantilistes.................................................................... Erreur ! Signet non défini.
2. Les classiques (1770-1870)............................................................................... Erreur ! Signet non défini.
3. Les néo-classiques............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
4. Les keynésiens................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
5. Les marxistes..................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
1
Maître de conférences à l’Université de Paris X – Nanterre, larquier@u-paris10.fr

Introduction à la macro-économie Guillemette de Larquier
Université de Paris X – Nanterre 2
Avant-propos aux étudiants de Télédix
J’ai essayé de rédiger ce cours de la manière la plus pédagogique qu’il m’était possible
en le destinant à des non économistes. Mais, attention, l’économie demeure une discipline
dont la technique et les raisonnements demandent un réel apprentissage qui sera peut être
difficile pour certains. L’économie est certes présente partout dans notre quotidien : on en fait,
on en parle, on la subit. Mais, entre ce que l’on perçoit communément des phénomènes
monétaires ou marchands qui nous entourent et la discipline universitaire qui cherchent à
rationaliser l’ensemble de ces phénomènes, il y a souvent un gouffre pour le non averti.
Dans ce cours, j’ai essayé d’enchaîner les idées, les concepts et les chapitres avec logique.
L’idéal serait que l’étudiant(e) apprenne ce cours à l’aide d’un crayon pour repérer chaque
étape logique et se réapproprier ainsi les raisonnements économiques (simples) qu’il doit
acquérir. Un bon exercice pour tester sa compréhension est de reproduire l’ensemble de ces
enchaînements.
Un certain nombre de données statistiques sont mobilisées dans ce cours : elles sont là pour
illustrer les raisonnements (aider à mieux comprendre la théorie) et pour donner aussi un
aperçu chiffré de la situation macro-économique française, en comparaison avec d’autres pays
(en particulier les États-Unis). Personne n’a à connaître par cœur ces tableaux et graphiques
mais leur ordre de grandeur et leur tendance, si.
Enfin, pour compléter ce cours, on peut lire avec profit le numéro 315 des Cahiers français
(jui-août 2003, La Documentation française, Comprendre l'économie - 1. Concepts et
mécanismes) qui cadre parfaitement avec le programme de cette introduction à la macro-
économie. La lecture des Cahier français n° 317 (nov-déc 2003, La Documentation française,
Comprendre l'économie – 2. Problèmes et débats contemporains) est également conseillée si
on veut aller plus loin. Enfin, l’étudiant(e) est invité(e) à s’aider d’un dictionnaire
d’économie, car certains des concepts économiques que j’utiliserai seront, peut-être à tort,
considérés connus et non explicitement définis. Il y a pléthore de ce genre d’ouvrage, l’un des
plus récents est celui de Claude-Danièle Echaudemaison (Dictionnaire d’économie, Nathan).
1. Introduction générale
Ce cours n’est pas destiné aux économistes ! Il a été conçu comme une initiation aux
principaux concepts macro-économiques (PIB, redistribution des revenus, balance extérieure,
déficit budgétaire, inflation, etc.). Il est important de les maîtriser puisqu’ils sont utilisés par
un grand nombre d’acteurs (hommes politiques, chefs d’entreprise, syndicats, ONG,
journalistes) pour « mesurer » ou « peser » l’état d’un pays, d’une branche professionnelle,
d’un continent. On attend de ces concepts une rigueur scientifique, une objectivité, bref une
neutralité qui permettent des comparaisons internationales (pour répondre à des questions
telles que « le niveau de vie des Britanniques est-il supérieur ou inférieur à celui des
Français ? »). En fait, les concepts macro-économiques sont étroitement liés à la
représentation des économies occidentales telle que proposée par la Comptabilité nationale.
C’est pourquoi ce cours s’attachera au maximum à reprendre les définitions de la
Comptabilité nationale et sa représentation en circuit des flux économiques. Et comme la
consolidation des Comptes nationaux s’est faite à l’époque où la théorie économique
dominante était celle issue des travaux de John Maynard Keynes, implicitement les bases de
cette initiation à la macro-économie seront keynésiennes.

Introduction à la macro-économie Guillemette de Larquier
Université de Paris X – Nanterre 3
Dans cette introduction, nous introduisons l’approche macro-économique. Puis nous verrons
que « faire de la macro-économie » nécessite une opération de réduction de la « réalité »
conditionnée aux hypothèses que l’on a sur le fonctionnement de la société.
A – Micro-économie versus Macro-économie
Pourquoi dans les universités enseigne-t-on dans des cours séparés la micro-économie
et la macro-économie ? Pour la même raison qui justifie que parfois on a besoin d’un plan de
métro, et parfois d’une mappemonde pour le même type de problème : localiser un endroit.
Pour savoir où se trouve la station Sablons, l’information exhaustive sur les latitudes du reste
de la Terre de la mappemonde est inutile (l’information que je cherche est noyée dedans et ne
peut apparaître) ; en revanche, pour situer la Colombie par rapport à la France, ce sont les
informations détaillées du plan du métro parisien qui sont sans valeur (l’information que je
cherche est en-dehors du plan).
Regardons alors ce qu’apporte chacune des deux approches en économie.
L’approche micro-économique consiste à se placer au niveau de l’individu (de manière
virtuelle car on étudie un personnage idéalisé par la science économique, dont le motif
d’action se résume à chercher le plus de satisfaction possible contre le moins de peine
possible). L’homo oeconomicus plongé dans un univers de rareté (ses ressources et son
budget sont limités) cherche à atteindre le plus d’objectifs possibles (eux, sont illimités).
Pour cela il doit arbitrer, renoncer à certains objectifs (« pour acheter l’appartement de mes
rêves, dans les 15 ans à venir je décide de consacrer 33% de mon salaire au remboursement
de mon emprunt et donc d’amputer d’autant ma consommation courante »). L’économiste
imagine ainsi quel est le comportement d’un agent dit rationnel dans tel ou tel contexte
défini par des contraintes techniques ou budgétaires. Cette approche est essentiellement
hypothético-déductive, et donne lieu à des travaux souvent formalisés, mathématiques.
En adoptant une approche macro-économique, on se place au niveau d’une économie
territoriale, une nation. On construit des agrégats, à savoir l’addition ou l’agrégation d’une
multitude d’actions et de décisions individuelles de même type non coordonnées (on
somme toutes les consommations en euros des ménages français). Puis, par le biais
d’observations chiffrées, on cherche à établir des relations stables entre ces agrégats (la
consommation des ménages français est égale à 85% des revenus des ménages français),
alors même qu’aucune rationalité individuelle n’est derrière cette relation (aucun individu
n’a choisi sciemment le pourcentage 85%). C’est un effet de composition : de la multitude
des actions décentralisées, pensées par 60 millions de cerveaux incontrôlables, on suppose
qu’il sort quelques relations stables entre quelques grands types d’actions (produire,
consommer, investir, épargner, etc.). On néglige les décisions individuelles (qu’importe ce
qui les a motivées), on ne retient que le résultat agrégé.
Un dernier exemple : une approche micro-économique du chômage insisterait sur la recherche
d’emploi d’un individu en fonction du montant de son indemnité, alors qu’une approche
macro-économique chercherait à mesurer le coût du chômage en indemnités versées par
l’UNEDIC et en manque à gagner en termes de capital humain (travailleurs) non occupé.
Pour les deux approches, une opération de réduction de la « réalité » est nécessaire. On se
donne un modèle économique, c’est-à-dire un modèle réduit de cette « réalité » qu’aucune
intelligence humaine ne peut maîtriser dans son ensemble et dans ses détails. Qu’est-ce qui
peut résumer la « réalité » française ? L’augmentation du nombre d’immatriculations de
voitures neuves, la durée moyenne d’ensoleillement de la Charente-Maritime, le nombre de
morts du cancer des poumons ? Dans cette énumération, la raison peut nous aider à juger ce
qui est pertinent ou non (et encore ! chacun de ces facteurs a un impact économique,

Introduction à la macro-économie Guillemette de Larquier
Université de Paris X – Nanterre 4
touristique ou de santé publique). Mais avant tout, pour réduire cette « réalité » inextricable, il
y a des choix théoriques à faire, c’est-à-dire des hypothèses à formuler sur le fonctionnement
de la société et sur ce qui la décrit de manière fondamentale (les autres éléments n’apportant
qu’une information inutile, voire parasitaire). Ainsi, l’économiste crée-t-il des modèles
théoriques en retenant certains éléments et en en écartant d’autres qu’il juge négligeables, et il
ne peut faire cela sans révéler sa « conception du monde » (par exemple, il peut estimer que
seuls les marchés régulent l’emploi, que l’État n’est qu’une contrainte externe, et il se
contentera d’introduire un prix rigide, le SMIC, pour représenter son action).
B – L’économie résumée en un syllogisme
Le lecteur aura donc compris qu’il n’existe pas une mais plusieurs théories
économiques (le dernier chapitre du cours en fera un tour d’horizon). Néanmoins, je vais ici
proposer une description de l’économie en un syllogisme
2
assez général qui vise à englober
toutes les approches.
1. À une époque donnée, la production est d’un niveau Y.
2. Or, étant donné les règles sociales en vigueur, il y a distribution de cette
production Y entre les catégories économiques d’agents ; puis, entre eux, les
individus peuvent échanger ce qu’on leur a distribué.
3. Par conséquent, chaque individu i détient une part y
i
de la production et peut
l’utiliser comme il le souhaite : consommation ou investissement.
La production est le point de départ, c’est une donnée technique qui varie suivant les
périodes de l’Histoire et leurs connaissances, c’est une donnée historique. La distribution est
une donnée sociale, c’est ici qu’apparaissent les rapports entre les catégories économiques ou
classes sociales. L’échange est une donnée se situant à un niveau inter-individuel.
L’utilisation du produit est le point final, c’est une donnée individuelle : soit le produit
disparaît définitivement, c’est l’épuisement du produit (la consommation), soit il est réinjecté
dans le processus de production de la période suivante (l’investissement).
On peut, sans beaucoup se tromper, dire que la micro-économie ne fait pas entrer les deux
premiers niveaux dans son champ d’analyse et que la macro-économie néglige l’autonomie
des deux derniers. Selon cette dernière, ce qui se passe au niveau individuel ou inter-
individuel est déterminé par les niveaux supérieurs : l’Histoire, les règles sociales de
distribution des fruits de la production. Donc, même si l’utilisation de ce qui a été produit
reste la finalité de l’économie, il suffit de connaître les structures macro-sociales pour mesurer
cette étape globale ; on considère inutile à l’analyse la connaissances des décisions
individuelles et autonomes d’utilisation du produit.
C – Un premier modèle macro-économique
Nous allons présenter ce qu’on peut considérer comme un des tout premiers modèles
macro-économiques : le tableau économique de Quesnay (1758). Ce modèle, paradoxalement
parce qu’aujourd’hui il est obsolète, achève notre argumentation introductive sur le caractère
contingent d’un modèle économique. Le tableau économique de Quesnay est limité à la
société du XVIII
e
siècle qu’il reproduit et entravé des a priori théoriques de la physiocratie,
mouvement français auquel appartenait son concepteur (cf. chapitre 5). La leçon à en retenir
2
On rappelle qu’un syllogisme est une déduction formelle telle que, deux propositions étant posées (majeure,
mineure), on en tire une troisième (conclusion), qui est logiquement impliquée par les deux précédentes (ex.
Tous les hommes sont mortels; or, Socrate est un homme; donc Socrate est mortel).

Introduction à la macro-économie Guillemette de Larquier
Université de Paris X – Nanterre 5
sera donc qu’aucun modèle macro-économique n’est universel ou hors de l’histoire
3
, et pas
plus celui de la Comptabilité nationale actuelle que celui de Quesnay.
François Quesnay est médecin à la cours de Louis XV, mais à l’époque où la science n’est pas
encore fortement spécialisée, il se prend d’intérêt pour les flux économiques qui irriguent la
société tel le sang qui circule dans le corps humain. Il publie le tableau économique en 1758
(non pas sous la forme représentée ci-dessous, mais sous la forme d’un tableau de chiffres) et
quelques articles dans l’Encyclopédie de Diderot.
Quesnay propose un modèle économique qu’il veut scientifique ; avec le recul, on peut
apprécier sa réduction de la société française sous l’Ancien régime. Économiste physiocrate,
il considère l’agriculture comme la principale source de richesses. A la question « qu’est-ce
qui crée de la valeur ? », la réponse est « la terre ». En effet, vous semez un grain, vous en
récolterez cinquante : il y a bien création (ou production, première étape de notre
syllogisme). En revanche, l’artisanat ou l’industrie ne crée pas, il y a uniquement
transformation. De la sorte, Quesnay distingue trois classes d’agents économiques qu’on
peut ordonner selon leur utilité créatrice : (i) les producteurs (les agriculteurs), la classe utile
qui extrait des richesses de la terre ; (ii) l’industrie, (les artisans, marchands et industriels), les
« stériles » qui ne font que transformer les richesses naturelles ; et (iii) les propriétaires,
(l’aristocratie et le clergé, propriétaires fonciers traditionnels), les « parasites » qui perçoivent
des loyers et des fermages et les dépensent.
La distribution des richesses produites va se faire en suivant un circuit propre aux rapports
sociaux de cette société. Comme point de départ, supposons que les producteurs ont créé des
produits agricoles pour une valeur de 5 écus. Ils conservent une part de cette production, à
hauteur de 2 écus, pour leur propre alimentation et pour semer et produire l’année prochaine.
Ils doivent verser des loyers et fermages à leurs propriétaires pour une valeur de 2 écus et ils
achètent des produits manufacturés pour 1 écu : les agriculteurs injectent ainsi des revenus
dans le circuit. Avec les 2 écus perçus, les propriétaires ne créent et ne transforment rien, ils
ne font que consommer, 1 écu de produits agricoles et 1 écu de produits manufacturés. Les
industriels grâce aux 2 écus de produits manufacturés qui leur ont été commandés, peuvent
acheter pour 2 écus de produits agricoles qu’ils consomment ou transforment.
On peut vérifier dans le schéma ci-dessous (où les rectangles figurent les classes d’agents et
les flèches leurs échanges), que tous les flux se compensent entre ceux qui correspondent à
des entrées (production, loyers, commandes) et ceux qui correspondent à des sorties (achats).
C’est le principe fondamental des représentations en circuit que l’on va approfondir dans le
chapitre suivant.
Schéma 1. Le tableau économique de Quesnay
2
2
2
1
1
1
Propriétaires
Industrie
Producteurs
Le modèle de Quesnay appartient à l’histoire des théories économiques et nous est de peu
3
contrairement à la prétention des modèles micro-économiques qui considèrent la figure et la rationalité de
l’homo oeconomicus comme constantes dans le temps et l’espace.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%