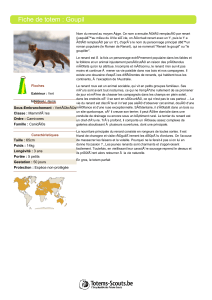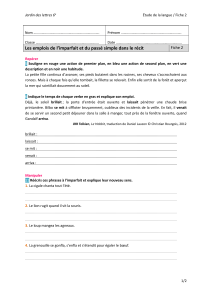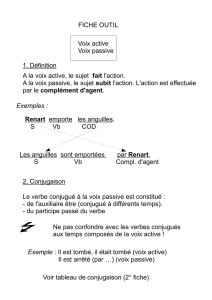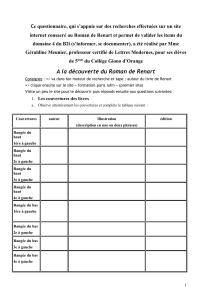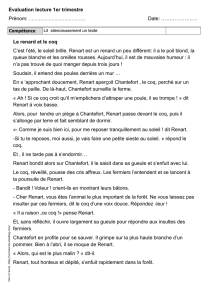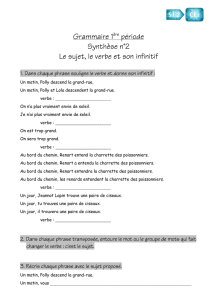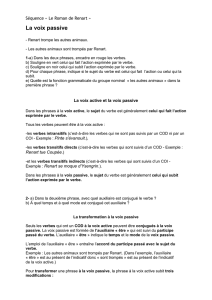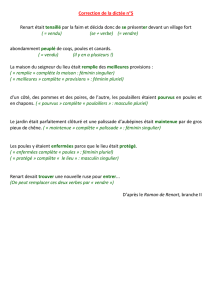Rire au Moyen Âge

© Magnard, 2006
Séquence 5 75
1. Pendant la période féodale, le pouvoir est exer-
cé par les grands seigneurs (comtes, ducs…) dans
leurs provinces et sur leurs terres. Puis, les rois,
suzerains de tous les seigneurs, récupèrent peu à
peu le pouvoir politique (administration, armée,
justice). Le clergé exerce également un pouvoir
important : sur le plan politique il est l’allié des
rois, sur le plan économique il est propriétaire de
domaines sur lesquels il fait travailler les paysans
desquels il tire ses ressources (dîme, produits en
nature…). On se moque des détenteurs du pouvoir
parce qu’ils sont puissants, inaccessibles, secrets,
riches, exploiteurs.
2. Les récits qui font rire sont transmis oralement
par des « récitants » (poètes, troubadours,
jongleurs) mais aussi par écrit (Roman de Renart,
fabliaux).
Situer et comprendre la vie
au Moyen Âge p. 136-137
1. La société médiévale
◗Ces trois illustrations de manuscrits médiévaux
présentent toutes des animaux dans des attitudes
ou des activités humaines.
La première image est une lettrine, un « E ». Elle
illustre un épisode du Roman de Renart, le siège de
Maupertuis. On reconnaît un château fort, des
assiégeants équipés d’écus ornés, une machine de
guerre. Parmi les animaux : porc-épic, chien, âne.
Bien que représentés dans des attitudes humai-
nes, ils ne sont pas habillés comme des humains.
La deuxième image illustre elle aussi un épisode
du Roman de Renart. Un renard, habillé d’un capu-
chon et muni d’un bâton, comme un pèlerin, haran-
gue un auditoire de volailles.
Sur la troisième image, le lion adoube un animal en
présence de ses barons. Là encore les personna-
ges sont très humanisés par leurs attitudes – ils
sont en position verticale – par leurs vêtements,
par leurs activités.
◗Les cibles de ses images sont les chevaliers, le
roi et sa cour, la religion.
Images d’ouverture p. 135
Séquence 5
Rire au Moyen Âge
Lire des textes comiques du Moyen Âge
Cette séquence, qui suit le roman de chevalerie, regroupe les textes du Moyen Âge et du
XVIesiècle qui dénoncent, en se moquant, les institutions ou les personnages de roman
de chevalerie.
La séance 1 permet de situer utilement ces textes dans un contexte historique et social.
Les textes forment comme un écho inversé des idéaux du roman de chevalerie : ils se
moquent des pouvoirs, mettent en scène le peuple dans son quotidien.
p075_090_S5 18/07/06 14:35 Page 75

LECTURE
Pour commencer
1. Ysengrin est la victime naïve. Malgré sa cruauté,
Renart, le rusé trompeur, fait rire.
La ruse de Renart
2. Renart profite de la naïveté d’Ysengrin. Beau
parleur, il convainc Ysengrin d’attacher le seau à sa
queue, sachant très bien que l’eau va geler et
qu’Ysengrin va rester coincé dans la glace. Le texte
suggère qu’il s’agit tout simplement de l’expres-
sion de la cruauté de Renart, toujours prêt à mani-
puler habilement les autres.
3. On reconnaît qu’il s’agit d’une ruse à l’attitude
de Renart : il s’installe « le museau entre les pat-
tes pour voir ce que l’autre va faire » (l. 16-17).
Quand Ysengrin commence à s’affoler parce que le
jour se lève, Renart fait mine d’approuver et l’ap-
pelle « frère » (l. 24) et « mon très cher ami » (l. 24)
pour qu’Ysengrin, le loup, ne se méfie pas. Pour
finir, il raille Ysengrin coincé : « Qui trop embrasse
mal étreint » (l. 27-28) avant de s’enfuir.
4. Le lecteur soupçonne dès le départ l’intention
maligne de Renart qui par ces paroles pousse
Ysengrin à tenter la pêche en insistant sur la pro-
fusion de poissons, surtout que Renart a une répu-
tation de madré et des comptes à régler avec le
loup. Ysengrin ne comprend réellement que lorsque
Renart l’abandonne et le raille. Ce décalage est
destiné à susciter l’amusement du lecteur, il le
rend complice de la ruse.
5. Ysengrin se laisse endormir par les paroles affa-
bles de Renart. Il devance les suggestions de
Renart qui lui montre l’outil qui sert à pêcher pro-
fusion de poissons. Ysengrin est peu méfiant, il
considère Renart comme son compère, il ne veut
pas non plus avoir donner l’impression d’être inca-
pable de pêcher, il veut tenir son rang. C’est lui qui
a voulu pêcher dans le vivier : « le vivier dans lequel
Ysengrin était supposé pêcher » (l. 2-3), et il donne
des ordres comme un seigneur : « Prenez-le d’un
côté […] et attachez-le moi » (l. 11)
Ruse et tromperie p. 138-141
2. Le comique de farce La cruauté
6. Les conséquences sont terribles pour Ysengrin,
il manque y laisser la vie et sa queue coupée lui
procure de la douleur. Le combat est qualifié de
« farouche » (l. 51), la meute de chiens est excitée
par les cris, Ysengrin mène un combat désespéré à
coups de crocs : « triple galop » (l. 42), « se jet-
tent » (l. 43), « excite » (l. 44) et plus loin, « épée
tirée » (l. 46), « attaquer », « frapper » (l. 48), « com-
bat farouche » (l. 51), « coupe net » (l. 52), « mor-
dant » (l. 53), « mourrait de douleur » (l. 55) consti-
tuent le champ lexical de la violence.
7. Le texte ne donne aucune raison au comporte-
ment de Renart qui paraît, par pure méchanceté, se
réjouir du sort du loup.
8. Le comportement d’Ysengrin est héroïque, il se
défend jusqu’au bout, profite que l’épée vient de le
libérer pour s’enfuir, résiste à la douleur. On peut
deviner que, désespéré d’avoir laissé sa queue en
gage, il va chercher à obtenir réparation de la
méchanceté de Renart. Il peut chercher à se ven-
ger ou demander justice.
Pour conclure
9. Plus qu’un bon et un méchant, il y a une victime, un
peu stupide mais héroïque, et un beau parleur cruel
qui se joue de la stupidité et de l’avidité de sa victime.
10. La naïveté d’Ysengrin, l’habileté de Renart, le
loup si effrayant coincé dans la glace puis mutilé,
tout cela amuse.
ÉTUDE DE LA LANGUE
11. Orthographe Le passage correspond aux
lignes 16 à 18 : « Il s’installe alors […] de belle
façon ». Les mots qui n’ont pas changé sont :
« buisson », « glace », « fontaine », « tant que »,
« est », « glaçons ».
Dans « li seaus » (cas sujet), on reconnaît « le
seau », dans le « groing », le « groin », dans « piez »,
on reconnaît « pieds », dans « lors », « alors ». Le
seul mot disparu est « estraine ».
EXPRESSION
12. Écriture Le sujet suggère une vengeance
d’Ysengrin, qui peut avoir à cœur de porter atteinte
à la beauté et l’intégrité physique de Renart : ce
dernier peut être enduit de miel pour attirer les
abeilles, rasé entièrement, teint… Ce sujet peut
aussi être remplacé par le parcours d’oral, le pro-
cès de Renart (p. 152-153 du manuel).
76
© Magnard, 2006
p075_090_S5 18/07/06 14:35 Page 76

© Magnard, 2006
Séquence 5 77
TEXTE ÉCHO
Cet extrait de Pantagruel est à la fois un écho dans
le temps – puisque Rabelais a vécu et écrit au XVIe
siècle – et un écho dans le choix des moyens pour
provoquer le rire : comme dans l’extrait du Roman
de Renart, ce sont la ruse et la tromperie utilisées
par l’un des personnages qui réjouissent le lecteur.
Pour commencer
1. « Faire une farce » : tromper quelqu’un de façon
amusante, pour plaisanter. Nous avions caché le
cartable de notre sœur pour lui faire une farce, elle
n’était pas très contente !
« Jouer un bon tour » : faire quelque chose à quel-
qu’un en employant la ruse, la malice. En lui lais-
sant croire qu’ils avaient oublié son anniversaire, ils
lui ont joué un bon tour : la maison était pleine
d’amis lorsqu’il est rentré.
« Tendre un piège » : cacher quelque chose à quel-
qu’un pour l’amener à se dévoiler. En ne me disant
pas que Jeanne serait présente, il m’a tendu un
piège, m’obligeant à la revoir.
« Préparer une embuscade » : se cacher pour sur-
prendre l’ennemi. L’araignée dans sa toile prépare
une embuscade dans laquelle vont tomber de nom-
breuses mouches.
Des forces inégales
2. Les deux camps ennemis sont Pantagruel et ses
compagnons qui s’apprêtent à débarquer contre six
cent soixante chevaliers.
Sur le navire, on signale la présence, outre celle de
Pantagruel, de Panurge, d’Epistémon et de
Carpalim. C’est bien peu, comparé aux six cent
soixante chevaliers qui arrivent au grand galop.
3. Pantagruel est un géant, doté d’une force
impressionnante. Il a confiance dans ses possibili-
tés : « mais je vous les tuerai comme des bêtes,
fussent-ils dix fois autant. »(l. 5-6).
La ruse de Panurge
4. Panurge met en place un piège dans lequel vont
forcément tomber les cavaliers :
– D’abord, à l’aide de deux cordes fixées à un
treuil, il fait deux cercles, « l’un large, l’autre à l’in-
térieur de celui-ci. » (l. 12). Il remplit de paille et de
poudre à canon l’espace entre les deux cordes.
– Ensuite il laisse les chevaliers pénétrer sur le
navire, dans l’espace limité par les deux cordes.
– Puis, il donne l’ordre à Epistémon de tirer sur la
corde à l’aide du treuil : les cavaliers et leurs che-
vaux tombent.
– Enfin, Panurge met le feu à la traînée de poudre
grâce à la « grenade à feu » (l. 18) dont il s’était
muni, il enflamme la paille et « les fit tous brûler là
comme des âmes damnées. » (l. 36-37).
5. Panurge fait preuve d’inventivité lorsqu’il cons-
truit le piège à l’aide de tout ce qu’il trouve sur le
navire : corde, treuil, paille, poudre, grenade. Son
intelligence est rapide : il met le piège en place
sans hésitation. Il sait diriger ses compagnons :
« Enfants, attendez ici et offrez-vous à ces ennemis
franchement, obéissez-leur et faites semblant de
vous rendre : mais faites attention de ne pas entrer
à l’intérieur de ces cordes ; restez toujours
dehors. » (l. 13-15), « Alors il cria soudain à
Epistémon : “Tire ! Tire !” » (l. 30-31).
6. Dans les paroles de Panurge rapportées direc-
tement, on peut relever des phrases impératives :
« retirez-vous dans le navire » (l. 8), « Avancez vous
autres. » (l. 9), « Enfants, attendez ici et offrez-vous »
(l. 13), « obéissez-leur » (l. 14), « faites attention »
(l. 14-15), « restez » (l. 15), « Tire ! Tire ! » (l. 30-31).
Les verbes sont à l’impératif. Le personnage de
Panurge apparaît comme autoritaire, sachant et
ayant sans doute l’habitude de tenir le rôle du chef.
Des ennemis anéantis
7. Les chevaliers font preuve d’une grande naïveté,
d’un manque de discernement : ils se précipitent
sans analyser la situation : « En voyant cela les aut-
res approchèrent, pensant qu’on leur avait opposé
de la résistance à leur arrivée. » (l. 22-24).
8. Leur chute amuse le lecteur qui attendait de voir
comment le piège préparé par Panurge allait fonc-
tionner et qui s’attendait à le voir réussir. Lorsque
Panurge « les fit brûler là comme des âmes dam-
nées » (l. 36-37), la première réaction du lecteur
est de se réjouir de voir un seul homme vaincre un
si grand nombre de chevaliers. C’est un peu la vic-
toire de David contre Goliath, celle d’Ulysse sur le
Cyclope, celle du plus faible sur le plus fort… C’est
aussi la victoire de l’intelligence sur la sottise, de
la ruse sur la trop grande naïveté. Dans un deuxiè-
me temps, certains peuvent trouver que le sort des
chevaliers est bien cruel…
Pour conclure
9. a. Panurge est un homme intelligent qui, plutôt que
d’employer la force pour vaincre, lui préfère la ruse. Il
est présenté comme celui qui sait rassembler ses
compagnons pour les entraîner dans son projet.
b. Comme Renart, il se sort d’un mauvais pas en
employant la ruse. Comme lui (voir le texte précé-
dent de « La pêche aux anguilles », p. 138-139 du
manuel), il sait profiter de la naïveté de ses adver-
p075_090_S5 18/07/06 14:35 Page 77

saires. Comme lui, aussi, il est capable d’élaborer
un piège infaillible et, comme lui, enfin, il n’éprouve
aucune pitié pour ceux qui s’opposent à lui ou qui
ne sont pas de ses amis.
La comparaison avec Ulysse dans l’Odyssée, repo-
se sur la préférence des deux personnages pour
l’intelligence plutôt que la force. Ils utilisent tous
deux la ruse pour vaincre un ennemi qui apparaît
comme prêt à se laisser tromper par plus fin, plus
astucieux que lui. Tous deux apparaissent aussi
comme des chefs, sachant prendre les bonnes
décisions et convaincre leurs compagnons.
Les deux textes correspondent à un cliché du
roman de chevalerie, le départ au combat du preux
chevalier, morceau de bravoure tourné en dérision
dès le Moyen Âge. Le travail sur ces textes peut
s’effectuer en les lisant successivement ou en par-
tageant la classe en deux groupes, la conclusion
s’effectuant en commun.
LECTURE
Pour commencer
1. Pour saisir l’écart, source de comique, il est
nécessaire que les élèves aient en tête le modèle
du chevalier, fort, beau, agile, courageux, au service
des faibles.
Texte 1
2. Le portrait d’Aucassin commence par l’exclama-
tive ironiquement admirative : « Mon Dieu ! comme
lui allaient bien […] le milieu de la porte » (l. 2-6).
Grand, fort, élégant, bien bâti, le jeune homme cor-
respond aux critères physiques des chevaliers de
romans, les termes sont tous positifs.
3. et 4. Après un tel portrait, le lecteur s’attend à un
comportement exemplaire et héroïque d’Aucassin,
capable de croiser le fer avec plus d’adversaires, de
se jeter sans trembler dans la mêlée. Mais le deuxiè-
me paragraphe accumule les négations : « N’allez
pas vous imaginer […] ni […] pas le moins du
monde […] ne [ …] même pas » (l. 7-9). Elles mar-
quent l’opposition entre l’apparence et le comporte-
ment du jeune homme, tellement amoureux qu’il en
oublie tous ses devoirs, et surtout l’ironie de l’auteur
qui s’adresse directement au lecteur en démentant
ses attentes. « N’allez pas vous imaginer… » (l. 7).
5. Les verbes de pensée « songeait » (l. 7), « pen-
sait » (l. 10), « oubliait » (l. 10), ont pour sujet
Aucassin. Les verbes d’action « emporta » (l. 13),
« s’élança » (l. 14), « mettent » (l. 15), « empoignent »
(l. 16), « arrachent » (l. 16-17), « emmènent » (l. 17)
ont pour sujet le cheval ou les ennemis et Aucassin
pour objet. Ce changement de construction cor-
respond à la mise en œuvre dans le récit de l’échec
d’Aucassin : échec à se battre, échec à être che-
valier. Le jeune homme est un jouet passif. Du che-
valier, il ne montre que l’apparence.
Des chevaliers ridicules p. 142-143
3. La parodie du chevalier
78
© Magnard, 2006
p075_090_S5 18/07/06 14:35 Page 78

Texte 2
6. L’équipement de Trubert se compose de lances,
écu, éperons, arçon, heaume, cheval. Tout son équi-
pement semble animé d’une vie propre et échappe à
son contrôle, créant ainsi l’image d’un chevalier inex-
périmenté : il serre les jambes autour de son cheval
pour se retenir et son cheval « fait un bond de trente
pieds en avant » (l. 6-7) ; « Ses lances bringuebalent »
(l. 8), « son écu le heurte » (l. 8-9), son heaume « a
pivoté » (l. 13). Voilà un chevalier bien ridicule et en
grande difficulté !
7. Les spectateurs interprètent la demande de
Trubert comme signe de sa bravoure et de sa
valeur, comme l’indique « Tous se signent, émer-
veillés » (l. 3), alors que Trubert s’est surarmé par
crainte, pour mieux se protéger. C’est en fait un
signe de sa lâcheté.
Pour conclure
8. Aucassin et Trubert possèdent l’équipement du
chevalier, la prestance, mais le courage et la moti-
vation leur font cruellement défaut : ils sont les
jouets, non les acteurs des événements. L’ironie est
perceptible dans les deux textes : les deux auteurs
feignent d’admirer dans les premières lignes les
magnifiques chevaliers pour mieux les mettre en dif-
ficulté ensuite. Le comique de situation est souligné
par les comparaisons « Dieu n’a pas fait le lièvre
assez agile pour courir aussi vite qu’il l’emporte »
(texte 2, l. 10-11), la juxtaposition et l’accumulation
des actions marquent la vivacité de la scène.
ÉTUDE DE LA LANGUE
9. Vocabulaire Il tua des milliers d’ennemis / Elle
était plus belle qu’une déesse / Son cheval filait à
la vitesse de l’éclair / D’immondes pustules défi-
guraient son visage / Son épée creusa dans le roc
une profonde entaille / Il dévorait chaque matin
sandwichs, céréales, saucisses, œufs sur le plat,
tartines de confitures, sardines à l’huile…
10. Grammaire Le trésor : COD du verbe « empor-
ter » / un étrange personnage : sujet du verbe
« vivre » / les enfants : sujet du verbe « observer »
/ l’ : COD du verbe « observer » / ce portrait : sujet
du verbe « comporter ».
EXPRESSION
11. Écriture Le sujet propose de suivre la structu-
re du texte d’Aucassin pour faire ressortir le
contraste entre apparence et réalité. Certains des
procédés d’écriture pourront être imposés : accu-
mulation, exclamation, réflexion à l’intention du
lecteur…
LECTURE
Pour commencer
1. Les élèves penseront sans doute aux Fables (le
lion roi), aux dessins animés comme Shrek (le chat
botté voleur, le percepteur des impôts) et bien sûr
au Roman de Renart.
Des animaux symboliques
2. Les animaux sont réunis à la cour du roi, Sire
Noble, le lion, malade. Sont aussi présents Renart,
le renard (le goupil) qui joue les médecins,
Brichemer, le cerf, et Ysengrin, le loup, qui sont les
sujets du roi, ses barons. Les autres membres de
l’assistance ne sont pas nommés.
3. La peau du loup, sa pelisse, la hure du loup, les
babines de Renart, le bois de cerf, la patte du roi :
les personnages ont un aspect animal.
En revanche, ils se comportent comme des
humains : leurs gestes sont humains, ils désignent
de la patte, utilisent un couteau, sont soignés par
des médecins qui utilisent l’urinal pour le diagnos-
tic, vivent dans des habitats humains avec des por-
tes et des salles. Ils éprouvent des sentiments
humains : Renart veut se venger, Ysengrin est
épouvanté et bien évidemment tous parlent. Sous
des traits animaux, on se moque des humains,
l’animalité participe de la mise à distance.
Un remède étrange
4. Renart prétend avoir diagnostiqué la maladie du
roi en observant ses urines et il propose un remè-
de à base de peau de loup, de bois et de peau de
cerf dans le but de se venger. Finalement, il recourt
au remède plus traditionnel de l’ellébore qui délivre
le roi de son indigestion et de ses maux de ventre.
5. Le roi oblige les deux animaux à se plier à ses
ordres : il tente d’abord de les amadouer – « Mon
très cher ami » (l. 23) –, puis ordonne à ses gardes
d’agir. Il ne leur laisse aucune possibilité de se
dérober. C’est un souverain autoritaire.
6. Le roi guérit en pétant, en éternuant, en suant :
la grandeur royal perd de sa prestance, le roi n’est
plus qu’un vulgaire corps malmené. Ce dénoue-
ment ridiculise le roi et, de ce fait, amuse le lecteur.
Une critique du pouvoir féodal
p. 144-145
4. La satire de la société
Séquence 5 79
© Magnard, 2006
p075_090_S5 18/07/06 14:35 Page 79
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%