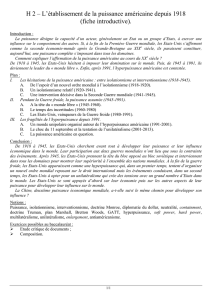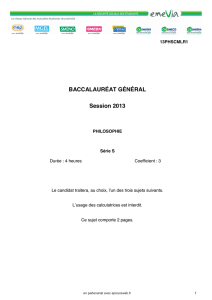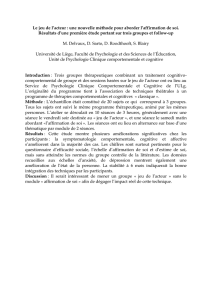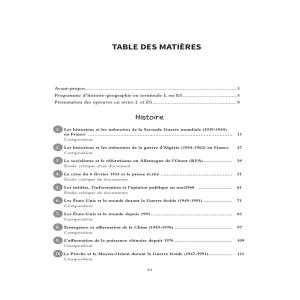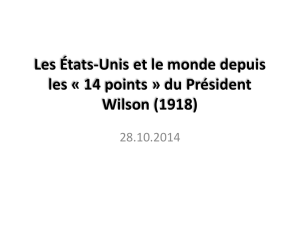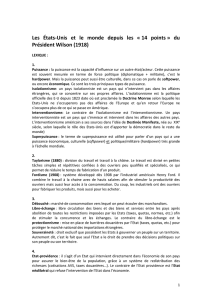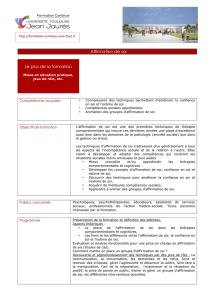ECS1 - DS n°3 (Concours blanc).Corrigé

ECS1 – Concours blanc – Proposition de corrigé
Type : Dissertation sans document d’appui
Sujet : Les Etats-Unis et le monde : l’affirmation de la puissance durant le court vingtième siècle
Exemple d’introduction :
De Théodore Roosevelt qui affirmait au début du XXe siècle « l’Amérique est l’espoir du monde » à
John Connally, secrétaire au trésor en 1971, qui assène en pleine tourmente financière à une
délégation européenne « le dollar est notre monnaie mais votre problème », le rapport des Etats-
Unis au monde apparaît comme complexe et ambigu durant le court XXe siècle. Cette périodisation
de l’histoire, qui circonscrit le XXe siècle à une période allant de 1914 à 1991 selon la vision
américaine d’Eric Hobsbawm, renvoie à un « American Century » évoqué par Henry Luce dans un
article resté célèbre du magazine Life de 1941. En effet, s’il semble évident que le court XXe siècle
est marqué par la puissance américaine reconnue dès ses débuts, la question de son affirmation est
plus complexe à analyser. La puissance d’une nation peut en effet se mesurer par comparaison
d’indicateurs, et il apparaît évident, statistiques à l’appui, que les Etats-Unis deviennent rapidement
la première puissance mondiale. Pourtant, la définition de la puissance doit aussi intégrer les
rapports de domination et d’influence qui la fondent. Aussi, on doit considérer que pour être puissant,
il faut s’affirmer aux autres. La trajectoire des Etats-Unis sur la période d’étude s’inscrit donc dans
une relation au monde marquée par leur volonté d’affirmer leur puissance. C’est donc dans l’écart
entre la réalité de la puissance américaine et sa légitimité à s’affirmer que se lisent les relations entre
ce pays et le monde. La « Fin de l’Histoire », évoquée par Francis Fukuyama en 1992, marquée par
la diffusion à l’échelle mondiale du modèle du leader américain, tendrait à prouver que cette
puissance se serait légitimement affirmée à la fin de la guerre froide. On peut donc se demander si
de 1914 à 1991, l’affirmation des Etats-Unis comme puissance dominante a conduit le monde
à leur reconnaître une légitimité dans ce rôle. De façon plus polémique, le « siècle américain »
est-il celui de l’instauration d’une pax americana ?
La puissance américaine émerge dans la première partie du siècle, partagée entre Destinée
manifeste et doctrine de Monroe (I). Puis, l’étude du rôle joué pendant la Seconde Guerre mondiale
et le rôle de leader du monde libre endossé durant la guerre froide permet d’affirmer la
superpuissance (II). Enfin, il convient de s’interroger sur l’existence d’une hyperpuissance, restée
seule en position hégémonique, et sur ses responsabilités immenses (III).
Exemple de plan :
1. Jusqu’au milieu du siècle, la première puissance mondiale hésite entre interventionnisme et
isolationnisme, entre idéal wilsonien et le pragmatisme hérité de Monroe
Après avoir obligatoirement expliqué les fondements de la puissance étatsunienne et sa place
dans la hiérarchie mondiale, il faut dans cette partie mettre en lumière les contradictions de la
position américaine.
• Le territoire : fondement de la puissance américaine
o Territoire immense, fondement de la puissance ≠ petits territoires européens
o Population en croissance par un apport extérieur ≠ émigration européenne
o Puissance fondée sur l’industrie (2nd RI) ≠ Europe qui s’enrichie par le commerce
• Des rapports avec le monde fondés sur la Doctrine de Monroe qui empêche tout
interventionnisme
o La puissance s’exprime par la mise en valeur du territoire ! pas de projection ≠
Europe qui mesure sa puissance à se projeter (colonisation par exemple)
o Expansionnisme sur le continent américain et le pacifique uniquement !
absence sur la scène européenne, c’est à dire le cœur du monde où le
Royaume-Uni tente de maintenir un leadership qui appartient au passé
o Les désillusions de l’idéal wilsonien ! montre la vision américaine du monde
(Destinée manifeste) mais qui n’est pas défendue ! retour à l’isolationnisme
• Un interventionnisme circonscrit aux intérêts propres du pays

o Dans la tradition du « Big stick » de T. Roosevelt, les Etats-Unis interviennent
quand leurs intérêts sont menacés (télégramme Zimmermann ! intervention en
1917 ; Plan Dawes pour obtenir remboursement des dettes)
o Les crises confirment ce positionnement ! repli sur une stratégie nationale avec
le New Deal par exemple
o Refus d’assurer le rôle de leader face au cloisonnement du monde dans les
années 1930
Transition : Dès 1919, les Etats-Unis sont clairement la première puissance du monde qui se
reconstruit, mais ils refusent d’assumer les responsabilités inhérentes à cette position.
L’interventionnisme est choisi en dernier ressort, il est sinon considéré comme une forme
d’idéalisme. On ne peut donc pas parler d’affirmation même si l’influence est grandissante.
L’intervention de 1941 se fait toujours selon ces principes, mais elle entraine les Etats-Unis à
redéfinir leurs rapports au monde (lire l’article d’Henry Luce).
2. Dans un nouveau contexte, les Etats-Unis s’affirment comme puissance et endossent
rapidement le rôle de superpuissance, protectrice du monde libre
Dans cette deuxième partie, il faut s’interroger sur les raisons qui expliquent l’évolution de la
position américaine et le sens donné à la superpuissance dans un monde bipolaire. Il faut
introduire dans cette partie la nuance entre hard et soft power, pour argumenter sur les
différentes modalités d’affirmation de la puissance.
• 1945 : Un nouveau contexte favorable à l’interventionnisme ?
o Une nouvelle fois, l’affirmation se fait au cours d’un conflit ! risque de retour à
l’isolationnisme ensuite (ONU, multilatéralisme)
o La mise en place de l’affrontement bipolaire donne une légitimité à l’affirmation
de la puissance américaine (Discours de Fulton) qui est cette fois assumée
(postulat de Yalta ! postulat de Riga)
o L’affirmation de la puissance devient le nouveau credo etatsunien (doctrine
Truman) qui se donne les moyens d’agir (résolution Vandenberg)
• Une affirmation conjoncturelle qui s’exprime par le hard power dans le contexte de la
guerre froide
o Réponse à la menace par la stratégie du containment
o Interventionnisme ciblé sur le rimland (Corée, Vietnam contre la menace
communiste mais aussi Suez pour s’affirmer dans son camp) ! contestation de
l’impérialisme (De gaulle)
o Le maintien de l’équilibre ! course à l’armement, course à l’espace…
• Une affirmation durable qui s’inscrit dans la diffusion d’un modèle accepté : le soft
power
o Les outils : Plan Marshall et aides multiples
o L’âge d’or du capitalisme : le modèle est le fondement de la puissance (FMN)
o American way of life, American dream, font la synthèse du modèle (scientifique,
technique, culturel) en assurant sa diffusion ! cocacolonisation ?
Transition : Le contexte de la guerre froide donne une légitimité à l’affirmation de la puissance
américaine. Celle-ci utilise le hard power pour s’affirmer comme rempart et le soft power pour
s’affirmer comme leader. L’affirmation laisse cependant place à une suspicion d’impérialisme qui
devient évidente lorsque la menace s’estompe (détente) ou disparaît (fin de la guerre froide).
3. A la fin de la guerre froide : les limites de l’affirmation d’une puissance hégémonique dans un
monde multipolaire. De l’affirmation légitime à la dénonciation de l’impérialisme
Il s’agit dans cette dernière partie de discuter du rôle d’une puissance en position
hégémonique. Comment affirmer légitimement sa puissance dans un monde sans rival
(monde unipolaire) ou face à des rivaux multiples mais moins puissants (monde multipolaire) ?

• L’affirmation de l’hyperpuissance à la fin de la guerre froide
o L’idéalisme à nouveau mis en échec (politique des bons sentiments de J.
Carter) et le retour du hard power sous R. Reagan
o La victoire américaine consacre le triomphe du pays qui affirme sa puissance
hégémonique
o Un monde unipolaire (hyperpuissance selon H. Vedrine) ou multipolaire ?
• L’affirmation du modèle à travers le processus de mondialisation participe de
l’affirmation de la puissance
o Une puissance technologique réaffirmée dans un monde organisé en réseaux
o L’influence idéologique réaffirmée par la révolution libérale
o Une affirmation réellement mondiale : le monde, nouveau territoire américain ?
• Hyperpuissance, fin de l’Histoire et Pax Americana
o La position d’hyperpuissance : des responsabilités à la hauteur de la puissance
o Unilatéralisme contre multilatéralisme : le intérêts propres peuvent-ils guider
l’interventionnisme américain (Première Guerre du Golfe)
o Pax Americana et impérialisme : la Destinée manifeste ne l’est pas pour tout le
monde ! montée en puissance de nouveaux pôles
Exemple de conclusion :
De 1914 à 1991, les Etats-Unis se sont affirmés comme première puissance mondiale. Triomphant
des affrontements idéologiques face aux totalitarismes, leur modèle s’est imposé au monde justifiant
la thèse de la « Fin de l’Histoire » de F. Fukuyama. Pourtant, les années 1990 s’ouvrent sur un
monde où le multilatéralisme et l’espoir d’une gouvernance mondiale s’accordent mal avec la
position hégémonique acquise par les Etats-Unis. La tentation d’une démarche unilatérale, visant à
instaurer un nouvel ordre américain est grande, même si elle accepte de passer par les voies légales
et notamment l’égide de l’Organisation des Nations-Unies. Après une décennie de multilatéralisme
revendiqué mais souvent dénoncé comme opportuniste pars leurs détracteurs, le débat sur l’attitude
à adopter dans leur rapport au monde est revenu au premier plan face à une situation de crise : en
menant simultanément un repli sur leur territoire et un interventionnisme à l’échelle mondiale après
les attentats du 11 septembre 2001, ils ont démontré qu’ils balançaient toujours entre Monroe et
Wilson.
1
/
3
100%