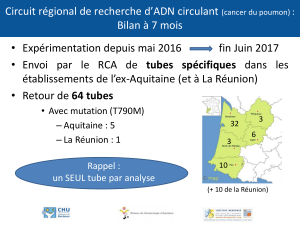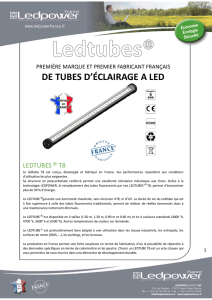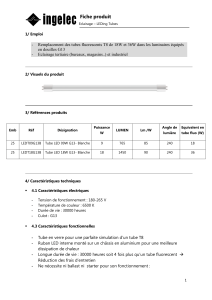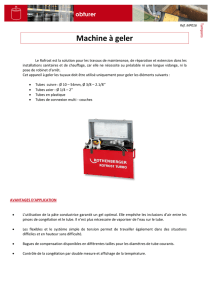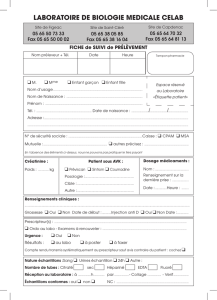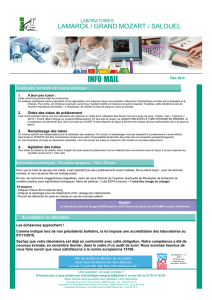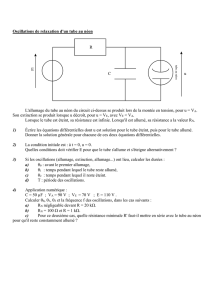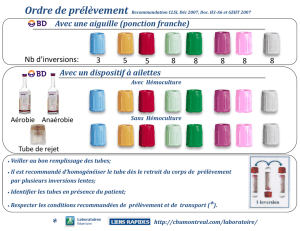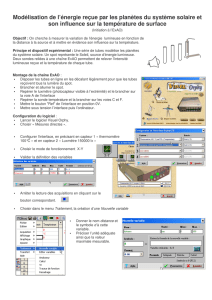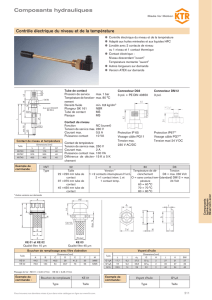Le “néon” sous tous ses états - Association française de l`éclairage

La mise en forme des tubes est
manuelle, les courbures s'obtenant par
des mouvements successifs de flexion
conjugués à l'effet de la flamme du
chalumeau. Cette technique nécessite
une précision et une dextérité faisant
que le métier de “néoniste” restera sans
doute encore longtemps associé à de
l'artisanat.
Les néons ou tubes électrolumines-
cents et fluorescents à cathodes
froides fonctionnent sur le même
principe que les tubes fluorescents basse
tension, dans lesquels des poudres fluo-
rescentes sont excitées par un rayonne-
ment ultraviolet (UV). Peu de gens
savent toutefois qu’il existe du mercure
dans les tubes fluorescents et dans les
tubes néon mercure, sans lequel il n'y
aurait pas d’excitation des poudres par
émission d’UV. Aussi est-il prochaine-
ment prévu l'arrivée des premiers tubes
néon à cathode froide sans mercure.(1)
Comment produire
de la lumière ?
Sans entrer dans les phénomènes d’io-
nisation et d’électrons, le courant passe
par les électrodes comme pour un tube
fluorescent. Une décharge électrique se
produit et le mercure, qui a été préala-
blement basculé dans les extrémités du
tube, produit de l’ultraviolet. La produc-
tion de lumière blanche ou colorée s’ob-
tient grâce à un pelliculage réalisé à l'in-
térieur du tube en verre rempli à très
basse pression (environ 8 à 12 mbar) par
des mélanges de gaz rares comme le
néon et l’argon (dans la plupart des cas,
il est question de 75 % de néon pour
25 % d'argon). Sans les poudrages exis-
tant à l’intérieur des tubes, on obtiendrait
une émission de rouge avec du néon et
de bleu pâle avec de l’argon, l’émission
d'UV restant faible.
A un diamètre de tube correspond
usuellement une intensité de courant
secondaire (23/24 mm en 100 mA ;
18/19 mm en 50 mA). Cependant, si l’on
alimente le tube avec une intensité rédui-
te de moitié (ou même du quart) de sa
valeur standard, on obtient une satura-
tion des couleurs et un affaiblissement
de la luminescence du tube.
Pour obtenir des effets lumineux parti-
culiers sous forme dynamique, on peut,
par ailleurs, contraindre et perturber le
cheminement du gaz en introduisant à
l'intérieur du tube des billes de verre (les
Nord-Américains appellent cela le
“crackle néon”). Toutefois, la présence
d’un corps étranger dans le tube introduit
des impuretés risquant de réduire sa durée
de vie. Enfin, on est également capable, à
l'intérieur du tube, de gérer le flux d'une
manière progressive ou d’intervenir sur la
fréquence (entre 25 et 30 kHz), ceci afin
de créer toutes sortes d’effets.
Comment faire un tube ?
Il existe plusieurs qualités de verre. Le
marché français utilise du borosilicate à
l’intérieur duquel a été réalisé un dépôt
de poudres, la gamme de couleurs étant
particulièrement étendue. Le verre peut
également être teinté dans la masse, pro-
cédé surtout utilisé aux USA (tube
Murano), ce qui donne au tube un aspect
coloré soutenu. Si l’on recherche une
couleur précise, non disponible dans la
palette existante à partir des mélanges
gazeux, certains façonniers peuvent pro-
poser des vernis appliqués à l’extérieur
du verre ou du verre teinté, et ceci est
également réalisable en verre borosilica-
te. La mise en œuvre de ce procédé reste
assez longue et délicate.
La qualité d’un tube dépend fondamen-
talement du pompage et du vide effectué
avant de lui injecter son mélange de gaz
rares. Cela reste un réel souci dans ce
secteur d’activité ! Aussi faut-il recher-
cher le concours d’entreprises utilisant
des stations de pompage récentes,
qu’elles soient automatiques ou semi-
automatiques, le nec plus ultra étant des
stations de pompage automatiques,
puisque le processus, pour faire le vide
et nettoyer le tube de ses impuretés, est
piloté par un programme sachant aujour-
d’hui gérer les températures nécessaires
aux diverses phases du procédé, après le
nettoyage du tube (300 à 320°). En effet,
le verre restitue les bons ou mauvais trai-
tements auxquels il a été soumis, et
nombre de pannes étaient constatées
parce que le pompage n’était pas effec-
tué avec la rigueur suffisante.
La durée de vie totale d’un tube (aux
environs de 20 000 heures) est donc
dépendante de l’équipement du façon-
nier, lequel devrait être en mesure de
produire :
L'image de l'éclairage au néon mérite d'être réhabilitée.
Quelles sont les caractéristiques techniques de ce tube
électroluminescent et fluorescent à haute tension (de 1 000
à 10 000 V) qui peut offrir une importante économie d'énergie
par rapport à d'autres types d'éclairage ? Pour preuve, pour
une installation couleur de 21 m, la consommation effective
est de 575 W contre 800 W en tubes basse tension.
Avantage précieux alors que l'on redevient économe.
Le “néon” sous
tous ses états
(1) La profession effectue des recherches afin
de remplacer le mercure par un autre composé
chimique gazeux non polluant. Les résultats
obtenus sont plutôt prometteurs.
37LUX n° 212 - Mars/Avril 2001
lampes &LUMINAIRES
Perspective nocturne du Palais de la
Musique d’Athènes mis en lumière,
en 1992, par Yann Kersalé, sous
le thème Ecume de Pentélique.
Les variations d’intensité lumineuse sont
indépendantes pour chaque rangée
et ligne des motifs
cruciformes, intégrés en
façade et réalisés en
tubes de néon.

38 LUX n° 212 - Mars/Avril 2001
lampes &LUMINAIRES
• une fiche photo colorimétrique des
performances et des coloris ;
• un certificat annuel de maintenance (ce
qui lui est rarement demandé).
Entre l'incan et la fluo !
Les électrodes sont des éléments sen-
sibles isolés obligatoirement par un
manchon. Contrairement aux tubes fluo-
rescents, elles sont démunies de filament
et ne dégagent qu’une chaleur négli-
geable, d'où l’appellation de tube “à
cathode froide”. Un ou plusieurs trans-
formateurs, calibrés en fonction de la
longueur à traiter, permettent l’alimenta-
tion en série de l’installation(2). Par
exemple, pour un diamètre de 5/6 mm,
avec mélange néon + argon, on peut ali-
menter 5 m de tubes sous 10 kV, tandis
que pour un diamètre de 23/25 mm, tou-
jours en mélange néon + argon, on peut
alimenter 25 m de tubes sous 10 kV.
Pour ce qui est des performances lumi-
neuses, elles se situent entre celles de
l’incandescence et celles des tubes fluo-
rescents. Cependant, on atteint un équi-
libre entre la perception de la luminance
de la source et les effets visuels des
éclairements particulièrement intéres-
sant lorsque l’on recherche un bon
confort visuel. Les diamètres de faibles
dimensions sont utilisés par exemple
pour des applications avec des réflec-
teurs. En effet, pour obtenir un rende-
ment optimisé de la réflexion d’un flux,
la distance de la source au réflecteur doit
être de 4 fois au moins le diamètre du
tube. Ce qui permet la réalisation de
réflecteurs peu encombrants. Il est égale-
ment possible d'appliquer directement,
sur une moitié du tube, une peinture
réfléchissante assurant ainsi l’incorpora-
tion d'un réflecteur interne.
Les rendements lumineux avoisinent
les 1 500 lm/mètre suivant les types de
tubes et 30 à 50 lm/w suivant le type
d’alimentation. Quant à l’allumage/
extinction, il s'opère comme une source
à incandescence sous l’action d'un
simple interrupteur.
Enfin, la gradation, point fort du tube
néon, s’effectue sans altération de la cou-
leur. Possible sur des plages importantes
de par l’absence de starter, elle est pilotée
par un gradateur installé juste avant le
transformateur, tandis que des jeux
d’orgues de lumière peuvent être consti-
tués par des grappes de gradateurs reliés à
une console “DMX”, par exemple.
Il y a blanc et blancs
La régularité d’une température de
couleur est directement reliée à son pro-
cess de fabrication. Une station automa-
tisée autorise, à tout moment, de mesu-
rer la régularité du pelliculage de pou-
drage afin qu’il soit conforme au cahier
des charges. En effet, au moment du
renouvellement d’un tube à l’identique
par le fabricant, il importe de retrouver
la même série et la même formule de
bain, pour obtenir cette constance de la
température de couleur recherchée, des
coordonnées colorimétriques ainsi que
Quelques exemples de Références Température
désignation fabricant de couleurs IRC Lumen/n
Blanc 2 400 K 80
Blanc crème 03 3 300 K 57 1 400
Blanc lumière du jour 10 8 300 K 56 1 280
Blanc nacré 20 6 900 K 78 1 220
Blanc perle 21 4 700 K 65 1 380
Blanc super 28 3 650 K 72 1 660
Blanc brillant 29 5 200 K 80 1 180
Blanc éclairage 30 6 350 K 40 1 550
Blanc 34 10 500 K 84 1 080
Blanc jour 35 8 200 K 80 1 170
Blanc “65” 65 6 700 K 75 1 090
Blanc rose de mai 82 3 500 K 62 830
Tableau 1. Le LCIE (Laboratoire central des industries électriques) procède à
une validation des grandeurs photocolorimétriques, et en particulier des IRC,
qui devront progresser. Si ces derniers varient entre 40 et 85, une demande récente,
émanant de concepteurs, incite les fabricants à enrichir la palette des blancs à des
hauts de gamme leur permettant d'accéder à un excellent rendu de couleurs.
Photo Jean-Marc Charles
Bonjour
la durée de vie !
La durée de vie est un point
fort du tube néon qui se prête
ainsi aisément à un allumage
en continu ou alterné, la
cathode froide présentant
cet avantage de solidité par
rapport au filament très fin des
tubes basse tension à cathode
chaude. Les poudres
fluorescentes tapissant
l'intérieur du tube vieillissent
et s'altèrent en efficacité et
en couleur dans le temps.
Il est donc recommandé de
remplacer les tubes après
15 000 h environ.
De plus, la maintenance des
installations des tubes néon
est tributaire de la fabrication
du tube. Cependant, « lorsque
la station de pompage est
automatisée, on arrive à
d'excellentes performances
de maintenance (en deçà de
1 % sur l'ensemble du parc
d'installations). Interviennent
également les longueurs
maximales unitaires des tubes
qui, si elles se maintiennent en
dessous de 2,5 m, augmentent
les chances d'une durée de vie
prolongée », nous confie
Thierry Barillet de la société
Néon de la Capitale.

39LUX n° 212 - Mars/Avril 2001
lampes &LUMINAIRES
du spectre qui, seuls et ensemble, assu-
rent la fourniture d’une lumière à l’iden-
tique et non métamère. Sont disponibles
sur le marché plusieurs nuances de
teintes de lumière blanche, les tempéra-
tures de couleur allant de 2 400 à plus de
10 000 K (voir tableau 1). On obtient la
différence de ces températures de cou-
leurs et leur IRC (indice de rendu cou-
leur) en intervenant sur la densité et la
qualité des mélanges de lumiphores
fluorescents. Enfin, chaque blanc et
coloris font aujourd'hui l’objet d'une
fiche consignant l’ensemble des don-
nées colorimétriques nécessaires à
l’éclairagiste. MARC DUMAS
(2) On peut alimenter 21 m, voire 25 m, de tubes
développés suivant le diamètre et le mélange
gazeux utilisé à partir d'un seul transformateur.
Références normatives
La norme NF EN 50107, en vigueur depuis octobre 1998, concerne les
installations de tubes luminescents fonctionnant à une tension de sortie à vide
supérieure à 1 kV mais ne dépassant pas 10 kV. Cette norme prescrit que :
- les extrémités anode/cathode sont à connexions mécaniques, à vis ou
équivalent (l'épissure n'est plus autorisée, de même les connexions de
câbles d'alimentation se font par un serrage mécanique) ;
- lors d'implantation de tube en zone inférieure à 2,5 m d'altitude, ces
extrémités sont recouvertes par une protection complémentaire réalisée
à l'aide d'un manchon silicone (ou équivalent) protégeant l'ensemble ;
- les câbles sont protégés électriquement par une gaine de protection
ou comportent une double protection intrinsèque ;
- les transformateurs sont munis de deux types de protection coupant le
primaire du transformateur en 200 ms : soit une protection différentielle en
cas de fuite de courant vers la terre, soit une protection différentielle plus
vide réagissant en cas de fuite vers la terre, mais également en cas de choc
sur le tube, qui entraînerait une rupture du circuit ;
- en cas d'allumage animé, la coupure de sécurité doit également être effective
sur le primaire de l'animateur ;
- suivant les matériaux existant à proximité et suivant les hauteurs dans lesquelles
se trouvent installés les tubes, des distances dans l'air (hauteur des supports) et
les lignes de fuite (distance à la sortie du câble) sont à respecter pour éviter les
vibrations ou les arcs électriques pouvant être créés par la proximité du métal.
Enfin, les composants constitutifs de l'installation sont également sujets à
des normes et protocoles ou modalités d'essais qui deviendront des normes
produits : NF EN 61050, transformateurs pour lampes tubulaires à décharge
ayant une tension secondaire à vide supérieure à 1 000 volts ; ME 102-669,
organe de connexion haute tension ; MME 102-670, manchons de protection
de la connexion d'électrodes, ME 102-671, supports pour lampes à décharge ;
ME 102-662, transformateurs néon installés à l'extérieur ; ME 102-663,
dispositif différentiel pour transformateurs néon.
Photo Jean-Marc Charles
LE NEON DE LA CAPITALE
“La Lumière Inventive”
6, rue Lavoisier 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 51 72 02 - Fax : 01 48 51 62 11
E-mail : [email protected]
Maître d’œuvre de conception : B&A et AYBC - Scénographie : Olivier Massart/LA MODE EN IMAGES
1
/
3
100%