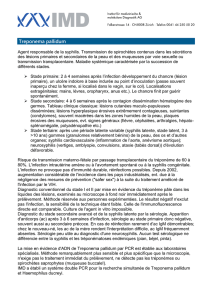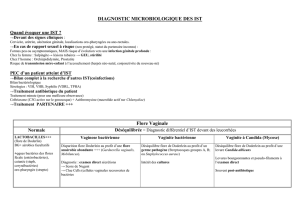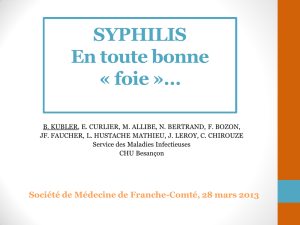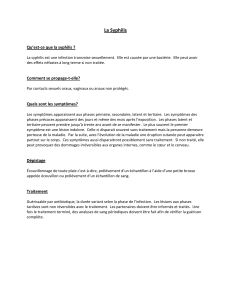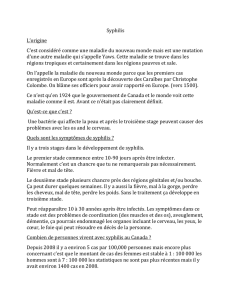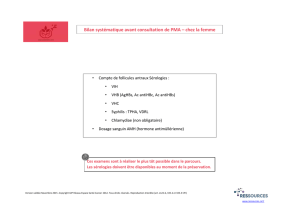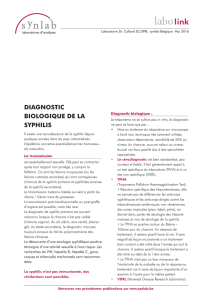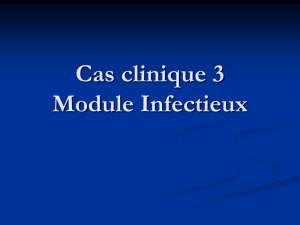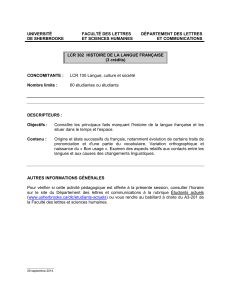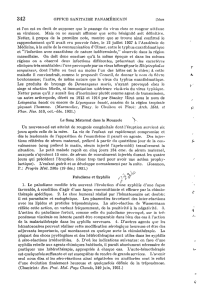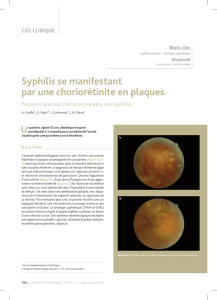Première partie

Première partie
Introduction ………………………………………………………………………
1
Historique …………………………………………………………………………
3
Bactériologie……………………………………………………………………… 5
I. Structure antigénique …………………………………………………… 6
II. Immunopathologie ……………………………………………………… 6
Epidémiologie …………………………………………………………………… 8
I. la syphilis précoce …………………………………………………………
8
II. la neurosyphilis ……………………………………………………………
9
Aspects cliniques ……………………………………………………………… 11
I. neurosyphilis asymptomatique …………………………………………
11
II. Les méningites syphilitiques …………………………………………… 11
III. La méningo-encéphalite chronique ou paralysie générale ……… 13
IV. La méningo-vascularite d’origine syphilitique……………………… 15
V. la striatite syphilitique …………………………………………………… 16
VI. L’atteinte cérébelleuse ……………………………………………………
17
VII. Les gommes syphilitiques ……………………………………………… 17
VIII. Le tabès …………………………………………………………………… 18
IX. les myélites syphilitiques ……………………………………………… 20
X. La pseudosclérose latérale amyotrophique d’origine syphilitique
21
XI. Les manifestations ophtalmologiques ……………………………… 21
XII. Les névrites crâniennes ………………………………………………… 22
XIII. Neurosyphilis et VIH……………………………………………………… 22
Diagnostic ………………………………………………………………………… 24
I. Données biologiques …………………………………………………… 24
II. Données radiologiques ………………………………………………… 30
Traitement ………………………………………………………………………… 33

Deuxième partie
Patients et méthodes ………………………………………………………
36
Observations …………………………………………………………………… 37
Résultats ………………………………………………………………………… 62
I. Données épidémiologiques …………………………………………… 62
II. Données cliniques ……………………………………………………… 63
III. Examens complémentaires …………………………………………… 66
IV. Traitement ………………………………………………………………… 72
V. Evolution …………………………………………………………………… 73
Discussion ………………………………………………………………………… 74
I. Données épidémiologiques ……………………………………………
74
II. Données cliniques ……………………………………………………… 77
III. Données paracliniques ………………………………………………… 87
1. la biologie ……………………………………………………………… 87
2. l’imagerie ……………………………………………………………… 89
IV Traitement ………………………………………………………………… 98
V Evolution …………………………………………………………………… 99
VI Prévention ………………………………………………………………… 102
Conclusion ……………………………………………………………………… 103
Résumés ……………………………………………………………………………
105
Bibliographie ……………………………………………………………………
109

1
Introduction
La syphilis est une maladie sexuellement transmissible répondue dans le
monde entier, due à un spirochète le tréponème pale. La symptomatologie de la
syphilis a évolué au fil du temps, les symptômes étaient essentiellement cutanéo-
muqueux, puis progressivement d’autres localisations ont apparu surtout
cardiovasculaires et nerveuses.
Grâce à l’introduction de la pénicilline à partir de 1946, la fréquence de la
neurosyphilis a diminué parallèlement à celle de la syphilis primosecondaire.
Cependant à partir de 1985 plusieurs publications attirent l’attention sur la
recrudescence de la syphilis et de la neurosyphilis, qui reste un sujet d’actualité
surtout chez les malades positifs pour le VIH.
Toutefois la neurosyphilis continue à sévir au Maroc chez les sujets
séronégatifs pour le VIH. Ceci fait soulever un certain nombre d’interrogation quant
à l’étiopathogénie de la neurosyphilis dans notre pays.
Par ailleurs, dernièrement plusieurs auteurs ont insisté sur la modification de
la présentation clinique de la neurosyphilis. En effet on note une diminution des
formes parenchymateuses au profit des manifestations précoces telles que les
méningites et les méningovascularites. On Peut expliquer cela, d’une part par la co-
infection par le VIH et d’autre part, par un traitement insuffisant de la syphilis
primaire.
Le diagnostic positif, étant basé surtout sur les réactions sérologiques qui ont
connu des progrès considérables, permet l’instauration d’un traitement précoce,
celui-ci est le seul garant d’une guérison en cas de syphilis primosecondaire et d’un
bon pronostic en cas de neurosyphilis.

2
Le but de ce travail est une évaluation de l’aspect épidémiologique, clinique,
thérapeutique et évolutif de la neurosyphilis à travers une série de 19 cas colligés au
service de neurologie du CHU de Hassan II de Fès et de comparer nos données à
celles de la littérature.

3
Historique
La syphilis occupe une place importante dans la pathologie humaine, son
origine exacte est encore discutée de nos jours.
En fait cette maladie a été décrite pour la première fois, fin 1494, début 1495 en
Espagne ou elle aurait été introduite par Cristophe Colomb en 1493 ou par Antonio
de Torres en 1494 au retour du nouveau monde [1].
La syphilis a fait son apparition en 1495 après la prise de NAPLE par l’armée
française, puis elle va se disséminer rapidement dans toute l’Europe au gré de la
dispersion des mercenaires des armées françaises et espagnoles. Ainsi, la syphilis
était dénommée mal de Naples par les français et mal français par les italiens [1].
Aux XVI et XVII siècles, la syphilis est dénommée grande virole. La dénomination de
syphilis s’imposera à la fin du XVIII siècle par analogie au Berger Syphilus,
protagoniste d’un poème de Jérome Fracastor, médecin et philosophe italien.
La vérité historique pourrait être tout autre, puisque Hippocrate avait déjà fourni une
description précise de lésions génitales qui ne semblent pouvoir correspondre qu'au
chancre syphilitique. Plus tôt encore, des lésions osseuses syphilitiques ou
tréponématoses furent mises en évidence sur de nombreux squelettes
préhistoriques , y compris à l'époque du pléistocène (1,8 million d'années à
11 000 ans avant JC).
Au début la syphilis a été confondue avec les autres maladies vénériennes, elle
ne fut distinguée de la blennorragie et du chancre mou que grâce au travaux de
Rollet , Ricard et Fournier. C’est à partir de cette période que l’origine syphilitique
de certaines atteintes viscérales a été établie.
En 1822, Bayle décrivit la paralysie générale, en 1859 Duchenne de Boulogne
décrivit le tabès que Fournier a pu rattaché à la syphilis en 1875.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
1
/
122
100%