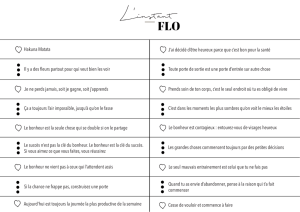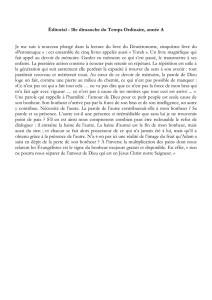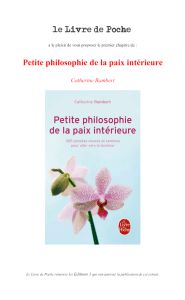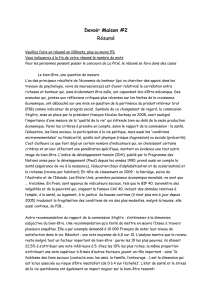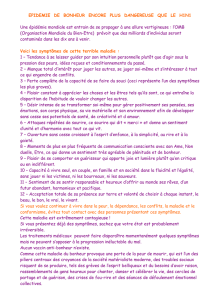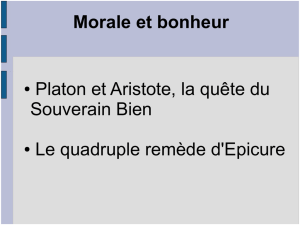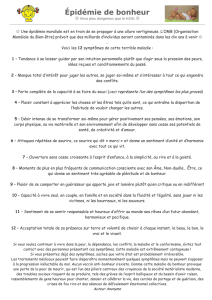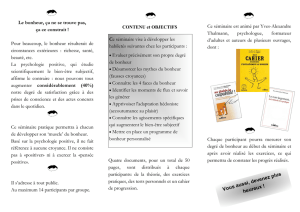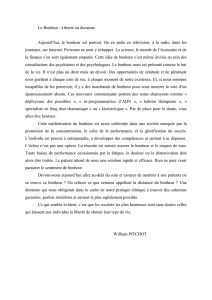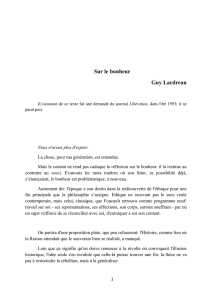La voie du bonheur, le bonheur est de ce monde

CONFÉRENCE PHILOSOPHIQUE
“Plus l’être humain sera éclairé, plus il sera libre.”
Voltaire
LA VOIE DU BONHEUR
Le bonheur est de ce monde
CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN
Association ALDÉRAN Toulouse
pour la promotion de la Philosophie
MAISON DE LA PHILOSOPHIE
29 rue de la digue, 31300 Toulouse
Tél : 05.61.42.14.40
Site : www.alderan-philo.org conférence N°1600-128

LA VOIE DU BONHEUR - LE BONHEUR EST DE CE MONDE
Conférence d’introduction à l’Année Philosophique 2002 sur le Bonheur
conférence d’Éric Lowen donnée le 29/11/2009
à la Maison de la philosophie à Toulouse
Le bonheur, utopie, rêve, illusion ? Cette question est atemporelle, mais la plupart du temps
l’idée du bonheur est parasitée par les croyances religieuses, les conventions sociales et les
fantasmagories égotiques. Pendant des siècles, la plupart des philosophes ont proposé des
définitions du bonheur toutes aussi illusoires en fonction de leurs diverses convictions
métaphysiques. Ce n’est pas plus à la religion de dire ce qu’est le bonheur qu’à la
philosophie, c’est à la nature humaine. Quelle définition pour le Bonheur donc ? Si la notion
de bonheur est encore valable, quels sont les principes qui permettent de l’atteindre, les
obstacles à dépasser ? Cette conférence est un rappel de l’importance du Bonheur dans le
sens de la vie et pour l’épanouissement humain. La vie est trop courte pour la laisser au
malheur.
Association ALDÉRAN © - Conférence 1600-128 : “La voie du bonheur, le bonheur est de ce monde“ - 16/01/2002 - page 2

LA VOIE DU BONHEUR
Le bonheur est de ce monde
PLAN DE LA CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN
Ce n’est point par des plaisirs entassés qu’on est heureux,
mais par un état permanent qui n’est point composé d’actes distincts.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
I LA QUESTION DU BONHEUR
1 - Tout le monde le recherche, mais bien peu semblent y arriver
2 - Ne sommes-nous pas devant un mythe du bonheur ? Ne serait-il pas une illusion ?
3 - Une multiplicité des définitions, conséquence de conceptions erronées
4 - Une situation aggravée par les récupérations idéologiques et mercantiles du bonheur
5 - La nécessité de repenser le bonheur, notamment contre ces ennemis
II HALTE AUX ZÉLATEURS DU MALHEUR !
1 - Les exclusions du bonheur de ce monde-ci, du monde terrestre et de la vie humaine
2 - La culpabilisation du bonheur, le bonheur serait égoïsme
3 - Les détracteurs du bonheur, tout n’est que malheur
4 - Les prétendus bonheurs stoïciens de la résignation passive
III LE PRINCIPE DU BONHEUR
1 - Le principe du bonheur
2 - L’épanouissement humain, résultat de notre évolution individuelle
3 - L’accomplissement du sens de notre vie en accord avec celui de la vie humaine
4 - Un état d’être existentiel intérieur et durable qui transcende les conditions extérieures
5 - Une expérience objective et potentiellement universelle dans la condition humaine
IV BONHEUR ET EXISTENCE HUMAINE
1 - Il est relié aux phases supérieures de la réalisation humaine
2 - Il participe du sens de la vie humaine
3 - Il n’est pas le but de la vie humaine mais la conséquence de l’accomplissement humain
4 - Il ne peut pas se produire artificiellement ou extérieurement
5 - La société peut faire le malheur de l’homme, mais pas le bonheur
6 - Il requiert une qualification de soi, un travail d’évolution et de transformation de soi
7 - Les obstacles au bonheur sont plus à l’intérieur de nous qu’à l’extérieur
V L’INDIVIDUALISATION DU BONHEUR
1 - De l’individualité humaine à l’individualisation du bonheur
2 - Pas de bonheur imposé par la collectivité, ni de bonheur collectif
3 - Un état d’être intérieur commun, mais exprimé dans des champs d’activités divers
4 - Six milliards d’êtres humains, six milliards de chemins menant au bonheur
5 - À chacun de trouver sa voie du bonheur, en harmonie avec la condition humaine,
les autres et le monde
VI CONCLUSION
1 - La légitimité de la recherche du bonheur dans l’existence humaine
2 - Le bonheur est à la portée de tous si nous faisons l’effort d’évoluer dans ce sens
3 - La vie est trop courte pour la laisser au malheur : osons le carpe diem !
ORA ET LABORA
Association ALDÉRAN © - Conférence 1600-128 : “La voie du bonheur, le bonheur est de ce monde“ - 16/01/2002 - page 3

Document 1 : Certains font le tour du monde à la recherche du bonheur sans le trouver, et d’autres,
simplement en faisant le tour du monde ont trouvé le bonheur.
CH. XXXVII
DANS LEQUEL IL EST PROUVÉ QUE PHILEAS FOGG
N'A RIEN GAGNÉ À FAIRE CE TOUR DU MONDE,
SI CE N'EST LE BONHEUR
Ainsi donc Phileas Fogg avait gagné son pari. Il avait accompli en quatre-vingts Jours ce
voyage autour du monde ! Il avait employé pour ce faire tous les moyens de transport,
paquebots, railways, voitures, yachts, bâtiments de commerce, traîneaux, éléphant.
L'excentrique gentleman avait déployé dans cette affaire ses merveilleuses qualités de
sang-froid et d'exactitude. Mais après ? Qu'avait-il gagné à ce déplacement ? Qu'avait-il
rapporté de ce voyage ?
Rien, dira-t-on ? Rien, soit, si ce n'est une charmante femme, qui - quelque
invraisemblable que cela puisse paraître - le rendit le plus heureux des hommes !
En vérité, ne ferait-on pas, pour moins que cela, le Tour du monde ? Jules Verne (1828-1905)
Le tour du monde en 80 jours
Document 2 : À propos de la culpabilisation du bonheur.
Les gens ressentent une culpabilité devant le fait éventuel d'entrer dans la joie et de
connaître le bonheur.
Je ne crois pas que cette culpabilité soit spontanée, et je ne crois pas non plus qu'elle
soit légitime. Ce qui est vrai, c’est qu'elle est fréquente. Elle est fréquente parce qu'elle
est justement diffusée par la culture ambiante ; nous pourrions presque dire par une
culture du mal, une culture de la mort, pour ne pas dire une culture du péché. En effet,
dans la plupart des cas, les gens se disent que si les autres sont dans la peine, dans la
douleur, eux n'ont pas le droit d'être dans la joie et dans le bonheur.
Mais pourquoi n'en auraient-ils pas le droit ? Personne ne nous explique cela. Personne
ne nous explique pourquoi il faudrait être soi-même dans une perspective tragique,
pourquoi il faudrait soi-même se maintenir dans la souffrance, dès lors que la plupart des
autres sont dans le malheur et la souffrance.
En quoi notre propre souffrance pourrait-elle être utile à la diminution de la souffrance
des autres ?
La vérité, c'est que cette culpabilité vient de plus loin. C'est une culpabilité apprise. Il
s'agit presque de la culpabilité de vivre, une culpabilité qui est, peut-être, diffusée par une
culture religieuse, une culture judéo-chrétienne mais peut-être aussi une culture
religieuse bouddhiste, puisque dans le bouddhisme existent les réincarnations et toute
réincarnation est le prix payé pour de mauvaises vies menées antérieurement, pour nos
fautes antérieures. (Notons que cette idée de la réincarnation se retrouve aujourd'hui
dans diverses croyances religieuses occidentales.) On se réincarne dans des réalités soit
humaines, soit animales inférieures, si nous avons été coupables de vols, de meurtres,
etc. Autrement dit, une religion de la métempsycose ou une religion du péché originel,
entraîne l'idée selon laquelle l'être humain est coupable dès sa naissance. Il arrive au
monde, il vit, et il a tort de vivre ! Or, devant une telle croyance, un tel sentiment de
culpabilité, soit de culpabilité fortement et directement vécue, soit de culpabilité diffuse ou
de culpabilité qui nous menacerait, on peut comprendre que les individus hésitent à se
lancer dans le grand mouvement du bonheur, dans la construction d'une vie heureuse.
Alors ils freinent leur vie, ils freinent leur pouvoir créateur, ils ne prennent aucun risque,
ils n'inventent aucune voie nouvelle, ils ne créent aucun nouveau chemin, afin de ne pas
entrer dans un bonheur dont ils croient qu'il serait coupable. De peur que ce bonheur ne
soit quelque chose que l'on prendrait à quelqu'un.
Alors que c'est la vérité contraire qui est juste !
Déjà, le philosophe Alain disait que «notre vrai devoir est d'être d'heureux» ! Robert Misrahi
L'enthousiasme et la joie
Association ALDÉRAN © - Conférence 1600-128 : “La voie du bonheur, le bonheur est de ce monde“ - 16/01/2002 - page 4

Document 3 : Zénon de Citium, philosophe grec (-332,-264) fut le fondateur du stoïcisme, philosophie
intéressante pour son incitation au détachement, à rester centré sur soi et maître de soi. Mais sa conception
du bonheur est austère, rigide, passive, basée sur l'accomplissement de la “vertu”, ce qui en terme stoïcien
veut dire le dédain des plaisirs autant que la souffrance, adoptant une forme d’insensibilité qui est, en fait,
plus un renoncement à l’existence qu’une exaltation de la vie. Examinons le texte suivant de Sénèque.
Tout ce que la constitution de l'univers nous astreint à souffrir, endurons-le en faisant
preuve de grandeur d'âme. Nous sommes engagés à supporter ce qui est propre à notre
condition de mortels, et à ne point nous laisser troubler par ce qu'il n'est pas en notre
pouvoir d'éviter. Nous sommes nés dans un royaume : obéir à la divinité, voilà la liberté.
Donc, c'est sur la vertu que s'édifie le véritable bonheur. Cette vertu, que te conseillera-t-
elle ? De ne pas tenir pour un bien ou pour un mal ce qui ne sera pas un effet de ta vertu
ou de ta corruption. Ensuite, que ni les assauts du mal ni les conséquences du bien ne
puissent te faire changer, afin que, dans la mesure où cela est permis, tu imites la
divinité. Que te promet-elle en récompense de cette entreprise ? D'immenses privilèges,
égaux à ceux des dieux : rien ne te contraindra, rien ne te manquera. Tu seras libre, à
l'abri, préservé.
Tu ne tenteras rien en vain, tu ne seras entravé par rien. Tout cédera devant tes avis, rien
ne te sera contraire, ni ne se produira contre tes vœux et ta volonté. Comment ? La vertu
suffit pour vivre heureux ? Eh ! comment ne suffirait-elle pas, parfaite et divine comme
elle est, comment ne serait-elle pas plus que suffisante ? Qu'est-ce qui peut manquer à
l'homme qui s'est placé hors de tous les désirs ? De quelle ressource extérieure peut
avoir besoin celui qui a réuni en lui tous ses biens ? Sénèque (4-65 av. J.C.)
La vie heureuse
Document 4 : À l’inverse du stoïcisme, l’épicurisme ou “École du jardin”, fondée par le philosophe grec
Épicure (-341,-271) développa une notion du bonheur où le plaisir fut réhabilité, y compris les plaisirs
corporels. Mais évidemment sans pour autant assimiler les plaisirs du corps au bonheur, comme dans
l’hédonisme. Pour les épicuriens, le bonheur n’est pas dynamique, il est absence de trouble (ataraxie),
statique, immobile. Philosophie plus souriante que le stoïcisme, elle continuait néanmoins encore à se
méfier du plaisir et se réfugiait de la vie sociale.
C’est un grand bien, croyons-nous, que le contentement, non pas qu’il faille toujours vivre
de peu en général, mais parce que si nous n’avons pas l’abondance, nous saurons être
contents de peu, bien convaincus que ceux-là jouissent le mieux de l’opulence, qui en ont
le moins besoin. Tout ce qui est fondé en nature s’acquiert aisément, malaisément ce qui
ne l’est pas. Les saveurs ordinaires réjouissent à l’égal de la magnificence dès lors que la
douleur venue du manque est supprimée. Le pain et l’eau rendent fort vif le plaisir, quand
on en fut privé. Ainsi l’habitude d’une nourriture simple et non somptueuse porte à la
plénitude de la santé, elle fait l’homme intrépide dans ses occupations, elle renforce
grâce à l’intermittence de frugalité et de magnificence, elle apaise devant les coups de la
fortune.
Partant, quand nous disons que le plaisir est le but de la vie, il ne s’agit pas des plaisirs
déréglés ni des jouissances luxurieuses ainsi que le prétendent ceux qui ne nous
connaissent pas, nous comprennent mal ou s’opposent à nous. Par plaisir, c’est bien
Association ALDÉRAN © - Conférence 1600-128 : “La voie du bonheur, le bonheur est de ce monde“ - 16/01/2002 - page 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%