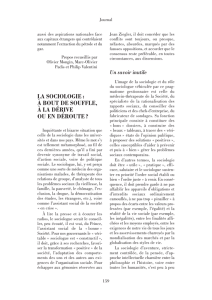la sociologie urbaine à Strasbourg avec henri lefebvre

La sociologie urbaine
à Strasbourg
avec Henri Lefebvre
Un apprentissage du difficile rapport
de la théorie à l’action
L’université est une dame mûre
qui se met lentement en mou-
vement et elle s’attarde souvent
sur des questions formelles, très
détachées de la pratique sociale :
c’est seulement depuis peu que
les problèmes d’urbanisme sont
entrés à l’université, dans les
départements de géographie, de
sociologie et peut-être même de
psychologie. Alors peu à peu se
met en place un appareil uni-
versitaire qui pourrait avoir un
rôle consultatif dans tous ces
problèmes
C
omment devient-on sociologue
de « l’urbain » ? Tel aurait pu
être le titre de cet article, car
cette interrogation sera en effet le l
conducteur de notre témoignage et de
notre réexion sur la présence, l’en-
seignement et l’engagement d’Henri
Lefebvre à Strasbourg, des années
1961 à 1966. C’est une manière de
revenir à une période charnière pour
la réexion sur « la ville et l’urbain »,
riche de tensions, de renouvelle-
ment des politiques et des savoirs, à
laquelle ce sociologue de la praxis
participa pleinement et associa ses
étudiants, dont j’ai été, durant toute
cette période.
Les « enseignements »
d’Henri Lefebvre
à Strasbourg n
Faire des études de sociologie au
début des années 1960, c’est s’ins-
crire dans une nouvelle « cohorte »
de sociologues, « labellisés » par un
diplôme spécique : en eet, la licence
de sociologie est créée en 1958, en
même temps que la thèse de troi-
sième cycle. C’est aussi participer à
une aventure sociale et intellectuelle :
ce parcours universitaire était alors
moins rodé qu’une licence de lettres
ou de géographie, plus traditionnelle-
ment choisie par les étudiants de cette
génération. Les issues professionnelles
étaient plus aléatoires, plus indétermi-
nées. De plus, cette discipline avait la
réputation d’être porteuse d’un savoir
subversif.
Peu d’étudiants, à l’Université de
Strasbourg, ont tenté l’aventure au
début. Ce petit eectif renforça le sen-
timent d’appartenance à un groupe
singulier, avec une place à part dans
la maison savante qui se démarqua
rapidement des disciplines voisines –
institutionnellement et géographique-
ment parlant – comme la psychologie
sociale ou même l’ethnologie, avec des
clivages idéologiques forts, souvent
sources de malentendus. À l’inverse,
les étudiants en philosophie – dont
certains participèrent plus tard à l’In-
ternationale situationniste – y trouvè-
rent leur place.
134
Mi c h è l e Jo l é
Université de Paris 12
Institut d’urbanisme

135
Michèle Jolé La sociologie urbaine à Strasbourg avec Henri Lefebvre
Cette position d’« à-côté » se ren-
force avec l’arrivée à l’Institut de socio-
logie en 1961 d’Henri Lefebvre, autour
duquel va se créer un véritable cercle
d’échanges d’idées et d’amitié, compo-
sé principalement de ses étudiants et
d’auditeurs privilégiés des séminaires
publics. Diérents termes reviennent
dans les propos des témoins inter-
viewés : « le petit cercle des initiés », « le
milieu proche», « la clientèle ».
En eet, Henri Lefebvre est nommé
en 1961, grâce au soutien du philo-
sophe Georges Güsdorf et « malgré
son passé marxiste », professeur de «
Morale et sociologie » dont il obtien-
dra la chaire deux années plus tard et
qu’il conservera jusqu’en 1966. Cette
nomination lui permet pour la pre-
mière fois d’enseigner à l’université,
après de longues années d’enseigne-
ment secondaire, de recherche au
CNRS au Centre d’Étude Sociologi-
ques – sans compter les nombreux
métiers exercés par nécessité lors des
suspensions diverses dont il avait été
l’objet : « C’était quelqu’un qui adorait
enseigner, et avoir retrouvé des gens à
qui enseigner l’a rendu extrêmement
heureux... ». Cette nomination est sans
conteste la reconnaissance académi-
que qu’il attendait. Elle correspond
grossièrement au moment de la sus-
pension du Parti communiste, qu’il
quitte en 1958 et qui représente, pour
reprendre ses termes dans La Somme
et le Reste, « une délivrance et le bon-
heur retrouvé … ; dégagé de la pres-
sion politique comme on sort d’un lieu
d’étouement, quelqu’un commence à
vivre. Et à penser… ».
La concomitance entre une conjonc-
ture particulière de la vie personnelle
et politique d’Henri Lefebvre et l’ac-
cession de la sociologie à un nouveau
statut va favoriser, à Strasbourg, l’éclo-
sion d’un milieu riche de débats, de
controverses et, surtout, laisser la place
à l’invention et l’innovation dans les
programmes proposés pour la licence
de sociologie. Il s’agira en eet, pour ce
nouveau professeur, de poursuivre la
mise en place d’un enseignement initié
à Strasbourg dès 1958, selon les dispo-
sitions réglementaires, mais avec de
grandes marges de manœuvre. C’est
ainsi qu’il t venir Abraham Moles,
rencontré au Centre d’Études Socio-
logiques à Paris (et qui t d’ailleurs sa
carrière à Strasbourg) pour l’assister
dans les enseignements de méthodes
en sciences sociales. Henri Hatzfeld,
déjà en place, assurait de son côté, un
enseignement en sociologie du travail
et de la religion.
Les cours qu’assura Henri Lefebvre
étaient de deux types. Les uns s’adres-
saient aux étudiants de sociologie, de
psychologie et de philosophie. Leur
contenu changeait d’une année sur
l’autre : « Le concept de réalité socia-
le : de Saint-Simon à aujourd’hui »,
« Musique et société », « Sociologie et
histoire », « Problèmes de sociologie
urbaine », « Langage et société ».
D’autres cours, intégrés au certi-
cat de sociologie, intitulés « Cours
public » avaient lieu au Palais universi-
taire, chaque vendredi à 17 heures. Ils
étaient fréquentés par une population
très diversiée (étudiants de toutes
disciplines, intellectuels strasbour-
geois), qui remplissait l’amphithéâtre
(cela pouvait aller jusqu’à trois cent
personnes). Là aussi, chaque année,
le cours changea de thème : « Besoin,
motivation, désir : champ d’une théo-
rie des besoins sociaux », « L’aliéna-
tion humaine », « La vie quotidienne,
connaissance et critique (sexualité
et société) », « De Rabelais à Martin
du Gard (les grands écrivains fran-
çais considérés comme sociologues) ».
Un autre « Cours public », donné
dans le cadre de l’Institut d’Études
Politiques (Faculté de Droit), et qui
connut le même succès que les pré-
cédents, constitua un cycle de trois
ans sur le marxisme : « Marx philoso-
phe », « Marx sociologue » et « Marx
économiste ». Ces cours étaient des
quasi-événements et ont fait dire à cer-
tains qu’« il se passait quelque chose à
Strasbourg ». Ces cours publics avaient
d’ailleurs leur pendant à Paris (du
moins dans leur forme et leur succès)
à l’École pratique des Hautes Études.
La diversité des enseignements pro-
posés en un si court laps de temps
témoigne des multiples intérêts que
pouvait avoir Henri Lefebvre et des
nouveaux chantiers qu’il ouvrait ou
qu’il continuait à explorer. Preuve, s’il
en est, de son goût pour la transdis-
ciplinarité que la sociologie nouvel-
lement instituée permettait d’exercer
sans doute plus que les autres. Elle
symbolisera et cristallisera, aussi, pen-
dant un certain temps, le devoir de
critique radicale des sciences sociales.
Preuve aussi que ce penseur est inclas-
sable comme il le dit lui-même, « ni
philosophe, ni spécialiste de telle ou
telle discipline… », même si ces explo-
rations diverses ont pour dénomina-
teur commun sa pensée marxiste, très
centrée à ce moment-là sur l’aliénation
et la « vie quotidienne colonisée ».
Penser l’urbain : entre
enseignement, théorie
et action n
L’hypothèse du présent article est
que la sociologie urbaine va avoir,
dans la pensée et la pratique d’Henri
Lefebvre, un statut particulier pendant
une dizaine d’années, et que Stras-
bourg en est un des chaînons, souvent
peu connu dans l’histoire qu’on éla-
bore de cette sous-discipline. C’est
là en eet qu’il formalise son premier
enseignement sur la « problématique
urbaine » à laquelle il rééchit depuis
quelques années. Mais l’originalité de
cet enseignement, somme toute bref
dans la durée, est à la fois de s’ins-
crire dans une actualité pressante et
de s’ouvrir sur des expériences de ter-
rain, en l’occurrence Strasbourg, qui
mettront les étudiants au cœur des
questionnements sur les politiques
urbaines nationales et locales.
Les jeunes étudiants, tentés initiale-
ment de préférer la sociologie rurale ou
la sociologie du travail, plus familières,
moins énigmatiques, furent assez vite
convaincus de la possible conversion
et empruntèrent pour certains, comme
nous-même, une voie qu’ils ne quit-
tèrent plus. Il serait abusif de parler
d’« École de Strasbourg », mais il est
certain que cette ville, parmi d’autres
certes, devint un laboratoire d’expéri-
mentation sur la place de la sociologie
dans l’action urbaine, largement initié
par Henri Lefebvre et ses relais natio-
naux.
Nous avons peu de traces formelles
des deux cours de sociologie urbaine :
nous ne disposons que de souvenirs,
les nôtres ou ceux d’autres anciens qui
par dénition restent fragmentaires. Il

136 Revue des Sciences Sociales, 2008, n° 40, « Strasbourg, carrefour des sociologies »
nous a semblé plus opportun de nous
appuyer sur les écrits de cette époque
pour cerner le cœur de notre propos.
La plupart des écrits qui nous inté-
ressent ici sont rassemblés dans Du
rural à l’urbain (1970). On peut
également trouver d’autres éléments
de réexion dans Fondements d’une
sociologie de la vie quotidienne (1962),
La Proclamation de la Commune : 26
mars 1871, commencée dès 1960 et
publiée en 1965, et Le langage et la
société (1966). Cet ensemble d’écrits
et de témoignages atteste des évolu-
tions et des tâtonnements, voire des
contradictions ou tout au moins des
tensions d’une pensée qui se cherchait,
qui se radicalisera progressivement
pour aboutir à son premier livre sur
la ville, Le droit à la ville (1968). C’est
eectivement l’interprétation que nous
en faisons pour comprendre le rôle de
ce sociologue dans la période étudiée –
plus complexe que la lecture qui en est
faite traditionnellement – et notam-
ment sa participation à un groupe de
travail, « Sociologie et urbanisme »,
organisé et nancé par le Ministère
de la Construction, auquel il associera
des étudiants et qui aboutira, en pleine
explosion de mai 68, au Colloque de
Royaumont. Nous y reviendrons.
On assiste en eet comme à une
mise en tension entre désir d’action,
nécessité de se rapprocher des milieux
professionnels de l’urbanisme, d’une
part, et critique radicale d’une réalité
sociale en cours de restructuration,
d’autre part. Ces deux démarches sont
moins exclusives l’une de l’autre que
dans la pensée sur la ville des situa-
tionnistes, qu’il fréquentera un certain
temps, y compris à Strasbourg.
Henri Lefebvre a toujours été pré-
occupé par le désir de « changer les
choses » et son intérêt pour l’urbanis-
me, pour en comprendre le fonction-
nement, le sens et les enjeux, procède
à la fois d’une démarche critique, mais
également pragmatique, à savoir ten-
ter d’inéchir les modes cognitifs et
techniques des approches profession-
nelles. On peut en dire autant de son
rapport à la sociologie, dans laquelle il
mit beaucoup d’espoirs, dans la mesu-
re où elle permettait de concilier une
démarche empirique et une approche
théorique et conceptuelle de la ville,
de « l’urbain » – qu’il construit précisé-
ment en concept – et de l’urbanisme.
Ce long cheminement, on le sait et
on l’a dit, aboutira à des prises de posi-
tion radicales, « révolutionnaires » sur
l’urbain : il systématisera sa pensée sur
la ville « comme espace social, produit
social et rapport social inhérents aux
rapports de propriété et aux formes
productives » dans l’ouvrage La pro-
duction de l’espace. Il en est de même
de l’urbanisme : en eet, dans un arti-
cle de 1967, « Mythes et réalités de
l’urbanisme », Henri Lefebvre, s’adres-
sant à des urbanistes comme Michel
Écochard par exemple, arme que
« le problème urbain est un problème
révolutionnaire, qui met en question
les structures de la société existante ;
l’urbanisme est une idéologie... ». Les
constatations décevantes de la réalité
ne l’ont pas aidé à garder son opti-
misme de départ : « Or, ici se recon-
naît le trajet d’une pensée menacée,
presque brisée parfois. Non sans mal,
elle le fraie, puisant sa force dans une
sorte d’optimisme tragique » (Préface
de Du rural à l’urbain). Ces prises de
position ont occulté d’une certaine
manière la période de cheminement
et d’interrogations qui nous intéresse
à double titre aujourd’hui : elle est en
eet comme un miroir pour rééchir
à nos propres interrogations d’appren-
tie de l’époque, mais garde aussi une
pertinence pour les questions qui se
posent aujourd’hui sur les relations
entre étude et recherche, sur l’objet
même de l’urbain, sur la pertinence de
la sociologie, etc.
Du rural à l’urbain mérite une
attention particulière pour compren-
dre cette gestation, ambivalente voire
contradictoire. En eet, ce livre, qui
reprend des textes de 1949 à 1969, est
un ensemble d’écrits sur le rural, puis
l’urbain, sur la vie quotidienne, sur la
civilisation urbaine. On y trouve aussi
des écrits polémiques sur l’urbanisme
fonctionnaliste, les grands ensembles,
la disparition de la rue, ce que pourrait
être un « nouvel urbanisme »... L’inté-
rêt de ce livre est sans doute le mélange
des genres : apport de connaissances
empiriques et critiques, apport épisté-
mologique, apport de réexion sur les
pratiques professionnelles en cours.
Mélange étrange, riche, « inclassable »,
dira-t-il, « qui n’est pas sans décalages,
sans ottements, sans incertitudes ». La
préface explicite le cheminement de
sa pensée, les étapes de « ce long trajet,
de vingt ans : l’entrée de la France dans
la modernité ». Sa pensée sur l’urbain
Henri Lefèbvre

137
Michèle Jolé La sociologie urbaine à Strasbourg avec Henri Lefebvre
s’inscrit au départ, comme celle sur le
monde rural, dans une pensée marxis-
te, qu’il entend, « non pas comme un
modèle dénitif de pensée et d’action,
mais comme une voie, celle de la réa-
lisation de la philosophie à travers sa
critique radicale ». Sa sociologie est
envisagée comme « l’étude de la prati-
que sociale et de la quotidienneté ». La
vie quotidienne est en eet pour lui
le lieu du changement par excellence
(autant que celui de la production),
où « les besoins sont programmés, mais
aussi matière et résidus échappant aux
puissances et aux formes qui impo-
sent leur modèle » : un quotidien par
excellence ambigu. « Donc la vie quo-
tidienne sert le déploiement du monde
de la marchandise et du monde de
l’État, mais, – et c’est l’étape essen-
tielle pour nous –, la société dans son
ensemble se transforme et d’industrielle
devient urbaine ». S’il y a bifurcation,
dit-il, dans son parcours du rural à
l’urbain, du monde de la production
à celui de la consommation, à celui
de la vie quotidienne, c’est qu’il y a
« un objet nouveau, une modication
dans la pratique ». L’urbanisation l’em-
porte dans la problématique – avant
de l’emporter dans l’élaboration des
concepts. La ville, son éclatement,
« une prolifération démesurée de ce qui
fut jadis la ville », la société urbaine et
l’« urbain », superposent leurs contra-
dictions (intégration et ségrégation,
formes de centralité) à celles de l’ère
industrielle et de l’ère agricole.
Deux articles de la Revue française
de sociologie sur « Les nouveaux ensem-
bles urbains : un cas concret, Lacq-
Mourenx et les problèmes urbains de
la classe ouvrière » (1960) et « Utopie
expérimentale : pour un nouvel urba-
nisme » (1961), que d’autres articles
complèteront progressivement, sont
les points de départ et posent les sou-
bassements de la pensée d’Henri Lefe-
bvre sur l’urbain. Ils traitent des deux
volets, à son avis complémentaires,
d’une interrogation sur le devenir de
nos sociétés, à travers son symptôme
le plus nouveau et le plus traumati-
sant : « la ville nouvelle », « le grand
ensemble », dont la référence géogra-
phique initiale est Lacq-Mourenx, ville
implantée en pleine campagne, dans
une région presque sous-développée,
à partir d’un plan-masse, décidée par
l’État et, de ce point de vue, « un vérita-
ble laboratoire social ». Dans ces deux
articles, Henri Lefebvre argumente sur
la nécessité d’une double orientation
de la recherche et de l’action : com-
prendre ces nouveaux espaces sociaux,
en quoi ils s’opposent à ceux des villes
historiques, « spontanées » et simul-
tanément comprendre – en faire une
critique si nécessaire – ces nouvelles
démarches de l’urbanisme, qui consis-
tent à créer des villes ex nihilo et tenter
d’en proposer de plus pertinentes, d’où
sa notion de « nouvel urbanisme ».
Et l’urbanisme alors ? n
Henri Lefebvre fait l’eort, au-delà
des constats d’échec de l’urbanisme
fonctionnaliste, d’analyser la pensée
programmatique qui caractérise ce
dernier et de ne pas se contenter d’en
déplorer les eets, notamment dans les
grands ensembles : « À nous de dégager
la signication de cette énorme expé-
rience négative ». Il renvoie ainsi dos-à-
dos ceux qui sont pour et ceux qui sont
contre les grands ensembles.
Une pensée programmatique,
selon lui, doit éviter deux écueils, la
simple constatation empirique et la
construction à priori d’une cité idéale.
La méthode doit passer entre le pur
« practicisme » et la théorisation pure.
En eet, pour lui, la pensée program-
matique opère sur des objets virtuels
et les confronte à l’expérience parce
qu’elle veut faire entrer l’objet ima-
giné dans la pratique. Ce jeu entre
une problématique donnée dans le réel
et une exploration du possible avec
l’aide de l’imaginaire est au cœur du
nouvel urbanisme, qu’il appellera par
ailleurs « urbanisme expérimental »,
méthode de la transduction ou uto-
pisme.
La pensée programmatique des
grands ensembles n’a pas su tenir les
deux bouts, pourrions-nous dire, car
elle s’est fondée principalement sur
« l’intelligence analytique » : « le fonc-
tionnalisme, malgré ses mérites, et
l’intelligence analytique hypertrophiée
stoppaient l’imaginaire ». Henri Lefe-
bvre ne conteste pas son ecacité, il
l’envisage même comme une étape
nécessaire de la connaissance, mais il
s’interroge sur l’usage abusif qui en a
été fait en la poussant à ses plus extrê-
mes conséquences, et sur son dépasse-
ment : « le temps est venu de contester
la prédominance de la pensée analyti-
que… Avant de pouvoir créer du réel,
nous passons par la dissection, l’anato-
mie, en un mot, par l’analyse. Ensuite,
seulement, nous prenons en charge une
exigence des plus hautes… N’est-il pas
possible de décrire les fonctions, de les
classer, de les hiérarchiser, tout en cher-
chant à atteindre par ce biais ce qui a
disparu momentanément, la sponta-
néité vitale ? En d’autres termes, l’ana-
lyse des fonctions étudiées en acte dans
les grands ensembles, leur description
et leur classement, devraient permettre
de reconstituer patiemment les liaisons
et les connexions, c’est-à-dire recons-
tituer le vivant ». Ce travail de syn-
thèse exige un travail de clarication
conceptuelle : hiérarchisation de l’uni-
fonctionnel, du multi-fonctionnel et
du trans-fonctionnel (esthétique, sym-
bolique et ludique), distinction entre
forme, structure, fonction.
La pensée de cette « nouvelle démar-
che » contient, de façon récurrente,
des propositions d’action sur des lieux
stratégiques, sociaux et spatiaux, à
réhabiliter pour leur dimension sym-
bolique, signiante et ludique : la rue,
le monument, le café. Par exemple,
la rue est un thème très fréquent, y
compris dans La vie quotidienne dans
le monde moderne. Il en prend vigou-
reusement la défense : la rue pour lui
est un élément fondamental et original
de la ville moderne, elle est le « micro-
cosme de la vie moderne », plus que les
monuments et leurs signications. La
rue, lieu de passage, de circulation, est
aussi le « monde des objets », de la mar-
chandise : « ici, dans cette oeuvre invo-
lontaire, la rue, s’accomplit la beauté
propre à notre société ». La rue a une
valeur sociale comme « théâtre spon-
tané, terrain de jeux, lieu de rencontres,
de sollicitations, avec une dimension
esthétique et symbolique ; la rue est
importante, intéressante pour les gens
en tant qu’émetteurs d’informations ;
elle a enn un caractère ludique, une
dimension poétique en ce qu’elle est
le lieu de l’imprévu, de la surprise, du

138 Revue des Sciences Sociales, 2008, n° 40, « Strasbourg, carrefour des sociologies »
plaisir du jeu perpétuel, du spectacle
dramatique… ».
Cette démarche réaliste, concep-
tuelle et imaginaire, suppose des
compétences spécifiques qu’Henri
Lefebvre reconnaît à la sociologie et
aux sociologues. La sociologie et le
sociologue ont une place stratégique
dans ce dispositif.
La sociologie et
le sociologue au centre
de la question urbaine ?
n
En eet, ce qui frappe à la lecture de
ces diérents textes, c’est la place que
donne Henri Lefebvre à la sociologie
face à la question de l’urbain. Il est
clair pour lui que le renouvellement de
la pensée sur ces questions passe par
elle. Il n’en exclut ni les géographes, ni
les historiens, ni les économistes, mais
la sociologie, de par ses propriétés, à
la fois compréhension théorique du
social et exploration empirique, est la
plus apte pour cette urgente mission.
On l’a déjà dit – mais c’est pour nous
une des découvertes de cette recher-
che –, si l’on pousse le raisonnement,
Henri Lefebvre est venu à la sociologie
pour traiter ces questions urbaines qui
lui paraissent dénir le devenir du
monde social. L’usage de l’expression,
« le » sociologue, dit bien l’espérance
en ce nouvel acteur, que lui et tous
les intéressés « substantialisent » : cette
armation relève quasiment de la
croyance.
Pour lui, le sociologue doit être un
interlocuteur des acteurs de l’urbanis-
me, principalement des techniciens,
architectes, ingénieurs, nationaux et
si possible, locaux (ce que lui-même
a tenté de faire à plusieurs reprises
comme nous le verrons). Le sociolo-
gue de la ville est à la fois un savant,
un humaniste-utopiste, un homme de
terrain, un médiateur : « il ne parti-
cipe pas aux décisions, c’est regrettable,
mais il peut agir en amont… Ce qui
le caractérise par rapport à un cher-
cheur traditionnel, académique, c’est
que sa recherche doit devenir eciente,
pratique, opérationnelle, en ce qu’elle
implique un objet virtuel, une possi-
bilité et donc une notion de valeur, un
jugement préférentiel » .
Il n’en reste pas là et il tentera
de dénir la demande qu’on peut
lui adresser. Il distingue clairement
trois apports possibles, de diérents
ordres :
– Un apport de connaissance scien-
tique et conceptuelle. L’apport de la
sociologie à l’urbanisme, dit-il, peut
être considérable dans des champs
divers : la vie urbaine, les relations
de voisinage, la notion de quartier,
la fonction symbolique et ludique de
la rue, l’emploi du temps, les besoins
sociaux… Ces apports de connaissance
plutôt empirique doivent s’accompa-
gner d’une réexion théorique et cri-
tique sur les phénomènes étudiés. Un
travail de conceptualisation que lui-
même a entamé et qu’il va poursuivre
ultérieurement doit porter sur la ville
et l’urbain, sur la ville comme totalité,
sur les notions de forme, de structure,
et de fonction, sur la vie quotidienne et
l’aliénation, sur « l’habiter » (à distin-
guer de l’habitat), sur la ville comme
espace/temps.
– Un apport d’imaginaire, ou plutôt
une libération de l’imaginaire, de l’uto-
pie : « Le sociologue de la ville, d’une
part, creuse, approfondit scientique-
ment le concept de ville et d’autre part
libère l’imagination et se lance délibé-
rément dans l’utopie pour construire
l’image de la ville possible, des villes
possibles. Le travail conceptuel va avec
la libération de l’imaginaire ».
– Un apport de médiation. Le socio-
logue est de fait un porte-parole, par
sa présence sur le terrain et ses modes
de travail. Le sociologue ne semble
pas pour autant avoir à jouer un rôle
particulier de médiateur actif dans la
participation des habitants. La parti-
cipation « doit être une intervention
active et perpétuelle des intéressés », à
partir de comités d’usagers à la base
qui auraient une existence perma-
nente, voire seraient inscrits dans un
nouveau droit de l’urbanisme. Sans
cette structure, la participation est un
mythe : « l’important me semble être
l’intervention des intéressés, dans le
sens d’une autogestion à l’échelle des
communautés locales urbaines, pour
dire ce qu’ils pensent, veulent, dési-
rent ». Par contre, le sociologue, qui,
par nature, a comme objet de recher-
che le social et donc ses acteurs, a un
rôle d’intermédiaire à jouer entre les
populations étudiées et les urbanis-
tes : « Tant qu’ils ne donneront pas un
compte-rendu perpétuel de leur expé-
rience de l’habiter à ceux qui s’esti-
ment des experts, il nous manquera une
donnée essentielle pour la résolution
du problème urbain. L’État malheu-
reusement tend toujours à se passer de
l’intervention des intéressés… ».
On le comprend, la position du
sociologue, dans cette double triangu-
lation, théorie, médiation et imaginaire
d’une part, et urbanistes, sociologues et
usagers de l’autre, est porteuse d’ambi-
guïtés. Comment tenir cette position,
dont la construction se fonde sur une
posture critique ? Est-elle tenable ? Les
ancrages institutionnels, Université ou
CNRS, bureau d’étude, structure opé-
rationnelle d’urbanisme ou d’aména-
gement, susent-ils à la clarier ? Que
signie avoir « un rôle consultatif » ?
Quelle est la place du militantisme
dans ces dénitions ?
Urbanistes
et sociologues :
l’expérience d’un
champ de tension n
À Strasbourg, comme à Paris en
parallèle, Henri Lefebvre va se faire
le passeur entre étudiants, thésards
ou jeunes chercheurs et le milieu de
la commande publique d’études de
sociologie urbaine. Il n’y eut cepen-
dant pas à Strasbourg l’équivalent de
l’ISU, Institut de Sociologie Urbaine,
association créée à Paris en 1963 par
quelques chercheurs – dont Monique
Cornaert, Nicole Haumont, Henri
Raymond et présidée par Henri Lefeb-
vre – pour recevoir et gérer les contrats
d’étude.
À Strasbourg en eet, les contrats
d’études qu’il apportait et supervisait
se géraient ponctuellement, dans le
cadre des corporations d’étudiants
en sociologie et en géographie. Elles
étaient de diverse importance, mais
toutes furent une étape de leur for-
mation. L’expérience la plus riche fut
la participation à une « étude-recher-
che », lancée par le Ministère de la
Construction en 1964, sous la direc-
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%