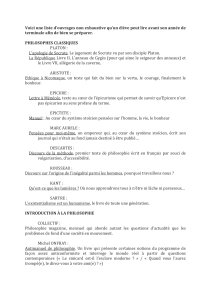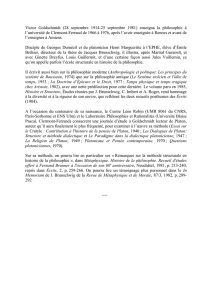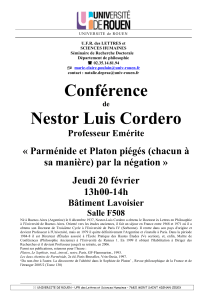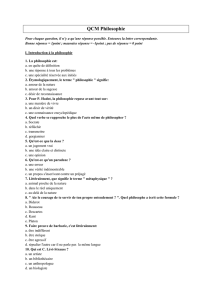La philosophie, un anti

La philosophie, un anti-juridisme ?
Julie AllArd
« Ici se pose la question de l’obscurité de la langue
philosophique et de ce qui risque de la rendre si peu populaire.
Il est hautement signicatif qu’elle se pose au sujet du droit
(...). Tout se passe comme si la question de l’accès du peuple à
la langue philosophique, le droit du peuple à la philosophie se
jouait de façon d’abord plus sensible sur le thème du droit, de la
philosophie du droit, du droit à la philosophie du droit ».
Jacques derridA, Du droit à la philosophie 1.
« Il eût été à désirer que de tous les livres faits sur les lois, par
Bodin, Hobbes, Grotius, Puffendorf, Montesquieu, Barbeyrac,
Burlamaqui, il en eût résulté quelque loi utile, adoptée dans
tous les tribunaux de l’Europe, soit sur les successions, soit
sur les contrats, sur les nances, sur les délits, etc. Mais ni les
citations de Grotius, ni celles de Puffendorf, ni celles de l’Esprit
des lois, n’ont jamais produit une sentence du Châtelet de Paris,
ou de l’Old Bailey de Londres. On s’appesantit avec Grotius,
on passe quelques moments agréablement avec Montesquieu ;
et si on a un procès, on court chez son avocat ».
VoltAire, Dictionnaire philosophique 2.
Lorsque j’ai commencé mon doctorat sous sa direction, Guy Haarscher m’a raconté
comment son destin avait croisé celui de Chaïm Perelman. Tandis qu’il achevait une
thèse de philosophie, passionné comme le voulait l’époque par Sartre, Marx ou Hegel,
Perelman lui aurait suggéré de s’intéresser de plus près à la philosophie du droit.
Or Guy Haarscher m’a coné que non seulement il ignorait tout de la discipline à
ce moment-là, mais aussi qu’il ne concevait pas à quel titre les pratiques juridiques
pourraient présenter un quelconque intérêt pour la pensée. Il y consacrera pourtant sa
carrière, goûtant peu à peu à la philosophie du droit, mais aussi au droit – ses lois, sa
jurisprudence –, assumant ainsi une part de l’héritage de Perelman au sein du Centre
de recherches qu’il contribua à fonder.
Ce peu de goût pour les formes juridiques afché au premier abord par le jeune
philosophe était-il seulement le fait des circonstances ou, plus profondément, le signe
d’une certaine vision du droit portée par la philosophie classique, contre laquelle
1 J. DerridA, Du droit à la philosophie, Paris, Galilée, 1990, p. 529.
2 VoltAire, Dictionnaire philosophique, « L’esprit des lois ».

40 pensées du droit, lois de lA philosophie
Perelman 3 et certains de ses contemporains, comme Michel Villey, tentaient de
réhabiliter des modèles antiques allant d’Aristote à la rhétorique ? Cette approche du
droit, qu’aurait adoptée le jeune Haarscher avant de rencontrer Perelman, associerait
une idéalisation du droit – une sacralisation de la loi, notamment – et un mépris de
ses incarnations concrètes – et en particulier de la pratique judiciaire. Autrement dit,
l’approche du droit dominant la philosophie jusqu’au XXe siècle pourrait être qualiée
sinon d’anti-juridisme, au moins « d’anti-judiciarisme » nourri de sa méance à
l’égard des juges et, partant, de la mise en œuvre concrète du droit.
Je me propose donc de revenir sur cette posture intellectuelle qui, si elle a
connu quelques exceptions (notamment chez Aristote), illustre assez bien l’esprit
philosophique tel qu’il se dénit depuis Platon. J’espère ainsi rendre hommage
au travail au long cours de Guy Haarscher, à cette philosophie du droit capable de
s’intéresser non seulement aux idées mais aussi à la pratique et aux institutions.
Perelman prétendait que les philosophies rationalistes comme les philosophies
« anti-rationalistes », dans leur grande majorité, ont ignoré les rationalités juridiques.
Les premières auraient en effet écarté la pratique du droit, en particulier la pratique
judiciaire et la rhétorique, en raison de leur faillibilité et de leur lien aux apparences, et
lui auraient préféré les idées et les concepts. La recherche fondatrice « de l’Etre, de la
Vérité, du Bien et de la Justice absolus » 4 qui dénit selon Perelman la philosophie
rationaliste l’aurait isolée de toutes considérations de la pratique concrète du droit et
des institutions qui, contrairement aux idéaux philosophiques, visent essentiellement
« à organiser sur terre, avec un minimum de violence, une société d’hommes avec
leurs défauts et leurs défaillances » 5.
Les philosophies dites « anti-rationalistes », quant à elles, auraient dénoncé le
pouvoir du droit dont les rationalités ne seraient que les masques, et auraient ainsi
disqualié par principe l’ensemble des formes juridiques, adhérant selon Perelman au
même idéal absolutiste que les philosophies rationalistes : « Pascal trouve la preuve
de la faiblesse et de la déchéance de l’homme dans ses variations concernant le vrai
et le juste » 6. La tradition philosophique, en d’autres termes, aurait selon Perelman
rejeté la faillibilité humaine et avec elle le droit et la justice qui en sont les traces 7.
3 A plusieurs reprises, ce dernier constate en effet que « bien rares sont les philosophies qui
font quelque place au processus de l’élaboration et de l’application du droit », trop préoccupées
qu’elles sont par la construction de systèmes idéaux qui, par dénition, rendraient les techniques
juridiques superues. C’est pourquoi, note Perelman, les utopies philosophiques méprisent
toujours les institutions concrètes. Au contraire, Perelman entend défendre un modèle de
rationalité issu de la pratique du droit et de la rhétorique, qu’il veut rénover et réhabiliter après
plusieurs siècles de discrédit philosophique.
4 C. PerelmAn, Ethique et droit, 2e éd., Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles,
2012, p. 437.
5 Ibid., p. 439.
6 Ibid., p. 438.
7 La confrontation entre les aspirations philosophiques à une justice absolue, d’une part, et
la faillibilité des décisions de justice, d’autre part, expliquerait même une forme de désintérêt
des philosophes à l’égard des formes juridiques et, en conséquence, une ignorance même de
leur rationalité propre.

lA philosophie, un Anti-juridisme ? 41
Dans deux articles aux titres évocateurs 8, Perelman attribue donc à la philosophie
« en général » une « attitude d’incompréhension, et même de mépris, à l’égard du
droit, de ses auxiliaires et de ses œuvres » 9. L’analyse de cet anti-juridisme proposée
par Perelman s’appuie en outre sur une critique de la raison moderne, trop largement
inspirée selon lui des mathématiques, et à laquelle il entend substituer les modèles de
rationalité issus de l’argumentation. Son analyse a donc vocation à justier un retour
aux anciens contre la philosophie moderne, connant ainsi parfois à la caricature.
Perelman interprète par exemple la modernité philosophique comme un moment
de rejet du droit et du discours juridique, alors même que cette modernité peut à
juste titre être perçue comme le triomphe d’un certain « juridisme », étant donnée
l’importance accordée dans la philosophie politique aux notions comme l’Etat de droit,
la constitution, la paix, les droits de l’homme ou tout simplement le contrat social. De
même, il paraît étrange de penser l’Antiquité à l’abri de l’anti-juridisme dénoncé par
Perelman, alors même qu’il y trouve un fondement puissant dans la métaphysique
platonicienne 10, comme j’essaierai de le montrer dans la suite.
Il faut donc préciser davantage l’anti-juridisme visé par Perelman, qui serait propre
à la philosophie en tant que discipline mais qui trouverait son apogée à la modernité, et
que cet article vise à mettre en lumière. Pour l’essentiel, cet anti-juridisme se fonde sur
une incompatibilité entre l’idéal et la réalité du droit (que les philosophes prétendent
se placer du côté de l’un ou de l’autre 11), et il débouche sur une méance profonde
à l’égard des institutions judiciaires qui incarnent ou illustrent cette incompatibilité.
A ce titre, cet anti-juridisme spécique culmine bien à la modernité, mais n’en est pas
moins fondé métaphysiquement dans l’origine même de la philosophie.
Le dualisme platonicien, en distinguant radicalement le monde des idées et
le monde des apparences, instaure en effet une tension insurmontable entre la vie
intellectuelle et les affaires humaines, et en particulier entre la philosophie et la
pratique du droit, que Platon déclare incompatibles : tandis que le philosophe cherche
la vérité, le juge et l’avocat exercent un pouvoir qui ne repose que sur des apparences
et dont la rhétorique est l’instrument.
Cette dichotomie entraîne une distorsion entre le concept de justice et son
institution. Elle nourrit également la représentation du philosophe qui consacre sa vie
aux idées mais dont la grande masse se moque, tant son discours est occulte et paraît
8 « Ce qu’une réexion sur le droit peut apporter au philosophe » et « Ce que le philosophe
peut apprendre par l’étude du droit » (C. perelmAn, op. cit., p. 437-449 et 450-466).
9 C. perelmAn, op. cit., p. 438. Car « [l]a société idéale, ignorant les contestations, n’a
besoin ni de lois ni de juges » (Ibid., p. 437). Convaincu au contraire que la société humaine
est traversée de discussion, de contradictions, de conits, Perelman propose un modèle de
rationalité qui se nourrirait du débat et de l’argumentation, soit le modèle du droit et, plus
particulièrement, la gure du procès où se déploie toute sa rationalité à travers la rhétorique.
10 Voir infra.
11 Alors que Platon érigeait l’idéal philosophique contre la justice incarnée et corrompue
des sophistes, les critiques contemporains des droits de l’homme par exemple dénoncent, le
plus souvent, le caractère idéalisé des droits fondamentaux, à la fois incompatibles avec la
réalité du monde, connue du philosophe, insufsants à réaliser leurs utopies et corrompus par
la domination et l’impérialisme.

42 pensées du droit, lois de lA philosophie
ridicule aux yeux du peuple. La langue parlée par le philosophe est incomprise des
autres hommes. En retour, le philosophe ignore tout des pratiques publiques, et en
particulier des usages du droit comme institution. Ainsi, dans le Théétète, Platon fait-il
dire à Socrate qu’« il est naturel que ceux qui ont passé beaucoup de temps à l’étude
de la philosophie paraissent de ridicules orateurs lorsqu’ils se présentent devant les
tribunaux (…). Il semble en effet que ceux qui ont, dès leur jeunesse, roulé dans les
tribunaux et les assemblées du même genre, comparés à ceux qui ont été nourris dans
la philosophie et dans les études de cette nature, sont comme des esclaves en face
d’hommes libres » 12.
Le constat de l’inaptitude juridique du philosophe est donc doublée d’une
dépréciation instantanée des métiers juridiques. Cette critique n’est pas accidentelle
mais structurelle : avec Platon, la philosophie se dénit précisément par opposition au
droit, contre la justice pensée comme institution. Le philosophe est l’homme libre qui
n’a pas cédé aux séductions du pouvoir, qui ne s’est pas rendu esclave de la rhétorique,
de cette argumentation creuse qui vide les idées de leur substance pour ne considérer
que les apparences. Socrate explique ainsi à Gorgias le sophiste : « L’orateur n’est
pas l’homme qui fait connaître, aux tribunaux, ou à toute autre assemblée, ce qui est
juste et ce qui est injuste; en revanche, c’est l’homme qui fait croire que le juste, c’est
ceci et l’injuste, c’est cela, rien de plus » 13. C’est donc en raison d’un fondement
métaphysique que les avocats, ainsi que les juges, sont perçus comme des esclaves 14.
Ainsi a pu s’installer et durer un certain mépris de la philosophie envers le monde
judiciaire, suscité chez Platon par deux circonstances particulières.
Tout d’abord, l’opposition propre à la cité grecque entre les philosophes et les
sophistes. Cette opposition dénit la philosophie qui naît et se construit contre les
sophistes, ces orateurs habiles, habitués aux assemblées et aux tribunaux, capables
de convaincre leur auditoire, et qui professent leur savoir contre rémunération. Les
sophistes se méprennent en se consacrant aux intrigues humaines, futiles et vaines,
tandis que les philosophes, eux, vouent leur vie à la recherche de la sagesse.
La seconde explication à la position de Platon à l’égard du droit et de la justice
est à chercher dans le procès de Socrate. Socrate a fait l’objet d’accusations qui
remettaient en question sa loyauté envers la cité athénienne. Il aurait corrompu la
jeunesse et perturbé l’ordre social athénien. Et Socrate est condamné à mort. Cette
seule condamnation justie aux yeux de Platon le rejet des pratiques juridiques. Ou
plutôt ce procès ne peut avoir lieu qu’en vertu du divorce de la justice, comme idéal, et
du droit, comme pratique concrète, c’est-à-dire en raison d’une séparation de la vérité
et du jugement, de la philosophie et des affaires humaines. Car pour Platon, Socrate
12 plAton, Théétète, 172a-172d, Paris, Flammarion, 1967, p. 107.
13 plAton, Gorgias, 454e-455a, Paris, Garnier-Flammarion, 1993, p. 141. Platon fait
également dire à Gorgias que « le bien suprême, cause de la liberté et principe du commandement
est le « pouvoir de convaincre, grâce aux discours, les juges au Tribunal » (Ibid., 452d-453b,
p. 135).
14 Socrate précise : les débats du procès « ne sont jamais sans conséquence », les acteurs
poursuivent toujours un but. L’intérêt y est omniprésent, et l’esprit de ses acteurs est corrompu :
ils s’imaginent habiles et sages, alors qu’ils ont perdu la justice et la vérité.

lA philosophie, un Anti-juridisme ? 43
est évidemment innocent. Socrate a été condamné par des esclaves, des hommes
soumis à leurs passions, leurs intérêts, leur avidité de pouvoir.
Le récit que fait Platon du procès de Socrate a pour fonction de mettre en lumière
de façon tragique l’incapacité du jugement humain à rendre la vraie justice. Platon
montre un Socrate libre, qui ne craint pas de mourir, pour autant que sa mort lui
permette d’être dèle à lui-même, en particulier à ses principes de justice. Socrate
refuse pour cette raison le conseil d’un avocat professionnel : il a toujours dénoncé la
rhétorique comme pratique de dissimulation et de manipulation, pourquoi y ferait-il
soudain appel ? Socrate se pense innocent, il n’a pas besoin de plus d’argument que
son innocence elle-même.
En décrivant un Socrate à la fois pur et naïf, Platon cherche à démontrer la
contradiction entre les pratiques juridiques et argumentatives, d’une part, et la vérité
et la justice, d’autre part. Platon souligne que Socrate ne maîtrise pas l’argumentation
juridique pour renforcer l’abîme qui sépare justement la pratique de la philosophie de
l’enceinte judiciaire : « Sachez-le, c’est aujourd’hui la première fois que je comparais
devant un tribunal, et j’ai plus de soixante-dix ans, déclare Socrate ; aussi je suis
véritablement étranger au langage qu’on parle ici. (...) Je vous demande aujourd’hui de
ne pas prendre garde à ma façon de parler, qui pourra être plus ou moins bonne, et de
ne considérer qu’une chose et d’y prêter toute votre attention, c’est si mes allégations
sont justes ou non ; car c’est en cela que consiste le mérite propre du juge ; celui de
l’orateur est de dire la vérité » 15.
Mais Socrate est condamné. Pour Platon, c’est l’ignorance des hommes et
leur goût pour les apparences qui les font succomber aux charmes de la rhétorique
et mener des procès qui ne sont que des parodies de justice. Ainsi l’institution a-t-
elle seulement l’apparence de la justice, mais en réalité elle n’est pas juste. Elle a
condamné un Socrate innocent.
Cette expérience fondatrice pour la philosophie va l’entraîner dans une voie de
méance à l’égard du discours juridique et plus largement de la fragilité politique.
Selon Platon, la vraie justice relève de l’idée. C’est une justice parfaite, absolue,
en vertu de laquelle jamais un innocent ne pourrait être condamné. L’expérience
du procès de Socrate conduit donc Platon à énoncer, sous la forme d’un mythe, les
conditions d’une juste justice, à savoir le recours à des juges qui seraient délivrés
des apparences. Platon afrme le caractère mythologique de son modèle de justice
en rapportant, par la bouche de Socrate, les propos de Zeus : « A présent en effet les
sentences des juges sont de mauvaises sentences : c’est que les gens que l’on juge sont
jugés tout habillés, puisqu’ils sont jugés vivants. (…) Aussi les juges se laissent-ils
éblouir (…) attendu que, en même temps, c’est tout habillés, eux également, qu’ils
prononcent leur sentence (…). Il faut qu’on juge complètement mis à nu de tout cela :
15 plAton, Apologie de Socrate, 17d-18d, Paris, Garnier-Flammarion, 1965, p. 27-28. Face
au déroulement du procès, Socrate apparaît donc volontairement naïf. Pourquoi aurait-il besoin
de la rhétorique, alors qu’il se défend avec la vérité et l’idée de justice pour seuls guides ? « S’il
s’agit de se défendre lorsqu’on est accusé d’une injustice qu’on a soi-même commise, (...) la
rhétorique ne nous sera d’aucune utilité. (...) Il faut donc se forcer, soi-même et les autres, à ne
pas être épouvanté à l’idée de la punition, mais à vouloir se livrer à la justice, plein de conance
et de courage » (plAton, Gorgias, 480a-c, op. cit., p. 207).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%