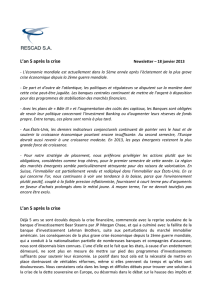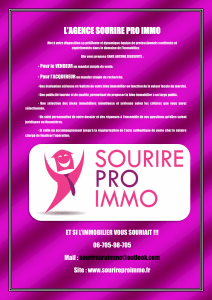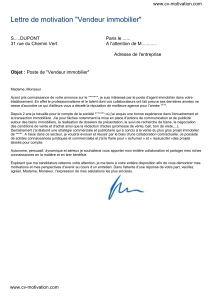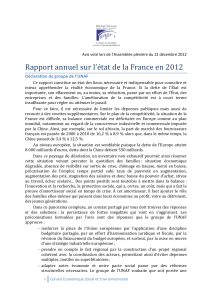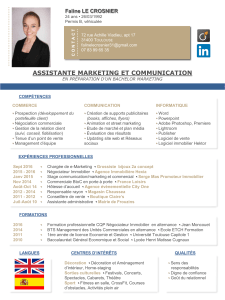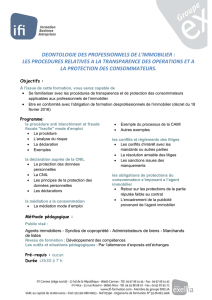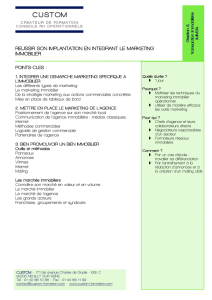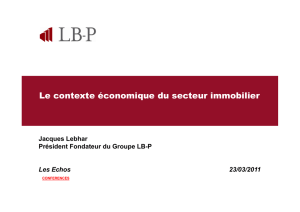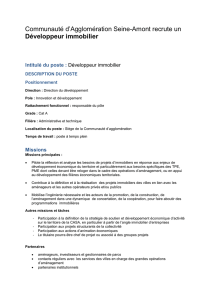Les familles et la crise_M-Cornilleau

Pour visionner les débats : http://www.unaf.fr/spip.php?rubrique835 - page
1
« LES FAMILLES ET LA CRISE »
Extrait de l’Université des familles
du 6 mars 2009
Intervention de :
Gérard CORNILLEAU
Directeur adjoint au département
des études « macro-économie, marché du travail, politiques sociales »
de l'OFCE

Pour visionner les débats : http://www.unaf.fr/spip.php?rubrique835 - page
2
La vision de l’OFCE
Gérard CORNILLEAU
Directeur adjoint au département
des études « macro-économie, marché du travail, politiques sociales »
de l'OFCE
La crise actuelle nous place dans une situation très originale, que l’on rencontre très rarement. De ce fait, il est
complexe d’établir un diagnostic et, surtout, de réaliser un pronostic sur l’évolution de cette crise au cours des mois
à venir. Au mieux peut-on tracer quelques scénarios.
I. Les ressorts de la crise financière
La crise mondiale que nous connaissons aujourd’hui est la plus grave depuis 1929. Elle est peut-être même encore
plus profonde que celle-ci. À l’origine, nous avons assisté à une cascade de crises, comme un château de cartes qui
s’est effondré. La première carte à tomber a été celle du secteur immobilier aux États-Unis, sous l’effet de
l’éclatement d’une bulle spéculative qui avait gonflé au cours des années précédentes. Ce phénomène a touché
essentiellement les États-Unis et très peu l’Europe, à l’exception de l’Espagne. La crise des subprimes a engendré une
spirale très rapide de dépréciation des actifs, c'est-à-dire d’écroulement des bourses mondiales, avec une perte de
valeur considérable des banques et de l’ensemble des institutions financières. Ce mouvement a débouché sur des
crises de change plus ou moins latentes dans un certain nombre de pays et, finalement, sur une crise de l’économie
réelle.
En ce qui concerne la crise immobilière, la croissance extrêmement forte de l’investissement immobilier aux États-
Unis a été alimentée par un accès au crédit très facilité, ce qui a induit une augmentation très rapide du prix des
biens immobiliers. Cette bulle, qui a explosé en 2008, a d’abord été alimentée par le mécanisme des subprimes. Celui-
ci consistait à garantir le remboursement d’emprunts contractés par des personnes qui, en réalité, n’avaient pas les
moyens de rembourser les montants empruntés. Le remboursement était garanti par la croissance escomptée de la
valeur du bien immobilier. Les sommes à rembourser, d’abord très faibles, augmentaient considérablement avec le
temps jusqu’à atteindre des niveaux insupportables pour les emprunteurs qui pouvaient alors vendre leur bien afin
de réaliser les remboursements résiduels. La vente du bien n’était même pas nécessairement effective : il suffisait en
effet de contracter un nouveau crédit. Le système consistait finalement en un pari sur une croissance perpétuelle
des prix immobiliers. Ce pari s’est révélé erroné puisqu’à un certain stade, ces prix ont cessé d’augmenter de
manière extravagante. De ce fait, les emprunteurs se sont trouvés dans l’impossibilité de rembourser et des
défaillances sont intervenues dans le secteur immobilier.
Les subprimes ont été l’élément déclencheur de la crise financière, mais l’ampleur qu’elle a prise est liée à d’autres
éléments que le choc initial dont l’importance doit être relativisée. Il existait, aux États-Unis, 2 200 milliards de
dollars de crédits de ce type, dont 30 % présentaient un risque de défaut réel, ce qui correspond au maximum à 700
milliards de dollars. Ce montant est évidemment dérisoire au regard du montant total des actifs des ménages états-
uniens qui atteint 60 000 milliards de dollars. Comment ces 700 milliards ont-ils pu générer 20 000 milliards de
pertes de valeur d’actifs finalement comptabilisés sur l’ensemble de la planète ? Tout le monde sait désormais que le
défaut de régulation du système financier international a permis aux subprimes de diffuser leur « venin » à travers tout
le système, essentiellement grâce au mécanisme des CDS, dispositif d’assurance des prêts à risques.
Pour se protéger du risque de non-remboursement, les banques ou les entreprises peuvent transférer le risque à des
spéculateurs en contrepartie d’une rémunération. Le problème tient au fait que ces CDS ont été redécoupés et
revendus à de multiples reprises, dans des conditions totalement opaques, si bien que nul n’était en mesure de
déterminer le risque effectivement supporté par chaque banque. Cette opacité complète du système financier a

Pour visionner les débats : http://www.unaf.fr/spip.php?rubrique835 - page
3
conduit à une défiance généralisée, naturellement aggravée par la faille de Lehman Brothers. Ce défaut de régulation
générale est la cause réelle de la crise actuelle. Dans un climat de méfiance généralisée, les banques ont cessé de
s’accorder des prêts et les anticipations sont devenues négatives partout, ce qui a conduit à une dépression de
l’ensemble des bourses mondiales. Se sont ajoutées à cela un certain nombre de crises dans certains pays, comme
l’Islande, les États baltes ou la Hongrie.
Cette crise s’est traduite par un blocage quasiment total du marché interbancaire, dont le taux a cru très fortement,
générant un phénomène de « fuite vers la qualité ». Aujourd’hui, la valeur refuge est la dette publique, seul actif dans
lequel on a encore confiance parce qu’il est garanti par les États. Aux États-Unis, en particulier, l’orientation des
politiques économiques a été complètement revue. Désormais, l’État intervient dans l’activité économique et tous
les acteurs souhaitent lui prêter, si bien que les taux d’intérêt sur les emprunts d’État sont tombés à des niveaux
particulièrement bas. A l’inverse, il existe une très forte défiance à l’égard des agents économiques privés. De
nombreuses entreprises privées ont vu leur notation se dégrader significativement. Dans le même temps, les taux
d’intérêt publics de long terme ont baissé très fortement. Les investisseurs privilégient désormais le secteur public
sur le secteur privé pour leurs investissements.
Du fait de cette dévalorisation considérable des actifs, les agents économiques les plus fortunés ont perdu une
partie de leurs richesses et, de ce fait, sont plus prudents qu’auparavant. Ils ont donc tendance à reconstituer leurs
encaisses réelles en épargnant, ce qui réduit leur consommation. Dans la période antérieure, la montée des prix de
l’immobilier et des actions, notamment, alimentait la consommation, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Nous
sommes donc confrontés à un choc important sur la demande, qui est le fait des ménages les plus riches, dont la
part a fortement progressé durant les années précédentes, ce qui constituait d’ailleurs un élément de fragilité. Ceci
est naturellement valable à l’échelle internationale. En France, la crise se joue sur un mode très mineur par rapport
aux États-Unis.
Le deuxième mécanisme important pour comprendre le passage de la crise financière à la crise réelle est
l’investissement. Dans une conjoncture aussi dégradée, avec des anticipations aussi mauvaises, les entreprises ne
sont pas incitées à investir. Par conséquent, cette composante de la demande mondiale qu’est l’investissement
s’écroule véritablement. Ainsi, la Chine pourrait voir sa croissance ramenée de 10 à 3 %, ce qui serait considérable.
En outre, les pays fournisseurs de l’ensemble du monde, comme la Chine, l’Allemagne ou la France, voient leur
demande à l’exportation diminuer, ce qui contribue également au ralentissement de leur activité.
II. Perspectives pour 2009
2009 sera une année difficile, mais on peut se demander si elle constituera simplement une parenthèse, avec un
redémarrage de l’économie mondiale dès l’année 2010, ou si elle pourrait être plus prolongée. Pour la France,
l’OFCE anticipe à ce jour un recul de la production de l’ordre de 2,2 %, ce qui représenterait le double du recul
enregistré lors des crises de 1993 et 1974. Au niveau mondial, le commerce pourrait reculer pour la première fois
depuis très longtemps alors qu’il a progressé de 7 % en 2007 et de 4 % en 2008. Le PIB mondial devrait se rétracter
de 1 %, avec une croissance chinoise ramenée de 12 % en 2007 à 4 % en 2009. Les États-Unis devraient, pour leur
part, connaître une baisse de la production de l’ordre de 2,8 %. 2009 sera donc très clairement une année de
récession particulièrement marquée, mais il s’agit de savoir si elle signifiera, ou non, l’entrée dans un long tunnel de
crise.
En France, quatre chocs ont affecté notre économie en 2008.
Le premier est un choc sur le pouvoir d’achat, lié à la hausse du prix du pétrole, qui n’est plus d’actualité
aujourd’hui. L’inflation a atteint 3,6 % en 2008, si bien que le pouvoir d’achat des salaires n’a pas progressé.
Le deuxième choc a touché les changes : le dollar a reculé par rapport à l’euro, ce qui a dégradé de manière sensible
la compétitivité des produits européens.
Le troisième choc concerne l’immobilier. Dans la suite du retournement du marché aux États-Unis, les prix de
l’immobilier se sont stabilisés en France. Au cours de la période antérieure, les prix de l’immobilier ont progressé
bien plus rapidement que les loyers, si bien que le rendement des investissements immobiliers a diminué.
Désormais, on anticipe un retour des rendements des placements immobiliers au niveau où ils se trouvaient avant
le début de la bulle immobilière, à la fin des années 90. De ce fait, une baisse des prix de l’ordre de 10 % devrait
intervenir d’ici à la fin de l’année 2010.
Le dernier choc auquel a été soumise l’économie française en 2008 a été la chute des bourses qui a atteint 40 % en
fin d’année. En 2008, la croissance française s’est limitée à 0,7 % alors qu’elle aurait dû atteindre près de 3 % en
l’absence de choc. Cet écart s’explique, pour 1,2 % par une perte de pouvoir d’achat, 0,3 % par l’appréciation de
l’euro face au dollar, 0,2 % par la baisse des prix de l’immobilier et 0,7 % par les répercussions de la crise financière.
En 2009, la situation restera sensiblement identique, à ceci près que la hiérarchie des chocs évolue. En ce qui
concerne le pouvoir d’achat, le prix du pétrole a été divisé par trois, ce qui sera positif sur l’inflation. Il est même

Pour visionner les débats : http://www.unaf.fr/spip.php?rubrique835 - page
4
envisagé une baisse des prix pendant quelques trimestres de l’année. À l’inverse, la hausse très forte du chômage
pèsera sur les salaires, ce qui devrait limiter significativement la hausse du pouvoir d’achat. Pour ce qui est du
deuxième choc, les agents privés ne peuvent plus s’endetter et les profits des entreprises sont anticipés à la baisse,
ce qui impactera l’investissement de ces dernières. Il devrait en résulter une nouvelle chute de l’investissement
productif, mais aussi immobilier. En 2009, l’ensemble de ces chocs devrait réduire le PIB de plus de 4 %, soit deux
fois plus qu’en 2008, ce qui devrait conduire à une récession de 2 %. Les anticipations actuelles sont d’ailleurs très
négatives.
La situation du marché du travail est très mauvaise. L’emploi salarié recule significativement, dans la suite du
mouvement engagé en 2008. Ce mouvement est facilité par la très grande flexibilité du marché du travail. Avec un
nombre croissant d’intérimaires et de contrats à durée déterminée, les entreprises peuvent ajuster très rapidement
leurs effectifs aux besoins de la production. Dans la période antérieure, il existait un phénomène de stabilisation
automatique en raison de délais importants entre le constat d’un sureffectif et celui auquel on pouvait effectivement
procéder à des licenciements. Le mécanisme des heures supplémentaires, introduit par la loi TEPA, a un effet
paradoxal : les heures supplémentaires se maintiennent à un niveau élevé alors qu’en période de crise, leur
diminution est traditionnellement un mode simple de partage du travail permettant d’éviter certaines suppressions
d’emploi. D’une certaine manière, la politique de l’emploi contribuera à la dégradation de l’emploi, ce qui est un peu
paradoxal. A ce stade, il est anticipé une perte de plus de 600 000 emplois, avec un taux de chômage de près de
10 % en fin d’année.
III. Possibilités d’une sortie plus rapide de la crise
Toutes les anticipations s’accordent à considérer que la croissance sera négative en 2009, voire en 2010. En outre, il
existe un consensus sur le fait que cette crise aura une fin et sera, à terme, surmontée. Il peut exister des possibilités
de sortir plus rapidement de cette crise. A cet égard, la politique budgétaire constitue l’arme essentielle pour éviter
que la crise ne se transforme en véritable catastrophe. Les États-Unis ont mis en place des plans de relance très
ambitieux, de même que la Chine, mais l’Europe est très en retrait en la matière, faute d’une coordination efficace
des politiques économiques au sein de l’Union, ce dont on peut s’inquiéter. Cependant, la politique budgétaire
restera expansive en Allemagne et en France, mais très peu en Italie, ce qui est le signe d’un dysfonctionnement
évident de la politique économique européenne.
Au niveau planétaire, on peut tout de même constater un alignement des politiques économiques qui permet d’être
optimiste. En l’absence de soutien budgétaire, il y aurait tout lieu de s’inquiéter, mais il faudra aussi agir à d’autres
niveaux. En particulier, il s’agira d’éviter que les pays en risque de faillite généralisée n’y succombent réellement. Il
faudra maintenir un certain nombre de pays émergents, en particulier en Europe, même si les débats européens
n’ont pas permis de faire émerger un consensus sur ce point. Il s’agit d’un élément de fragilité, mais on peut
raisonnablement rester relativement optimiste.
J’évoquerai maintenant les stabilisateurs automatiques avant d’en venir à la question de la dette publique.
Par rapport à 1929, la situation actuelle est, d’une certaine manière, plus favorable parce qu’il existe des
stabilisateurs automatiques importants. En 1929, il n’existait quasiment pas d’assurance-chômage. Dans la crise
actuelle, le chômage augmentera massivement, mais les chômeurs recevront un minimum d’indemnités, ce qui
contribuera à limiter le recul de l’économie. Toutefois, pour être efficaces, les stabilisateurs économiques doivent
être laissés libres d’agir. Or, lorsque le PIB recule de 1 %, il en résulte trois ans plus tard une hausse de 1,5 % du
chômage et une dégradation de 8,2 % du solde financier de l’UNEDIC. Cet organisme connaîtra, dès 2009, un
déficit qui s’aggravera en 2010 et 2011. Il est impératif que ce déficit subsiste. Ce serait une grave erreur de combler
ce déficit en élevant les cotisations ou en réduisant les prestations. Ce déficit fait partie des stabilisateurs
automatiques de l’économie. Aujourd’hui, lutter contre le déficit reviendrait à reculer le moment de la reprise
économique et augmenter le chômage. Ce déficit conduira à une augmentation de la dette publique en 2009 à 73 %
du PIB. Cette dette publique sera supérieure au niveau de 60 % du Traité de Maastricht, mais elle revêtira une
importance fondamentale. De plus, il convient de relativiser l’importance de cette dette brute. En effet, l’État
possède des actifs, y compris financiers, si bien qu’en réalité, sa dette nette est négative : il est excédentaire.
Par ailleurs, la question de la transmission de la dette aux générations futures est une plaisanterie. En réalité, on
transmet à ses enfants ses dettes, mais aussi les actifs correspondants. Au sein des générations futures, certains
hériteront de la dette et d’autres de son remboursement. Il ne s’agit donc pas d’un problème de transfert aux
générations futures. La question est celle d’un transfert à l’intérieur de chaque génération. Dans la génération
actuelle, certains prêtent et d’autres empruntent d’une manière implicite. Dans les générations futures, certains
rembourseront et d’autres percevront des revenus, mais l’idée selon laquelle nous transmettons la dette à nos
enfants est erronée. Limiter l’endettement public serait une erreur très lourde. La croissance de cet endettement
permettra à nos enfants d’éviter des situations bien pires que celles que l’on envisage aujourd’hui.
1
/
4
100%