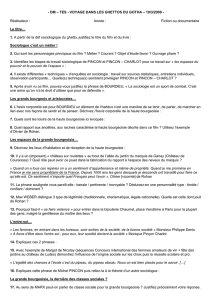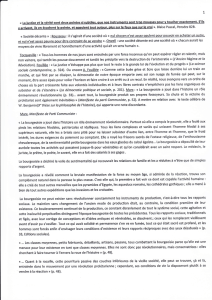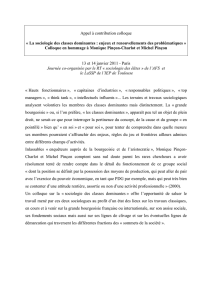La formation de la nation française

Accueil
Actualité
Pamphlet F. Hollande
Cours de philosophie
Introduction
Livre I : L’idéologie philosophique
Livre II : Conscience et individualité
livre III: le rapport au monde
livre IV: la raison et le réel
livre V: la morale
Livre VI: le politique
Livre VII: de l'anthropologie à l'histoire
Livre VIII: qu'est ce que l'art?
Culture philosophique
Philosophes
Notions
Lectures
Dissertations
Culture générale
Histoire
La réforme
Société
Culture littéraire
cours synthétiques
théâtre
auteurs
oeuvres
poésie
antiquité
Culture politique
La Question du communisme Lucien Sève
Introduction au marxisme I II III
La pensée politique au XVIIIème
Poèmes
Présentation
Poème du partage
Poèmes du ravage
Poèmes politiques
Poèmes du voyage
Poèmes de l'alliage
Poèmes du village
Poèmes de l'échange
Dernière balade Galerie de peinture
LA FORMATION DE LA NATION FRANÇAISE
Menu
LA FORMATION DE LA
NATION FRANÇAISE
ANTISÉMITISME
LE FASCISME
NATIONALISME
ACCUEIL ACTUALIT
ÉCOURS DE
PHILOSOPHIE CULTURE
PHILOSOPHIQUE
CULTURE
GÉNÉRALE CULTURE
LITTÉRAIRE CULTURE
POLITIQUE POÈMES GALERIE
DE
PEINTURE
La formation de la nation française
Extraits du livre de Germaine et Claude Willard
La féodalité et la formation des éléments nationaux jusqu’au début du XIVème siècle
842 - Serment de Strasbourg, premier document en langue romane
843 - Partage de Verdun. Charles le Chauve reçoit la partie occidentale de l’ancien empire de Charlemagne.
911 - Installation des Normands en Normandie
1096 - Première croisade
Philippe Auguste (1180-1223)

1200 - Le chœur et la nef de Notre-Dame de Paris sont achevés.
Fondation de l’Université de Paris
1203 - Philippe Auguste rattache au domaine royal de Normandie l’Anjou, le Maine et la Touraine
1214 - Bouvines
Louis VIII (1223-1226)
1224 - Louis VIII rattache le Poitou et la Saintonge
Louis IX – Saint Louis (1226-1270)
1229 - Rattachement d’une partie du Midi après la croisade des Albigeaois
Philippe IV le Bel (1285-1314)
1302 - Philippe IV réunit les premiers états généraux
La nation française est une communauté d’hommes qui s’est constitué au cours du développement historique. On considère que le traité de Verdun de 843
marque les débuts de la nation. Ce traité partage l’Empire de Charlemagne, vaste conglomérat de tribus et de peuples menant leur vie propre, ayant leur
langue particulière : conglomérat éphémère. Des éléments de la nation commencent à apparaître : la différenciation des langues entre les royaumes est
nette. Dès le IXe siècle, on peut reconnaître à l’état embryonnaire certains des éléments constitutifs de la nation. Mais pour que la nation devienne une
réalité, il faut que ces éléments se développent et se stabilisent, donc que s’établisse entrez les différentes parties de la future nation une liaison économique
continue qui les soude en un tout unique.
a. Le mode de production féodal et son rôle dans la formation des éléments nationaux
Le mode de production féodal domine la France à partir des IXe-Xe siècles. La propriété féodale du seigneur coexiste avec l’exploitation individuelle
du producteur (le serf).
Les rapports sociaux sont des rapports de dépendance étroite entre la paysan et le seigneur. Le seigneur exploite le paysan, qui lui paye des redevances et
des contributions. Les paysans, qui ne sont pas libres, peuvent être achetés ou vendus. Ils ne peuvent accomplir les actes de la vie (mariage…) sans
l’autorisation payante. Le seigneur, menacé par les guerres, le brigandage, doit avoir un fort appareil de répression. Les paysans ne peuvent guère se
défendre. D’autre part, ils souffrent des caprices de la nature (disette, famine), qui les conduisent à ne manger que de l’herbe, voire de la chaire humaine.
Aux souffrances physiques s’ajoute l’humiliation : méprisés, ils sont des êtres mineurs.
Cette inégalité fondamentale est érigée en loi. Il y a trois ordres mais deux classes : d’un côté les nobles qui combattent et les clercs qui prient ; de l’autre
les serfs qui doivent « fournir à tous l’or, la nourriture et le vêtement ». Telle sera, jusqu’à la Révolution française, la base juridique de la société.
L’écrasante emprise de l’Eglise vient justifier cette exploitation. Le paysan ne peut espérer d’aide que de l’Eglise et de sa charité. Il s’imprègne de cette
religion qui leur fait espérer une vie meilleure. L’Eglise est la seule influence intellectuelle.
La France est le pays où s’est constitué le plus tôt et le plus complètement le régime féodal. La lutte des classes est ainsi précoce, et explique la force des
traditions révolutionnaires françaises.
Cependant, la féodalité est une étape nécessaire et positive dans le développement de la société. Le paysan est directement intéressé à la production qui lui
revient, une fois payés les droits seigneuriaux. Il recherche dons des améliorations dans son outillage et fait ainsi progresser les forces productives. Le
morcellement féodal lui-même en une multitude de seigneuries repliées sur elles-mêmes jouent à l’origine un rôle progressif. Le cadre restreint de la
seigneurie permet, mieux que de grands Etats, d’ordonner une économie fondée sur des forces productives mesquines. Le seigneur organise la vie
économique, il impose la diffusion de certaines pratiques, le rythme des travaux.
b. L’essor de la société féodale et le développement de la bourgeoisie
Les progrès agricoles se traduisent par de « grands défrichements », qui permettent d’agrandir les revenus des seigneurs. En même temps, l’outillage et les
opérations industrielles se compliquent et se spécialisent. La production industrielle, simple annexe de la production agricole exige maintenant des
artisans spécialisés, qui s’installent dans les anciennes villes. Les serfs, fuyant le domaine seigneurial, dans l’espoir de meilleures conditions de vie, vont
grossir cette population urbaine et en former la masse essentielle. Avec la croissance des centres spécialisés d’industrie et de commerce, s’opère dans la
société féodale la première grande division du travail : entre le métier et l’agriculture, entre la ville et la campagne.
Cette division du travail permet d’élargir les liens économiques. La ville conserve cependant son aspect campagnard. Sa production ne ravitaille
qu’une région rurale très limitée : le petit marché urbain est le cadre, extrêmement médiocre, où se nouent les premiers liens commerciaux permanents de
la ville et de la compagne.

Paris, au centre d’une région riche, aux cultures variées, utilise sa bonne situation géographique avec la Seine et les routes. A la fin du XIIIe siècle, elle
compte 60.000 habitants, et s’accroît de nouveaux quartiers sur la rive droite, devenue le centre les affaires autour des Halles que Philippe Auguste fait
construire à la fin du XIIe siècle.
Des liens s’organisent aussi à l’échelle internationale. En Normandie, la ville de Rouen fait un commerce actif en mer du Nord. La Champagne connaît
une activité commerciale débordante (les foires célèbres de Troyes, Provins, Lagny où se rencontrent les marchands d’Italie et de Flandres, d’Allemagne
d’Angleterre et de Catalogne).
La croissance des liens économiques rompt très tôt dans les régions les plus favorisées de la France du nord, l’extrême morcellement féodal. Une certaine
unification s’y dessine. Elle se marque par l’établissement d’un dialecte unique et de grands Etats féodaux, entre les régions les plus
économiquement liées : Duché de Normandie, comté de Champagne, domaine royal d’Ile de France. C’est la première étape de l’unification
territoriale.
c. Les luttes paysannes
L’essor économique et la division du travail entre le métier et l’agriculture entraînent une différenciation capitale au sein de la société féodale : une
nouvelle couche sociale naît, origine de la bourgeoisie, dont l’importance primordiale apparaît immédiatement : les artisans et les commerçants.
La ville doit alors engager la lutte contre la domination seigneuriale, contre le morcellement féodal qui entravent son développement. Dès le XIe siècle, se
constituent les premières corporations qui fournissent le cadre de lutte contre le seigneur. Les rapports féodaux gênent l’essor de la ville : la majorité de
ses habitants sont des serfs.
Au XIe siècle éclate « le mouvement communal », première apparition de la bourgeoisie sure la scène historique. Les villes tentent d’arracher aux
seigneurs des chartes qui accordent la liberté personnelle aux habitants, la limitation et la fixation des droits seigneuriaux, une certaine autonomie.
Le seigneur accepte parfois la charte proposée, mais souvent la lutte armée est nécessaire. Le mouvement communal connaît son apogée au XIIe siècle.
La lutte paysanne prend, elle aussi, un grand essor.
Le renforcement des liens économiques rend plus faciles l’organisation d’ententes entre villages et villes. Le développement économique, le mouvement
communal et l’affaiblissement de la puissance seigneuriale favorisent l’action paysanne.
Les croisades, entreprises par les féodaux dans l’espoir de conquérir des terres nouvelles, d’amasser un riche butin pour remédier à leurs difficultés, vont
souvent fournir une issue aux mouvements paysans. En 1212, 30.000 pauvres parmi lesquels un nombre considérable d’enfants, partent vers la
Palestine. Une mort certaine attend tous ces croisés populaires, très mal armés et sans organisation. La foi, l’ignorance des difficultés ne peuvent, à elles
seules, expliquer ce suicide collectif. Les paysans partent, avant tout, pour fuir, la lourde exploitation seigneuriale et l’atroce misère qu’elle engendre.
En 1251, à la prédication pour la VIIe Croisade répond un vaste soulèvement paysan, la Révolte des « Pastoureaux » : des prédicateurs populaires
expliquent que Jérusalem sera sauvée non par des féodaux, égoïstes et vaniteux, mais par les pauvres qu’ils méprisent. Du Nord, les masses paysannes
marchent vers Paris où elles entrent, puis continuent vers le Sud. Elles exécutent des membres du Clergé, s’emparent de leurs richesses ; partout, le peuple
les accueille et les soutient. Mais leur détachement est facilement écrasé par les armées royales.
Pressés par la résistance quotidienne des paysans, séduits par les avantages des chartes, les seigneurs commencent à affranchir les serfs. Au XIIIe siècle,
ce mouvement connaît son plein épanouissement. La disparition, précoce du servage en France explique en partie pourquoi le développement
capitaliste s’y est fait plus vite que dans les autres pays d’Europe, où le servage domine jusqu’au XVIIIe siècle, voire jusqu’au XIXe siècle. La
disparition, du servage, la limitation des droits seigneuriaux donnent à la petite exploitation de l’artisan et du paysan une indépendance plus grande. Ce qui
encourage les efforts des producteurs davantage intéressés à leur travail et favorise ainsi l’essor économique de la société au XIIe et XIIIe siècles.
Le rôle de l’Etat monarchique dans la consolidation des éléments nationaux.
Toutes ces transformations entraînent aux XIIe et XIIIe siècles un accroissement du pouvoir monarchique. Le roi n’est à l’origine qu’un seigneur mais qui
embrasse un pays riche (l’île de France) à l’essor économique rapide. Les revenus royaux augmentent, permettant au roi d’accroître ses forces militaires.
Chef de la hiérarchie féodale, le roi est appelé à freiner la résistance de la paysannerie exploitée. Il est à la tête de la défense extérieure du royaume.
Les villes vont appuyer l’Etat royal car ils ont les mêmes adversaires : les grands féodaux. La ville donne au roi de l’argent et des forces militaires
(les milices) ; le roi garantit aux villes des chartes de franchise, assure leur sécurité.
Le signe extérieur qui marque le renforcement de l’Etat monarchique est l’agrandissement rapide du domaine royal, notamment sous les règnes des grands
rois capétiens Philippe Auguste (1180-1223), Louis IX ou Saint Louis (1226-1270) et Philippe le Bel (1285-1314).
Au début du XIVe siècle, le domaine royal recouvre la plus grande partie de la France : il débouche sur la Manche, l’Atlantique et la Méditerranée,
atteint la Meuse ; les seules grandes formations féodales qui demeurent hors de son domaine sont la Bretagne, la Bourgogne, la Flandre et l’Aquitaine.

Dans l’extension de sa puissance, le roi se heurte aux grands féodaux indépendants. Pour lutter contre eux, il utilise les armes que lui donne la société
moderne en développement, l’appui des villes notamment, mais aussi ses pouvoirs de roi féodal, chef de la hiérarchie seigneuriale. Cette lutte s’explique
aussi par l’existence de deux peuples sur le territoire français.
La France du sud, dont le comté de Toulouse est l’unité politique essentielle, constitue à l’époque un peuple distinct. Le sud a sa propre langue (langue
d’oc), son droit, sa culture. Sa structure économique et politique est très originale. Les villes riches forment des républiques marchandes qui empêchent la
féodalité de s’établir solidement.
Au début du XIIIe siècle, le Nord profite de l’hérésie albigeoise de Toulouse pour tenter de rattacher le sud au nord. Une croisade s’organise à l’appel du
pape : elle écrase l’hérésie et permet de rattacher le comté de Toulouse au domaine royal.
Il y a dans le domaine royal une même organisation administrative : Philippe Auguste institue des fonctionnaires réguliers, les baillis, qui exercent des
fonctions fiscales judiciaires et militaires. Le roi fait, pénétrer de son autorité à l’intérieur même des seigneuries indépendantes grâce à sa justice et à sa
monnaie. Cette première centralisation monarchique augmente la cohésion sociale du royaume, facilite les liens économiques et culturels.
Le rôle important de l’Etat monarchique dans la consolidation des éléments nationaux explique pourquoi, pendant longtemps, le sentiment
national s’identifie au sentiment monarchique. L’importance économique et politique de Paris ne cesse de grandir, et c’est le francien qui fournit la
base essentielle de la langue unique.
Les débuts de la culture nationale
La culture nationale est une culture de classe : les premières grandes œuvres littéraires sont les chansons de gestes (Xe-XIIIe siècles) qui exaltent le
dynamisme, la grandeur de la classe féodale.
La religion catholique marque profondément cette culture. La foi anime les classes populaires inspire des chefs-d’œuvre. Dans les cathédrales
gothiques de Paris, Chartres, Amiens, Reims, à la foi profonde s’unissent l’esprit satirique du peuple (saints et gargouilles). Les épisodes religieux servent
souvent de prétexte à la représentation de scènes de la vie courante.
Des caractères analogues se retrouvent dans le théâtre. Il naît aux Xe-XIe siècles à l’intérieur même de l’Eglise ; au cours de l’office, des répliques en
latin puis en langage courant sont échangées entre le prêtre et le chœur. Le théâtre sort de l’édifice culturel : les drames religieux sont joués sur le parvis
de l’église par des artistes spécialisés ; au XIIIe siècle, les « miracles » sont des spectacles grandioses où au récit des saints s’ajoutent des tableaux de
mœurs.
L’importance croissante des éléments laïcs dans les œuvres religieuses montre que l’Eglise perd dès le XIIe siècle le monopole de la culture.
Un facteur décisif de la formation de la culture nationale est le développement de la culture urbaine. Cette culture s’élabore comme une arme de
lutte pour soutenir idéologiquement la pratique anti-féodale de la bourgeoisie et des classes exploitées. Elle est nourrie par les traditions populaires.
- La culture urbaine met au premier plan les méthodes de pensée rationaliste. Les écoles privées, que la bourgeoisie crée pour ses propres besoins, dès le
XIIe siècle, échappe à la tutelle de l’Eglise. Au programme : des auteurs antiques (Aristote), des doctrines philosophiques, qui s’opposent à la théologie.
Les universités se créent au XIIIe siècle et en subissent l’influence.
L’Eglise revendique son monopole culturel et attaque les écoles libres. Elle s’efforce de dominer l’université. Et utilise les modes de raisonnement et les
auteurs introduits par l’enseignement libre (Thomas d’Aquin soumet la raison et la science à la religion). Les méthodes de pensée rationaliste sont
détournées de leur but par l’Eglise et servent en définitive à la renforcer.
- La deuxième arme de la culture urbaine est la satire. La bourgeoisie introduit le comique dans la littérature française. Les œuvres les plus
caractéristiques sont les fabliaux ; ils glorifient l’ingéniosité, le bon sens populaire. La cupidité du clergé est dénoncée.
Le roman de Renart, épopée satirique et parodique, a un immense succès au XIIIe siècle. Il dépeint sous les traits d’animaux, les principaux personnages
de la société féodale. Dans cette littérature urbaine qui exprime les sentiments anti-féodaux des masses populaires, apparaissent déjà les signes de
différenciation sociale à l’intérieur de la ville. Renart, représentant des couches dirigeantes de la ville, triomphe des féodaux et de leur force brutale par
son intelligence. Mais il pille et persécute les petites gens.
- Troisième caractère de la culture urbaine : l’amour de la vie et des biens matériels, opposés à l’ascétisme prêché par l’Eglise, artistes et écrivains
peignent avec réalisme la vie quotidienne. Danses populaires, fêtes campagnardes tiennent une large place dans le théâtre urbain naissant

o-O-o
La crise de la guerre de cent ans
(XIVe et XVe siècles)
Philippe VI de Valois (1328-1350)
1346 - Crécy, premier grand désastre français de la guerre
Jean Le Bon (1350-1364)
1356 - Nouveau désastre à Poitiers. Le roi Jean le Bon est fait prisonnier
1357-58 - Révolte d’Etienne Marcel. Grande Jacquerie
Charles V le Sage (1364-1380)
1370-80 - Succès de Du Guesclin. Les Anglais sont presque entièrement chassés de France
Charles VI (1380-1422)
1420 - Par le traité de Troyes, Charles VI livre le royaume aux Anglais
Charles VII (1422-1461)
1429-31 Epopée de Jeanne d’Arc
1453 - Fin de la guerre de Cent Ans. Les Anglais ne gardent en France que Calais
1456-61 - Petit Testament et Grand Testament de Villon
Louis XI (1461-1483)
1470 - Premier atelier d’imprimerie à Paris
1480 - Louis XI obtient la Provence. Marseille, ville française
1482 - Rattachement définitif de la Bourgogne et de la Picardie
Charles VII (1483-1498)
1491 - Rattachement de la Bretagne
a- La décadence de la féodalité
Au début du XIVe siècle, les revenus de la seigneurie ne satisfont pas les besoins grandissants du propriétaire. La féodalité cherche naturellement à faire
retomber sur les autres classes de la société la crise qu’elle subit. Les chartes sont interprétées ou cyniquement violées : le seigneur essaie de réserver les
communaux à son propre usage.
Certains féodaux s’efforcent de mettre la main sur l’Etat monarchique. Les guerres sont impatiemment attendues par les seigneurs (rançons, pillages).
Or la guerre de Cent Ans (1337-1453) contre l’Angleterre va démontrer la décadence de la féodalité.
1) d’abord sur le plan militaire.
La guerre s’ouvre par des désastres. L’armée anglaise n’est plus de type féodal. C’est une solide infanterie de paysans libres, disciplinés. L’armée
française est formée de féodaux, lourdement armés, combattant à cheval, individuellement, refusant de se plier à une discipline d’ensemble. L’armée
anglaise est supérieure : ils gagent à Crécy (1346), Calais (1347) et Poitiers (1356)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
1
/
52
100%
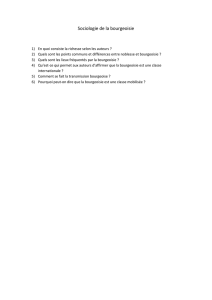
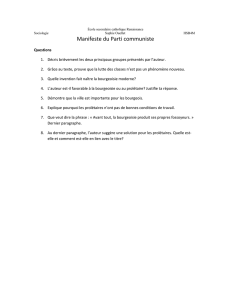
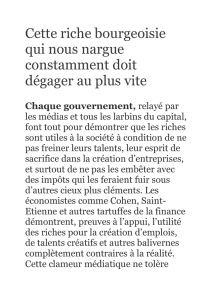
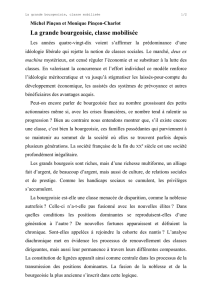
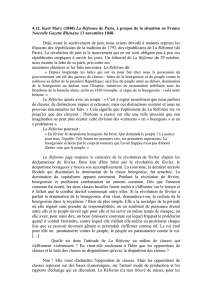
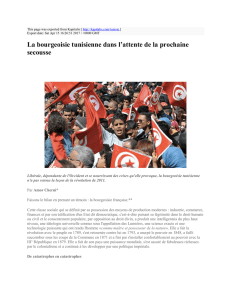
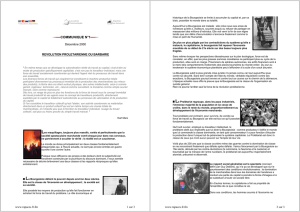
![séance du 12 octobre 2011 [Mode de compatibilité]](http://s1.studylibfr.com/store/data/002668868_1-06947beb75f93cfb0cbb41a15efae1ca-300x300.png)