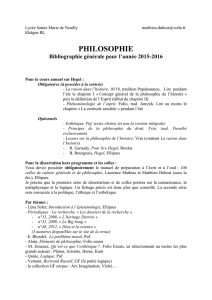Jean-Marc FERRY - Quelle société du savoir pour l`Union

Jean-Marc FERRY - Quelle société du savoir pour l'Union européenne ?
Extrait du Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie
http://www.ihest.fr/la-mediatheque/collections/seances-publiques/ouverture-du-cycle-national-2015/jean-m
arc-ferry-quelle-societe-du
Ouverture officielle du cycle national 2015-2016
Jean-Marc FERRY - Quelle
société du savoir pour l'Union
européenne ?
- La Médiathèque - Collections - Séances publiques - Ouverture du cycle national 2015-2016 -
Date de mise en ligne : mardi 8 décembre 2015
Copyright © Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie -
Tous droits réservés
Copyright © Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie Page 1/8

Jean-Marc FERRY - Quelle société du savoir pour l'Union européenne ?
Vidéo réalisée lors de l'ouverture du cycle national 2015-2016 le 15 octobre 2015.
Transcription intégrale de l'intervention
Quel enseignement peut-on conserver ? Et quelle actualité peut-on tenter d'en dégager ?
La notion de société du savoir
Société du savoir, société de la connaissance, société de l'information, société du risque aussi ou société en
réseaux, etc. Ces notions participent d'une même constellation, laquelle inclut aussi bien l'apologie que la critique.
Cependant, l'expression « société du savoir » semble préférable à celle de « société de la connaissance », qui est
plus institutionnelle. Privilégiée par les sciences sociales, l'expression « société du savoir » semble mieux
correspondre au désir d'inclure, outre différentes formes de savoir ou divers régimes de vérité, les deux versants :
know that (savoir théorique ou propositionnel) et know how (savoir pratique ou opérationnel). Cette expression de
société du savoir s'accorde à la définition anthropologique, où le savoir est plutôt ce « qu'une personne utilise pour
interpréter le monde et agir sur lui » (Fredrik Barth). Sous le regard du sociologue ou de l'anthropologue, le savoir
apparaît comme un corpus de propositions et de pratiques cognitives, c'est-à-dire susceptibles de vérité, qui sont
transmises historiquement et intégrées dans des relations sociales.
On peut faire remonter l'invention du concept à une cinquantaine d'années en y associant les noms du politologue,
Robert Lane, ou de l'économiste, Peter Drucker (dans son ouvrage traduit en français : La Grande mutation. Vers
une nouvelle société, Ed. de l'Organisation, Paris, 1970). Mais la date la plus décisive est 1973, date de l'édition aux
Etats-Unis de la monographie de Daniel Bell, traduite sous le titre : Vers la société post-industrielle. Cette étude,
avant tout prospective, ciblait les impacts du développement technoscientifique sur la stratification sociale, tout en
trahissant une certaine adhésion au processus de modernisation. Ce n'est plus le cas, dans les années 1990-2000,
avec le développement des cultural studies. On tient la société du savoir — knowledge society, Wissensgesellschaft
— pour un fait accompli, et on en lie étroitement l'analyse aux données de ladite « société de l'information » et des
NTIC. On considère que le savoir est devenu le fondement de l'ordre social, tout en y voyant un facteur de fragilité
des sociétés modernes et d'ambivalence des rapports de pouvoir. D'une part, les nouvelles technologies accroissent
le pouvoir de contrôle sur les individus. Mais, d'autre part, l'accès à ces mêmes technologies augmente les capacités
d'action des individus. C'est à partir de cette thématique, nourrie notamment par les contributions d'Antony Giddens
et de Nico Stehr, que s'est engagé le débat opposant l'apologie et la critique de la société du savoir. J'aimerais
évoquer cette critique plutôt sociologique.
Copyright © Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie Page 2/8

Jean-Marc FERRY - Quelle société du savoir pour l'Union européenne ?
Les critiques de la société du savoir
Elles prétendent engager une déconstruction du concept par contextualisation et différenciation. D'où des questions
critiques sur le mode de production et de diffusion des savoirs, ainsi que sur l'établissement de rapports
problématiques entre savoirs et processus sociétaux. L'hypothèse méthodique est qu'il y a une compénétration du
savoir et de la société, hypothèse associée à celle d'un double mouvement : de scientifisation de la politique et de
politisation de la science. Les critères d'appréciation de la recherche sont de plus en plus définis par d'autres
secteurs de la société, tandis que la recherche s'oriente vers les agences qui en appliquent les résultats. D'où la
confrontation de la science à de nouvelles contraintes de légitimation. Ce phénomène se laisse relier au thème de la
société du risque, développé par Ulrich Beck, car la production du savoir est aussi une production de non-savoir qui
fragilise la société. Ainsi que l'avait vu Niklas Luhmann, chaque secteur ayant ses propres critères d'autoréflexion, la
communication ne circule pas entre eux. Mais ces secteurs s'orientent quand même les uns aux autres, de sorte que
des transferts de savoir s'effectuent de façon routinière, réalisant comme une schématisation sociale qui particularise
le savoir au gré des échanges du local et du global.
De ces analyses , je retiens l'idée d'une dépendance (plus ou moins) réciproque entre les institutions de la recherche
et les instances de la décision politique, sans oublier le rôle important des médias de masse. Le nerf de la critique
tient à la mise en lumière d'une fonctionnalité fermée qui repose sur une logique de rétribution de services, relevant
d'une analyse des usages et gratifications — en clair : la science apporte à la politique des éléments de résolution
de problèmes concrets ainsi qu'une légitimation des décisions ; en échange de quoi l'économie et la politique, par le
truchement des médias, garantissent des ressources à la science : attention publique, notoriété pour certains
chercheurs, appui institutionnel et soutien financier à certaines orientations de la recherche ; ce qui, pratiquement,
revient aussi à fixer ce qui mérite et ne mérite pas être objet de recherche. Pour paraphraser une formule connue à
propos des médias, si la politique scientifique ne dit certes pas à la recherche ce qu'elle doit penser, elle tend
cependant à lui prescrire ce à quoi il faut penser. Peter Weingart, de l'Ecole de Bielefeld, en a mis la logique en
évidence.
Du point de vue de la science et de la recherche en général, le problème est clair : dans la mesure où les critères
d'appréciation de la recherche scientifique au sens large sont définis par d'autres secteurs, instances ou pouvoirs de
la société, la science perd son autonomie en ce qui concerne ses orientations et ses finalités.
Mon propos n'est pas de marteler une dénonciation, mais de pointer un problème : celui du risque humain et
civilisationnel que l'on fait prendre à nos « sociétés du savoir », en incitant à une hétéronomisation des orientations
de la recherche, ainsi qu'à une bureaucratisation des procédures d'appréciation ou d'évaluation des projets et des
outputs de la recherche soutenue institutionnellement. La bureaucratisation va elle-même de pair avec une
sophistication des standards d'excellence, dont la « scientifisation » sert de couverture à la politisation des intérêts
de la recherche. Les collègues de ma génération ont vécu ce passage d'une recherche organisée de façon
relativement autonome à une main-mise des Pouvoirs publics nationaux et communautaires sur les programmes, les
financements et les paramètres d'évaluation.
On en arrive à un point où se trouve occultée l'idée même qu'il puisse y avoir un débat de fond sur les critères qui
président à la sélection des thèmes et des méthodes, c'est-à-dire des problématiques et de leurs approches. En
parlant de débat de fond, je vise spécifiquement un débat portant sur ce qui est occulté par la stratégie de
scientifisation des critères d'évaluation. Cette scientifisation est liée au fait que les paramètres qui président aux
orientations de la recherche ne sont pas « autonomes » au sens où ces orientations procèdent de commandes
obéissant à des intérêts, que l'on nomme « sociétaux », et qui sont autres que les intérêts de connaissance. D'où la
nécessité d'euphémiser les critères en les rendant aussi « scientifiques » que possible. Or, de cela, les orientations
humanistes de la recherche et de la science paient le prix fort. Je reconnais que mon geste pourrait être assimilé à
celui du « soupçon », au sens où l'entendait Paul Ricoeur. A la différence, cependant, des « philosophes du soupçon
», mon propos n'est pas tant la déconstruction des stratégies (inconscientes ou non) d'occultation des options
Copyright © Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie Page 3/8

Jean-Marc FERRY - Quelle société du savoir pour l'Union européenne ?
fondamentales de notre société — ici, la société que visent à structurer les programmes de l'espace européen —,
qu'une reconstruction des intellections ou intuitions que l'humanisme a pu nous léguer pour réfléchir sur la finalité du
savoir, en faisant l'hypothèse que ces intellections ou intuitions, en particuler de Vico à Humboldt et Hegel, ont sans
doute encore quelque chose à nous dire.
Vico, Kant et l'idéalisme allemand.
Lorsqu'en 1708 Giambattista Vico donna sa leçon unaugurale sur la chaire de Rhétorique à l'Université de Naples, la
réflexion qu'il proposa sur « la méthode des études de notre temps » (De nostri temporis studiorum ratione) posait
une question de fond, une question « lourde », dirait-on, mais que le génie italien de Vico savait présenter avec une
grande élégance, sous le couvert d'une question toute pratique : par quelles études nos jeunes étudiants
devraient-ils commencer ? Les études classiques, la topique, la rhétorique, la dialectique : Aristote ? Ou les études
modernes, la critique, la logique de Port-royal : Descartes ?
La Rhétorique apprend aux jeunes gens à se familiariser avec les topoï du sens commun, ces « lieux communs » de
ce que les gens tiennent pour vrai, le vraisemblable. La Critique, cependant, s'en tient à la pure et dure nécessité
déductive dans un but de fondation rationnelle qui n'a d'autre fil directeur que le vrai. Et Vico de discuter des
avantages et inconvénients respectifs de ces deux genres de savoir qu'apparemment tout oppose. Voici, dite vite et
mal, sa proposition pédagogique : mieux vaut commencer par les études classiques, car ainsi les étudiants éviteront
cet écueil de la jeunesse, la témérité assortie d'une certaine arrogance, en prétendant aller directement au vrai, sans
tenir compte des entrelacs complexes de l'existence — nous dirions, des contextes — et sans souci de ce que les
gens tiennent pour vrai, ce qui peut générer des catastrophes. Pour autant, il convient de prévenir l'écueil symétrique
d'une mondanité érudite et vaniteuse où risqueraient de s'enliser des esprits exclusivement formés à la topique et à
la rhétorique, sans être exercés aux rigueurs disciplinaires d'une logique qui vise la vérité avant la persuasion. Par
conséquent, il est indispensable que la formation classique soit ensuite relayée par une formation moderne.
Or, ce que je veux ici mettre en exergue, ce n'est pas tant l'intelligence et l'esprit de mesure ou d'équilibre de ces
réflexions, que la profondeur d'un geste qui associe dans ces réflexions les trois dimensions ou considérations : de la
pédagogie, de l'épistémologie et de l'anthropologie.
Vico, en effet, ne dissocie pas entre
1) la question pédagogique de la méthode d'enseignement et de l'organisation des études ;
2) la question épistémologique du genre de savoir ou du type de connaissance que qualifient des gestes spécifiques
et des logiques différentes ;
3) la question anthropologique du caractère ou du type d'homme que de fait on sélectionne en prenant la décision en
faveur de l'un ou l'autre type (classique ou moderne) d'étude et de savoir.
Voilà une problématique dont la prise en charge explicite illustrerait à mes yeux la devise des Lumières mises au
service de la pédagogie — j'entends : un Sapere Aude qui porte l'interrogation au coeur des enjeux profonds de
l'éducation, de l'enseignement et de la recherche. Demandons nous quelles instances, aujourd'hui, assument un tel
questionnement.
Cette allusion aux Lumières de la raison et au « Sapere Aude » repris par Kant pour en présenter la devise nous
conduit vers un autre contexte de réflexion sur le sens de la connaissance et de sa reproduction dans l'Université.
Cet autre contexte est celui de l'idéalisme allemand. L'Université de Berlin au 19ème siècle — autrement dit :
l'Université, entre autres, de Fichte, de Schelling, de Schleiermacher, de Humboldt, de Hegel — est devenue un
paradigme de la liberté du savoir, un savoir couronné voire dominé par la philosophie. Il n'est pas certain que
Copyright © Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie Page 4/8

Jean-Marc FERRY - Quelle société du savoir pour l'Union européenne ?
Wilhelm von Humboldt fût aussi kantien qu'on a pu le dire, mais il est clair que son libéralisme culturel est
d'inspiration kantienne. Je pense en particulier au Kant du Conflit des Facultés, pour qui « La Faculté de Philosophie
devra [...], parce qu'elle doit garantir la vérité des enseignements [...], être en tant que telle considérée comme libre
et soumise uniquement à la législation de la raison, non à celle du gouvernement ». Kant rappelait aussi que « Cesar
ne commande pas aux grammairiens », une sensibilité qui n'échoit guère à l'Etat français. Dans notre espace
européen d'aujourd'hui, il ne s'agit certes pas d'affirmer la liberté de l'Université face au pouvoir politique, comme on
pouvait le risquer dans la Prusse de « Frédéric l'Unique ». Mais les mots prononcés par Kant conservent leur valeur,
moyennant une actualisation qui tient compte du contexte.
La Philosophie était encore assignée à une fonction ancillaire à l'égard de la Théologie, ce qui donna à Kant
l'occasion d'ironiser sur un trait médiéval, outre qu'elle était traitée comme une subalterne des Facultés «
professionnalisées » : Théologie, Droit et Médecine. Même s'il est vrai que la question de la liberté du savoir se joue
aujourd'hui différemment et par rapport à des instances ou pouvoirs qui ne se réduisent plus à un gouvernement
étatique, il reste qu'en suggérant que la Faculté de Philosophie doit être « libre et soumise uniquement à la
législation de la raison », Kant renvoie à un concept de la science, un concept normatif dont l'intention mérite d'être
maintenue. Cette intention est condensée dans le mot Weltbegriff (der Wissenschaft), opposé au Schulbegriff —
comprenons : un concept « cosmique » ou « mondain », du savoir, que Kant opposait au concept « scolastique » ou
« scolaire ». Plus tard, Kant alla jusqu'à parler d'un concept « cosmopolitique » : weltbürgerlicher Begriff (der
Wissenschaft, toujours !), et non plus simplement Weltbegriff. Cela indique que la science est au service de
l'humanité par delà les frontières d'intérêts nationaux ou autres ; qu'elle doit servir les fins ultimes de développement
et d'épanouissement humain par la liberté de la culture. C'est pourquoi la science n'a pas à obéir à d'autre loi que
celle de la raison entendue comme la puissance de prescrire à l'humanité ses fins morales.
C'est notamment chez Schelling que l'on peut lire une critique anti-utilitariste des plus énergiques, en ce qui
concerne la conception du savoir organisé dans l'Université, tandis que, de son côté, Hegel qui, à la différence de
Humboldt et surtout de Fichte, considère que l'Université n'est pas au-dessus de tout pouvoir « temporel », en
particulier, de l'Etat, maintenait cependant qu'elle est et doit être regardée comme l'institution « anhistorique » par
excellence. C'est son expression : l'Université est, parmi toutes les institutions, celle qui appelle à la conservation,
mérite d'être soustraite à la frénésie réformatrice... Hegel n'épousait pas là une posture réactionnaire. Sa thèse est
étayée de bonnes et solides raisons.
Approfondissons l'histoire de l'apport de l'idéalisme allemand à la philosophie des universités . Friedrich Schiller,
l'ami de Wilhelm von Humboldt, séparait fermement entre le Brotstudium et les études philosophiques. Pour
Schelling (Leçons sur la méthode des études académiques ; Vorlesungen über die Methode des akademischen
Studiums) les étudiants devraient commencer par les études philosophiques avant d'entreprendre des études
spécialisées, professionnelles. Pour lui, un peu comme chez Fichte pour qui l'Université est le lieu où se manifeste le
divin, voire, « Dieu lui-même », seule la philosophie disposerait, pour ainsi dire, d'un droit-créance de liberté
inconditionnée à l'égard de l'Etat (Nur die Philosophie ist der Staat unbedingte Freiheit schuldig ; « il n'y a qu'à la
philosophie que l'Etat est redevable d'une liberté inconditionnée). Schelling attendait de l'enseignement universitaire
qu'il forme les étudiants à la recherche, en mettant l'accent sur la nécessité de ne pas s'en tenir à un enseignement
des conclusions, mais d'exposer plutôt aux étudiants le chemin, la méthode qui permet de faire surgir la science «
comme pour la première fois, sous les yeux de l'apprenti ». Là encore, on entend la réclamation de Fichte pour qui
l'acquisition mécanique des connaissance doit faire place à un apprentissage réflexif des règles de cette activité.
Selon la propre expression de Schelling, l'étudiant ne devrait apprendre que pour se « créer soi-même ».
Cela fait écho au thème humboldtien de la Selbstbildung. Quant à Schleiermacher, le philosophe philologue et le
plus grand théologien protestant de son temps, il estimait, à l'instar de Fichte, que professeurs et étudiants doivent
se considérer comme maîtres et apprentis dans l'art de la connaissance, tandis que le « corps » académique qui
résulte de cette coopération est essentiellement formé par le dialogue ; et, là encore, la philosophie tient une place
centrale. Elle est à la fois Mittelpunkt et Herrin de toutes les sciences.
Dans leur ensemble, ces représentants de l'idéalisme allemand considéraient comme essentielle l'unité de la
recherche et de l'enseignement, et cette unité devait être gagée sur le fonctionnement de séminaires. A l'époque
Copyright © Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie Page 5/8
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%








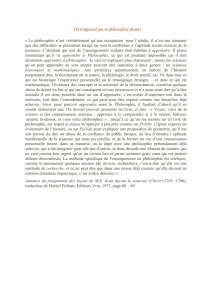

![Hegel « Le 14 Novembre [1831] mourut à Berlin le célèbre](http://s1.studylibfr.com/store/data/001023432_1-a9b6716e401d92cc3aee9aa9973a15fa-300x300.png)