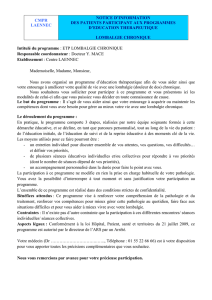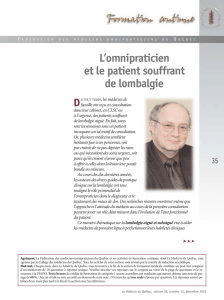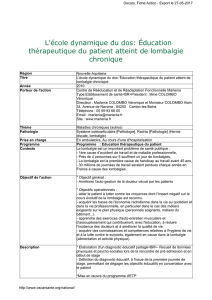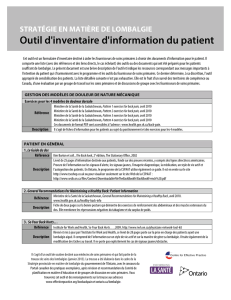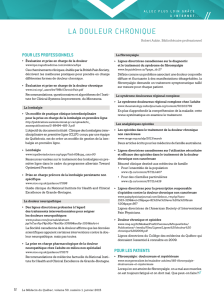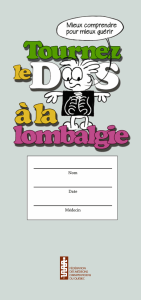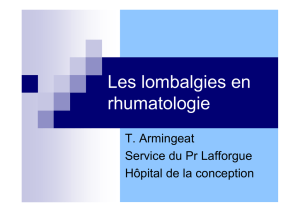Lombalgie chronique commune: revue des

WWW.PROFESSIONSANTE.CA
|
juin 2013
|
QUÉBEC PHARMACIE
|
15
les pages
bleues
Texte rédigé par Noura A. Shahid, B.Pharm.,
Pharmacie Noura A. Shahid, tutrice pour les cours de
laboratoire de pratique professionnelle de Pharm. D.,
Université de Montréal, et responsable de la chronique
«Place aux questions» de la revue Québec Pharmacie.
Texte original soumis
le 31 janvier 2013.
Texte nal remis
le 7 avril 2013.
Révisé par: John Zannis, B. Sc., B. Pharm.,
pharmacien-chef, Pharmacie Sylvain Gaudreault,
Laval, et Sarah Girard, Pharm. D. Pharmacie Morin.
Présentation
de la patiente 1
Mme DD, 33 ans, travaille dans un CHSLD
comme préposée aux bénéciaires. Elle s’est
blessée au bas du dos il y a six mois en soule-
vant une personne âgée. Depuis, elle éprouve
une douleur sourde au milieu du bas du dos,
qui irradie un peu dans la fesse gauche et
jusqu’à la jambe. Après l’incident, Mme DD s’est
absentée de son travail pendant quatre semai-
nes au cours desquelles elle s’est reposée, a fait
des exercices d’étirement, a suivi quelques trai-
tements de physiothérapie, mais les bienfaits
ont été limités. Le médecin lui a prescrit égale-
ment du naproxène 375mg bid, de la cyclo-
benzaprine 10mg tid prn et de l’hydromor-
phone 2mg toutes les quatre à six heures prn
durant deux semaines. Elle a fait une intolé-
rance aux AINS (brûlures d’estomac extrêmes)
et assure que sa douleur n’a pas été soulagée
complètement à la n de ce traitement. Cette
douleur nuit à son travail et l’empêche de pra-
tiquer certains loisirs. Son sommeil est parfois
perturbé. Elle admet qu’elle se sent parfois
aussi un peu déprimée et découragée. Pour-
rait-on améliorer son traitement?
L’auteure et les réviseurs scientiques ne déclarent aucun conit d’intérêts lié à la rédaction de cet article.
Lombalgie chronique commune:
revue des approches de diagnostic et de traitement
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE:
1. Connaître la physiopathologie et le diagnostic de la lombalgie chronique commune (LCC)
2. Connaître les diérentes approches de traitement non pharmacologiques et pharmacologiques disponibles pour la LCC,
ainsi que les objectifs du traitement.
3. Connaître les diérentes options de traitement invasives (deuxième ligne)
La lombalgie (low back pain) est le terme médical
qui désigne les douleurs dans le bas du dos. Si la
douleur persiste pendant plus de 12 semaines, on
posera souvent un diagnostic de lombalgie chro-
nique. De façon générale, la lombalgie est le pro-
blème de santé chronique le plus fréquent au
Canada après les allergies alimentaires, suivi de
près par l’arthrite-rhumatisme1. Plus précisément,
de 25 % à 33 % des Canadiens souriraient d’une
lombalgie modérée ou grave1. Si son évolution
vers la chronicité n’est observée que dans 6 % à 8%
des cas, la lombalgie est à l’origine de plus de 85%
des coûts médicaux directs ou indirects (coûts des
médicaments, examens de diagnostic, examens
requis par la CSST, perte de productivité au tra-
vail, etc.)1-3. Elle est également la principale cause
d’invalidité au travail chez les moins de 45 ans4. La
prise en charge de la lombalgie chronique est
complexe. Elle repose sur une approche multidis-
ciplinaire et exige généralement de multiples
interventions pharmacologiques et non pharma-
cologiques et, par conséquent, un suivi régulier.
Dénition et présentation clinique
La lombalgie est une douleur en bas du dos, au
niveau des vertèbres lombaires situées dans la
région de la charnière lombo-sacrée, soit en des-
sous de la dernière vertèbre qui porte une cote
s’étendant de la charnière dorso-lombaire (D12-
L1). Les vertèbres L4, L5 et S1 sont souvent concer-
nées. Les douleurs portant sur les vertèbres situées
au-dessus de la D12 sont appelées « dorsalgies ».
Leurs causes, mécanismes et traitements diè-
rent de ceux de la lombalgie et ne sont pas traités
dans cet article. On peut diviser la lombalgie en
trois catégories selon sa durée : aiguë (douleur
durant jusqu’à environ quatresemaines; on l’ap-
pelle alors « lumbago »); subaiguë(douleur persis-
tant de 4à 12 semaines); chronique (douleur
constante de plus de 12semaines)5-7. Alors que la
majorité des cas aigus se guérissent en trois à qua-
tre semaines, 10% à 40% de ces derniers se trans-
forment en lombalgie chronique5. La douleur
associée à la lombalgie chronique commune
(LCC) est généralement décrite comme intense,
diuse ou cuisante dans une région particulière
du dos et/ou des jambes (aussi appelée « douleur
radiculaire »). Le patient pourrait aussi éprouver
un engourdissement, un picotement, une sensa-
tion de brûlure ou des fourmillements dans les
jambes (aussi appelée « sciatique »)3,6,7. Les activi-
tés quotidiennes régulières peuvent devenir di-
ciles, voire impossibles.
Étiologie
La lombalgie est un symptôme, et non une mala-
die. Sur le plan étiologique, on distingue deux
types de lombalgie. D’abord, la lombalgie spéci-
que qui peut être due à un problème médical spé-
cique (tumeur cancéreuse, fracture vertébrale,
infection, affection rhumatismale inflamma-
toire, etc.)3,8,9. Toutefois, la plupart des cas d’adul-
tes en âge de travailler sont associés à des change-
ments dégénératifs dans les structures
anatomiques de la colonne vertébrale. Ils peuvent
alors être liés aux disques intervertébraux, aux
vertèbres, aux muscles et aux ligaments (p. ex.,
hernie discale, discopathies dégénératives, sté-
nose spinale, arthrose); ils sont donc qualiés de
« lombalgiescommunes » ou « lombalgies non
spéciques »7,9. Dans cet article, nous traitons sur-
tout de la LCC qui constitue plus de 85% des cas
de lombalgie chronique7-9.
Pathophysiologie
La physiopathologie des lombalgies chroniques
est mal comprise. Le canal vertébral (aussi nommé
« rachidien » ou « lombaire ») est formé par l’empi-
lement des vertèbres les unes sur les autres, sépa-
rées par des disques intervertébraux. Il constitue
l’étui osseux protégeant la moelle, les méninges et
les racines nerveuses rachidiennes. De nombreu-
ses structures anatomiques peuvent être impli-
quées dans la douleur : les modications dégéné-
ratives et les lésions des disques intervertébraux
sont souvent incriminées, mais il y a aussi les mus-
cles et les ligaments4,10. Le processus normal du
vieillissement conduit à des changements dégéné-
ratifs de la colonne vertébrale. Aussi, à la suite d’un
traumatisme important (p.ex., fracture, chute ou
accident de voiture violent), des changements
importants pourront avoir lieu. Ces changements
comprennent la formation d’ostéophytes (ou
« éperon osseux », soit la prolifération de tissus
osseux immatures aux extrémités des os appelés
« ostéophytes »), la dégénérescence de disques
intervertébraux, la formation d’une hernie discale
(saillie d’un disque dans le canal vertébral), un
amincissement des disques10. La gure I illus-
tre quelques-unes des discopathies dégéné-
ratives11. On pense que des altérations dans les
QP03_015-022 [Print].indd 15 13-06-07 11:58

16
|
QUÉBEC PHARMACIE
|
juin 2013
|
WWW.PROFESSIONSANTE.CA
propriétés biochimiques de la structure du dis-
que, la sensibilisation des terminaisons nerveuses
par la libération de médiateurs chimiques et la
croissance vasculo-nerveuse peuvent toutes
contribuer à l’apparition de la douleur dans le bas
du dos4,10. En outre, des cytokines, telles que les
métalloprotéases matricielles (MMP), la phos-
pholipase A2, l’oxyde nitrique et le facteur de
nécrose tumorale-alpha (TNF-α) jouent un rôle
vital dans cette apparition4,10. Toutefois, des modi-
cations qualitatives et fonctionnelles des muscles
paravertébraux, ainsi que des facteurs de risque de
chronicité d’ordre psychologique, socioprofes-
sionnel et comportemental, sont actuellement
intégrés dans le modèle physiopathologique dit
« biopsychosocial de la lombalgie chronique4,7,10 ».
Diagnostic
L’évaluation de la lombalgie chronique consiste
à réaliser une anamnèse complète, comprenant
les antécédents médicaux du patient, et à faire un
examen physique6 ,7,9. Les signaux d’alarme (« red
ags » ou « drapeaux rouges ») sont des facteurs
physiques, dont le but est de repérer les lombal-
gies spécifiques d’origine néoplasique, infec-
tieuse, inammatoire ou fracturaire7,9. Leur pré-
sence suggère une pathologie sous-jacente et
nécessite une approche spécique selon le dia-
gnostic suspecté. Les facteurs de risque psycho-
so ciaux (« yellow ags » ou « drapeaux jaunes »),
eux, sont des facteurs de passage à la chronicité,
leur présence étant liée à un risque plus élevé
d’atteinte ou de maintien d’une lombalgie chro-
nique et d’une invalidité de longue durée6,7,9. Les
deux types de drapeaux sont présentés au
tableau I2 ,6,7,9. Une anamnèse et un examen
physique qui ne révèlent pas de drapeaux rouges
permettent de poser un diagnostic clinique a-
ble, sans recours nécessaire à des techniques
d’imagerie médicale7. Quant au recours à l’ima-
gerie par résonance magnétique (IRM) ou à la
tomodensitométrie (TDM) pour établir le dia-
gnostic, selon les recommandations fondées sur
les preuves de l’American College of Physicians
(ACP) et l’American Pain Society (APS), l’ima-
gerie de routine, ou basée sur des tests de dia-
gnostic, ne doit pas être faite chez les patients
sourant de LCC ou non spécique4. En eet,
chez les patients souffrant de lombalgie com-
mune, les résultats des tests radiologiques, tomo-
densitométriques ou d’IRM ne sont pas associés
aux symptômes exprimés par le patient ni à sa
capacité fonctionnelle 6,7,12. Les médecins ne doi-
vent eectuer des tests de diagnostic et d’image-
rie que dans certains cas : chez ceux qui présen-
tent une douleur depuis plus de 12 semaines et
qui sont à haut risque de graves décits neurolo-
giques; lors de la présence d’une aection sous-
jacente spécifique (voir drapeaux rouges); ou
chez les candidats à des interventions invasives
(p.ex., chirurgie)6,7,12. Il n’existe pas suffisam-
ment de données probantes pour recommander
des examens complémentaires spécifiques
(p.ex., techniques d’imagerie, techniques inter-
ventionnelles, électromyographie) chez les
patients sourant de LCC6,7,12 .
Traitements
Le traitement de la LCC devrait se concentrer sur
l’atténuation des symptômes, comme l’intensité
de la douleur, la restauration de la capacité fonc-
tionnelle et la qualité de vie. Il devrait permettre
au patient de reprendre ses tâches complètes au
travail et de pratiquer les activités sociales et les
loisirs qu’il aime4,5. Il est également important de
xer des objectifs de traitement réalistes avec lui,
en lui mentionnant qu’il est dicile de suppri-
mer totalement la douleur et que la persistance
d’un fond douloureux (gêne) n’est pas nécessaire-
ment synonyme d’échec thérapeutique. Notons
que le repos est inutile et pourrait même être nui-
sible en abaissant le seuil de la douleur7, 8. Ainsi, le
repos ne doit jamais être prescrit, mais seulement
autorisé si l’intensité des douleurs l’exige, et il doit
être le plus court possible.
Options non pharmacologiques
Tout d’abord, la lombalgie chronique est souvent
associée au « syndrome de déconditionnement »
en raison de l’inactivité physique13,14. Parce qu’il
ressent des douleurs, le patient lombalgique évite
des activités physiques et sociales par peur de
sourir ou d’aggraver ses lésions. Le patient se
trouve ainsi enfermé dans un cercle vicieux dont
il lui devient de plus en plus difficile de sortir :
douleur - inactivité - déconditionnement. D’où
l’importance de briser ce cycle en s’aidant des
méthodes non pharmacologiques, telles qu’un
programme intensif de réadaptation, de la réédu-
cation, un programme d’exercices physiques,
etc.8,13,14 Les thérapies non pharmacologiques
peuvent être utilisées seules ou en association
avec les traitements pharmacologiques.
Les traitements qui bénécient des niveaux de
données probantes les plus élevés sont les pro-
grammes d’exercices physiques, les prises en
charge comportementales et les approches multi-
disciplinaires3,7,8,14. En eet, les prises en charge
comportant plusieurs interventions (p. ex., éduca-
tion, programmes d’exercices, approche compor-
tementale et relaxation) sont plus ecaces qu’une
prise en charge isolée ou classique7,8,14. Quant aux
massages et à l’acupuncture, ils sont légèrement
utiles pour réduire la douleur chronique dans le
bas du dos7,8,14. D’ailleurs, le massage semble plus
ecace lorsque combiné à l’exercice physique, aux
étirements et à l’éducation7,8,14. Enn, la thérapie
par laser de faible niveau, les supports lombaires,
la traction, la stimulation nerveuse électrique
transcutanée (TENS) et les ultrasons orent des
preuves très limitées, voire contradictoires, en
matière d’ecacité7,8,14. Le tableau II résume les
principales options non pharmacologiques et leur
place dans la prise en charge de la LCC3,7,8,14.
Traitements pharmacologiques
Le traitement médicamenteux de la LCC est
symptomatique. Le choix d’un médicament doit
reposer sur des preuves et être adapté autant que
possible à chaque patient. Il devrait aussi s’appuyer
sur des données pharmacologiques, sur les anté-
cédents du patient et l’expérience clinique8,15-17.
Les médicaments couramment prescrits pour les
douleurs lombaires chroniques comprennent en
première ligne l’acétaminophène et les anti-
inammatoires non stéroïdiens (AINS)8,15-17. En
deuxième ligne, on trouve les opioïdes, les myore-
laxants, les anticonvulsivants et les antidépres-
seurs tricycliques (ATC)8,15-17. L’Orga nisation
mondiale de la santé (OMS) a instauré l’« échelle
analgésique », une approche par étapes pour gérer
la douleur8,17. Cette échelle fournit une ligne
directrice générale pour la sélection des médica-
ments contre la douleur d’intensité variable. Les
directives de l’OMS ont été mises au point pour le
traitement de la douleur cancéreuse, mais elles
peuvent être appliquées à d’autres types de dou-
leur8. Par exemple, la douleur d’intensité faible à
modérée est souvent gérée par des analgésiques
tels que l’acétaminophène et les AINS non sélec-
tifs, ou par les inhibiteurs de la cyclo-oxygénase-2
(COX-2)8,18. Les opioïdes peuvent être utilisés
pour traiter la douleur faible à modérée persis-
tante ou qui augmente malgré l’usage des traite-
ments non opioïdes8,15-18. Toutefois, les opioïdes
restent le pilier du traitement pour les patients
ayant des douleurs invalidantes ou d’intensité
modérée à sévère8,15-20. Les traitements par asso-
ciation, habituellement des opioïdes avec acéta-
minophène et/ou un AINS, sont réservés aux
les pages
bleues
Présentation
de la patiente 1 (suite)
D’abord, compte tenu de la durée de ses dou-
leurs (six mois) et en l’absence de drapeaux
rouges, on peut armer que Mme DD souf-
fre de LCC. Mme DD pourrait bénécier d’un
traitement non pharmacologique qui pour-
rait comporter un programme d’exercices vi-
sant le renforcement musculaire et la perte
de poids. Aussi, dans le cadre d’une approche
multidisciplinaire, un psychologue pourrait
l’aider à accepter son état. Quant à la médica-
tion, l’usage d’un AINS devrait être évité (into-
lérance et manque d’ecacité dans le cas de
Mme DD). Son médecin pourrait alors envisa-
ger l’ajout d’un ATC, comme l’amitriptyline ou
la nortriptyline: la dose initiale est de 10 mg à
20mg, que l’on augmente chaque semaine.
La dose maximale habituellement rapportée
est de 150 mg par jour20.
QP03_015-022 [Print].indd 16 13-06-07 11:58

www.Professionsante.ca
|
JUIN 2013
|
Québec Pharmacie
|
17
patientsayantunedouleurmodéréeàsévère
8,15-20.
Le tableau III résume les principaux traitements
pharmacologiques, leurs doses de départ, leurs
principaux eets secondaires et interactions, ainsi
que leur place dans la prise en charge pharmaco-
logique de la lombalgie chronique.
Acétaminophène
L’acétaminophèneadespropriétésanalgésiqueset
antipyrétiques et, contrairement aux AINS, a peu
ou pas d’effets anti-inflammatoires. Son méca-
nisme d’action consiste à inhiber la synthèse des
prostaglandines dans le système nerveux central
(SNC)8.Largementutilisépourgérerlesdouleurs
d’intensité légère à modérée, il est recommandé
par l’ACP et l’APS comme agent de première ligne
pour l’arthrose et les maux de dos aigus et chroni-
ques de faible intensité3,8,15,21.Ladoserecomman-
dée serait de 500 à 1000mg toutes les 4 à 6 heures
(maximum de 4000mg/jour). En raison de son
potentiel d’hépatotoxicité, à des doses élevées, il
doit être évité chez les patients présentant une
maladie hépatique préexistante et chez ceux
consommant beaucoup d’alcool. De plus, chez le
patient prenant de la warfarine, il faudrait sur-
veiller plus fréquemment le rapport international
normalisé (RIN) dans le cas d’une prise de plus de
2000mg/jour d’acétaminophène. Aucune inter-
action médicamenteuse clinique n’est associée à
son usage. Malheureusement, l’acétaminophène
a fait l’objet de peu d’études contrôlées randomi-
sées (ECR) pour la LCC. Aucune conclusion ne
peut donc être formellement tirée au sujet de ses
risques et bénéces dans le cadre de la lombalgie
chronique, en comparaison avec les autres traite-
ments cités ci-dessous3,8,15. Toutefois, son profil
favorable d’eets indésirables permet de le consi-
dérer comme un très bon choix pour le patient qui
répond cliniquement au traitement.
Anti-inammatoires non stéroïdiens (AINS)
LesAINSontdespropriétésanalgésiques,antipy-
rétiques et anti-inammatoires. Leur mécanisme
d’action est lié en grande partie à l’inhibition de la
synthèse des prostaglandines E2, bloquant les
cyclo-oxygénases de type 1 et 2 (COX)3,8,15.Peude
données permettent d’affirmer qu’un AINS est
supérieur à un autre ou que les AINS sont supé-
rieurs aux autres traitements, comme les opiacés
ou les médicaments de la catégorie des ATC, pour
la lombalgie chronique3,8,15,20. En outre, une
récente revue de la littérature médicale a trouvé
peu de données sur l’innocuité à long terme des
AINS pour cette indication3,8,15,20.LesAINSetles
inhibiteurs de la COX-2 sont associés à une toxi-
cité gastro-intestinale (GI) et rénale, ainsi qu’à un
risque accru de complications cardiovasculaires
(CV)5.L’aspirine,l’inhibiteurlepluspuissantdela
COX-1, est associée au risque d’eets gastro-intes-
tinaux le plus élevé4.Chezlespatientsquiont
besoin d’utiliser des AINS de façon chronique, on
pourrait envisager l’ajout d’un inhibiteur de la
pompe à protons (IPP), un antagoniste-H2, du
misoprostol ou le passage à un inhibiteur de la
COX-2, tel que le célécoxib, pour réduire le risque
d’effets indésirables GI associés3,4,15.Quantà
l’American Heart Association (AHA), elle ne
recommande pas leur utilisation en traitement de
première intention chez les patients atteints de
maladie cardiovasculaire connue ou présentant
des facteurs de risque de cardiopathie ischémi-
que5,22.Enfait,l’Agenceeuropéennedesmédica-
ments et Santé Canada recommandent pour tous
les patients, sans égard au risque CV/GI, la plus
faible dose d’AINS/inhibiteurs de la COX-2
durant la plus courte période nécessaire pour
maîtriser ecacement les symptômes5.Lesdon-
nées sur les avantages à long terme et sur les incon-
vénients liés à l’utilisation des AINS pour la dou-
leur au bas du dos sont particulièrement
rares3,8,15,20.Toutefois,utilisésàbonescientetchez
les patients appropriés, ces analgésiques sont
généralement sûrs et ecaces4,5,8.
Opioïdes
L’utilisation d’opioïdes pour soulager la douleur
dans le bas du dos est controversée. Sur la base de
l’échelle analgésique de l’OMS, les opioïdes sont
la pierre angulaire du traitement de la douleur
modérée à sévère3,4,15,16,20.Leurmoded’action
repose sur leur liaison aux récepteurs opiacés,
imitant ainsi l’action des endorphines endogè-
nes en stimulant les voies descendantes inhibi-
trices, ce qui entraîne une action analgési-
que3,4,15,20.Lesopioïdesàduréed’actionrapide
sont recommandés initialement pour traiter la
lombalgie aiguë4,16,20.Ils’agitnotammentdela
codéine, de la morphine, de l’hydrocodone et de
l’oxycodone4,16,20.Toutefois,siletraitement
opioïde est nécessaire pendant une plus longue
période, le patient doit opter pour une prépara-
tion à libération contrôlée ou prolongée4,16,20.
Quelques ECR de haute qualité ont permis
d’évaluer l’ecacité et les risques potentiels de
ces médicaments dans la lombalgie chroni-
que3,4,15.Danslesétudesrandomisées,40%à
50% des patients cessent le traitement opiacé en
raison d’eets secondaires3,4,15.Parailleurs,selon
l’ACP et l’APS, les opioïdes sont un choix judi-
cieux lorsqu’utilisés par des patients sourant de
douleurs lombalgiques aiguës ou chroniques et
qui ont une douleur invalidante non contrôlée
(ou peu susceptible d’être contrôlée) avec de
l’acétaminophène et des AINS3,4,15,16,19. Outre les
eets indésirables qui leur sont attribués (nau-
sées, constipation, sédation, prurit, etc.), le
potentiel de dépendance et d’abus a été associé à
l’utilisation prolongée des opioïdes4,5,15. C’est
pourquoi la sélection des opioïdes doit être spé-
cique au patient et guidée par l’intensité et la
durée de la douleur, ainsi que par des considéra-
tions de tolérance et de sécurité4,16.
Suivi du pharmacien
nRassurer la patiente sur le fait que son ATC
devrait l’aider à soulager ses douleurs
lombaires au bout de deux à trois
semaines (au fur et à mesure que la dose
augmente) et que la qualité de son
sommeil devrait s’améliorer en même
temps20.
nFaire un suivi téléphonique toutes les
semaines pendant quatre semaines,
concernant les eets secondaires (p. ex.,
somnolence diurne, sécheresse buccale);
suivre la hausse hebdomadaire de la dose
jusqu’à l’atteinte d’une dose ecace
diminuant la douleur. Faire un suivi à
chaque renouvellement de médicament
par la suite.
nSi la patiente ne rapporte aucune
amélioration des symptômes, qu’elle note
une aggravation ou que la douleur
continue à être intense pendant plus d’une
semaine, le pharmacien devrait lui
recommander un autre rendez-vous avec
son médecin20.
I Présentation visuelle des discopathies
a) Disque normal
b) Disque dégénéré
c) Disque bombé
d) Hernie discale
e) Disque avec amincissement
f) Dégénération de disque
avec formation d’ostéophytes
Source: University of Virginia Health System. www.uvaspine.
com/lumbar-degenerative-disc-disease.php
QP03_015-022 [Print].indd 17 13-06-07 11:59

18
|
QUÉBEC PHARMACIE
|
JUIN 2013
|
WWW.PROFESSIONSANTE.CA
Tramadol
Cet agent est considéré comme un analgésique
opiacé « atypique » à action centrale, en raison de
son double mode d’action unique qui agit à la fois
comme un inhibiteur des récepteurs de la nora-
drénaline et de la sérotonine, et comme un faible
substrat du récepteur opioïde μ4,5.Enfait,lesdeux
tiers de l’eet analgésique du tramadol sont obte-
nus par l’entremise des voies noradrénergique et
sérotoninergique, alors que l’eet opiacé repose
sur sa transformation, par le CYP2D6, en un
métabolite actif (M1) qui se lie avec une plus forte
anité au récepteur μ que le composé parent4,5.La
puissance du métabolite M1 équivaut à peine à
celle de la codéine, elle-même correspondant
environ à un dixième de la puissance de la mor-
phine5.ChezlespatientssourantdeLCC,letra-
madol à administration uniquotidienne peut être
utilisé à long terme sans la toxicité gastro-intesti-
nale, cardiovasculaire ou rénale associée aux
AINS4,5.Ilconstitueégalementunesolutionde
rechange sûre et ecace aux opioïdes tradition-
nels et présente, à des doses équianalgésiques,
moins de risques de dépression respiratoire, de
constipation et d’abus5,20,21. Toutefois, la formula-
tion à usage uniquotidien serait contre-indiquée
chez les patients hypersensibles aux opiacés, ainsi
que dans toute situation où les opiacés sont
contre-indiqués5.Quantàlaformulationàlibéra-
tion immédiate, elle serait également contre-indi-
quée en cas d’allergie sévère aux opiacés. Un
aspect intéressant serait son effet positif sur la
qualité du sommeil chez certains patients : lors des
ECR, les patients atteints de lombalgie chronique
et ayant reçu le tramadol ER (200 et 300mg) ont
observé une amélioration importante de la qua-
lité globale de leur sommeil, comparativement
aux patients recevant un placebo (p = 0,001;
p = 0,008)5,24.Enraisondumanquedepreuve,cet
agent n’est cependant pas recommandé comme
traitement de première ligne chez les patients
sourant de LCC3,4,15.Notonsqu’aucunessain’a
comparé le tramadol à l’acétaminophène ou à la
monothérapie par opioïdes, ou par d’autres
AINS3,4,15.D’ailleurs,ildoitêtreutiliséavecpru-
dence chez les patients prenant certains antidé-
presseurs, en raison du risque de syndrome séro-
toninergique associé3,4,15.
Antidépresseurs
Les antidépresseurs, en particulier les antidépres-
seurs tricycliques (ATC), ont été utilisés pendant
des années pour traiter les douleurs associées à
divers états de santé, surtout ceux d’origine neu-
ropathique4,15.LesATCfonctionnenteninhibant
le recaptage de la sérotonine et de la noradréna-
line, leur permettant ainsi d’agir sur les voies inhi-
bitrices descendantes de la douleur, ainsi que sur
la sensibilisation périphérique4,15. Toutefois, le
mécanisme d’action de ces agents dans la LCC
n’est pas complètement élucidé. Une revue systé-
matique portant sur toutes sortes d’indications
rhumatologiques, entre autres la lombalgie chro-
nique, a permis de constater un faible eet de la
nortryptiline et de l’amitriptyline sur la douleur,
mais pas d’eets sur les résultats fonctionnels (i.e
les activités quotidiennes restent inchan-
gées)15,25-27.Pourlalombalgiechronique,deuxétu-
des systématiques de meilleure qualité (une quali-
tative et une quantitative) ont révélé que les ATC
étaient légèrement à modérément plus ecaces
que le placebo pour soulager la douleur15,25-27.
D’autres classes d’antidépresseurs, telles que les
inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la
noradrénaline (IRSN) de type venlafaxine ou
duloxétine, sont devenues tout aussi populaires
pour soulager les douleurs chroniques avec ou
sans composante de dépression, car elles ont
moins d’eets secondaires4.En2011,leCymbal-
taMD (chlorhydratededuloxétine)areçul’appro-
bation de Santé Canada pour la prise en charge de
la lombalgie chronique28. La dose recommandée
est de 60mg une fois par jour28. Puisqu’enmatière
d’interactions, la duloxétine est un inhibiteur
modéré du CYP2D6, il faut être prudent quand
on l’administre avec un médicament principale-
ment métabolisé par le CYP2D6 et dont l’index
thérapeutique est étroit28.Aussi,laduloxétinene
doit pas être administrée en association avec un
inhibiteur puissant du CYP1A2 (p.ex., uvoxa-
mine) ou avec certains antibiotiques de la famille
des quinolones (p.ex., ciprooxacine). Elle est éga-
lement contre-indiquée en présence d’insuffi-
sance rénale grave (c’est-à-dire si la clairance de la
créatinine est inférieure à30mL/min) ou d’insuf-
sance rénale terminale28.Unerevuesystémati-
que a révélé que les antidépresseurs, surtout les
ATC, ont été associés à un risque significative-
ment plus élevé d’événement indésirable quel qu’il
soit, par rapport au placebo (22% vs 14%), soit
somnolence et sécheresse de la bouche; les étour-
dissements et la constipation ont été les effets
indésirables les plus fréquents15,27.Lesessaisn’ont
pas été conçus pour évaluer les risques d’efets
indésirables graves, tels que le risque suicidaire
accru, le surdosage ou les arythmies15.
Myorelaxants
Ces agents réduisent les spasmes musculaires
paravertébraux pouvant contribuer aux symptô-
mes de la lombalgie. Ils sont utilisés comme des
agents d’appoint, surtout dans la phase aiguë de la
douleur, en association avec des analgésiques
opioïdes et non opioïdes pour la lombalgie3,4,15,29.
Les ECR ont démontré leur ecacité pour soula-
ger la douleur et réduire les symptômes par rap-
port au placebo, mais pas plus que les analgésiques
de première ligne3,4,15,29.Ilssontmieuxutilisésà
court terme16.CeuxquisontapprouvésauxÉtats-
Unis pour le traitement des troubles musculos-
quelettiques sont le carisoprodol, la cyclobenza-
prine et le méthocarbamol3,4,15. Toutefois, les
relaxants musculaires couramment utilisés pour
traiter la douleur dans le bas du dos sont le
baclofène et la cyclobenzaprine4. La posologie
recommandée pour le baclofène est de 5 mg trois
fois par jour au début, puis elle est augmentée pro-
gressivement jusqu’à une dose quotidienne maxi-
male de 80 mg, fractionnée en trois ou quatre pri-
ses quotidiennes3,4,15,29.Danslesétudes,la
cyclobenzaprine est généralement administrée à
raison de 5 mg trois fois par jour3,4,15,29.Notons que
l’incidence des effets indésirables des relaxants
les pages
bleues
I Diagnostic diérentiel (A) et facteurs de risque de la chronicité (B)3,4,6-8
A) Drapeaux rouges («Red ags» ou signaux d’alarme)
nÂge de début des symptômes: avant 20 ans ou après 50 ans (ou 55 ans selon la source)
nAntécédents ou suspicion de néoplasie, VIH ou toxicomanie avec drogues IV
nHistoire de traumatisme violent (p. ex., accident de la route ou chute importante)
nDouleurs lombaires nocturnes et/ou au repos
nSignes d’atteinte neurologique (p. ex., troubles sphinctériens [vessie, anale], atteinte motrice
au niveau des jambes)
nTraitement prolongé par corticothérapie systémique
nPerte de poids et/ou présence de èvre inexpliquée
B) Drapeaux jaunes («Yellow ags» ou facteurs de risque de passage à la chronicité)
nDicultés émotionnelles (p. ex., stress, dépression, anxiété et/ou tendance à s’isoler)
nInsatisfaction professionnelle (p. ex., face au travail)
nÉpisodes antérieurs de lombalgie, antécédents de chirurgie lombaire, intensité de la douleur
et/ou impact fonctionnel important de cette douleur
nAttentes irréalistes du patient face au traitement et à sa maladie; expression excessive
des symptômes
nPériode prolongée d’inactivité physique et/ou de repos au lit (p. ex., plus de 4 semaines)
nPeurs et croyances du patient (p. ex., face au pronostic, à l’incapacité et aux traitements)
QP03_015-022 [Print].indd 18 13-06-07 11:59

WWW.PROFESSIONSANTE.CA
|
JUIN 2013
|
QUÉBEC PHARMACIE
|
19
musculairesestassezélevéeetqu’ilsaectentsur-
tout le SNC. Ils peuvent entraîner, entre autres,
une sédation, des maux de tête, de la somnolence,
des étourdissements, des nausées, des vomisse-
ments et des troubles de la vision3,4,15,29.Tousles
relaxants musculaires fournissent les mêmes
améliorations, à court terme, de la douleur et du
fonctionnement, mais il n’existe aucune preuve à
l’appui quant à leur utilisation à long terme pour
la lombalgie chronique3,4,15.
Antiépileptiques
Lesantiépileptiques,telsquelagabapentineetla
prégabaline, sont souvent utilisés pour traiter la
douleur neuropathique. En agissant sur la sensi-
bilisation centrale, ils o rent un mécanisme d’ac-
tion complémentaire aux antidépresseurs. Bien
qu’il existe peu de données probantes sur l’usage
de la gabapentine dans les cas de lombalgie chro-
nique, il a été démontré qu’elle soulage activement
la douleur15,20.Leseetsindésirableslesplusfré-
quents associés à cette classe de médicaments sont
la sédation, la confusion mentale, des vertiges, des
nausées et l’œdème périphérique (gabapentine et
prégabaline)4,15.Toutefois,ilmanqueencoredes
ECR et des examens systématiques pour justi er
l’usage des antiépileptiques dans la LCC4,15. Par
conséquent, ils pourraient et devraient être consi-
dérés comme un traitement d’appoint chez les
patients dont la douleur comporte une compo-
sante neuropathique et qui ne répondent pas à la
première ligne de traitement ou à d’autres agents
recommandés pour prendre en charge de la LCC.
Options de traitement invasives
(deuxième ligne)
Chirurgie
LaplupartdespatientsatteintsdeLCCnebéné-
cieront pas de la chirurgie. Une évaluation chirur-
gicale peut être envisagée pour des patients sélec-
tionnés ayant des limitations fonctionnelles
importantes et présentant des dé cits neurologi-
ques con rmés par les examens d’imagerie ou des
douleurs réfractaires, en particulier des douleurs
qui durent depuis plus de 12 mois, et ce, malgré
l’usage de multiples traitements non chirurgi-
caux, pharmacologiques ou non pharmacologi-
ques8,31.Lesaectionslespluscourantespourles-
quelles la chirurgie est recommandée sont,entre
autres, l’hernie discale, la rupture du disque verté-
bral, la sténose spinale et la spondylose31. Il existe
plusieurs techniques chirurgicales.
D’abord, la discectomie est l’une des façons les
plus courantes d’enlever de la pression sur une
racine nerveuse à partir d’un disque hernié ou
d’un éperon osseux. Au cours de l’intervention,
le chirurgien prélève un petit morceau de la lame
(voûte osseuse du canal rachidien) pour éliminer
l’obstruction en cause30.
Ensuite,l’arthrodèse(oufusionvertébrale),per-
met d’éliminer le disque vertébral entre deux ou
plusieurs vertèbres et de « fusionner » les vertèbres
adjacentes au moyen de gre es osseuses et/ou de
dispositifs métalliques xés par des vis
30
.C’estune
chirurgie majeure qui dure habituellement plu-
sieurs heures. Cette technique utilisée pour traiter
les lombalgies causées par des fractures, des infec-
tions, une déformation progressive s’appuie sur
des données solides
8,32
.Elleestsurtoutproposée
aux patients sou rant de LCC et dont les disques
Présentation
du patient 2
M. LC, 45 ans, vous consulte, car il soure de-
puis cinq jours d’une douleur lombaire basse
apparue sans facteur déclenchant net, dou-
leur qui, 48 heures plus tard, s’est intensiée,
jusqu’au bord externe des pieds, le réveillant
la nuit. Il vous mentionne que, depuis ce ma-
tin, la douleur est sourde, il a de la diculté à
uriner et il ne sent plus ses pieds (engourdis-
sements dans les extrémités). Il n’y a ni alté-
ration de l’état général, ni perte de poids, ni
èvre. Enn, vous apprenez que ce patient a
une histoire d’hernie discale au niveau de la
L5, diagnostiquée depuis juin 2012. Il prend
du Lyrica 75 mg bid et de l’acétaminophène
500 mg au besoin. Il n’a pas d’autres antécé-
dents médicaux ni chirurgicaux. Que pensez-
vous de son état?
II Méthodes non pharmacologiques3,4,6-8,14
Méthode Ecacité dans la prise en charge de la lombalgie chronique
Exercices ■Niveau de preuve scientique élevé (preuve de grade B); recommandée
■Aucune indication sur un type ou un autre; programme individualisé, de préférence
Physiothérapie ■Niveau de preuve scientique faible (preuve de grade C)
■Très peu de données comparatives fondées sur des données probantes
■Une physiothérapie ecace doit mettre l’accent sur un programme d’exercices progressifs
Manipulations ■Niveau de preuve scientique faible (preuve de grade B et C)
vertébrales ■Manque de preuves scientiques quant à leur ecacité pour la LCC
Massage ■Niveau de preuve scientique faible; l’ecacité n’a pas été évaluée ni démontrée dans la LCC
■Meilleur si combiné à des exercices et à de l’éducation, et plus ecace que pas de traitement du tout
Acupuncture ■Niveau de preuve scientique faible : preuves de son ecacité dans le cadre du traitement de la LCC non concluantes
■Si prescrite, doit être combinée à un programme actif d’exercices
Approche ■Niveau de preuve scientique élevé (preuve de grade B); recommandée
multidisciplinaire ■L’équipe assurant la prise en charge multidisciplinaire devrait idéalement être constituée d’un médecin et d’au moins
un intervenant supplémentaire (pour intervention psychologique, sociale et/ou professionnelle)
Thérapie ■Niveau de preuve scientique élevé (preuve de grade B)
comportementale ■Association d’une thérapie cognitive à la relaxation ecace comparée à l’absence de traitement
■Est aussi ecace que la thérapie à court terme de la lombalgie chronique par des exercices
Gradation des recommandations: A: Données disponibles justiant une recommandation de niveau élevé (preuves scientiques établies); B: Données disponibles justiant une recommandation
de niveau intermédiaire (présomptions scienti ques); C : Données disponibles insu santes pour justi er une recommandation (faible niveau de preuves)
Exercices
■
Physiothérapie
■
Manipulations
vertébrales
Massage
Acupuncture
Approche
multidisciplinaire
un intervenant supplémentaire (pour intervention psychologique, sociale et/ou professionnelle)
Thérapie
comportementale
QP03_015-022 [Print].indd 19 13-06-07 11:59
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%