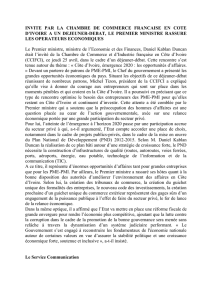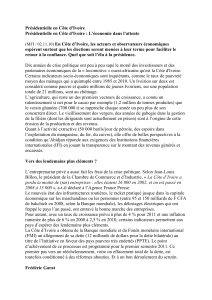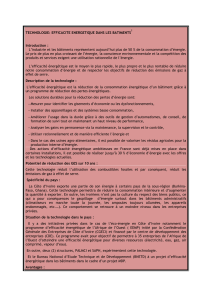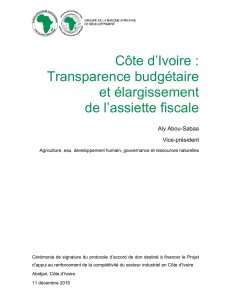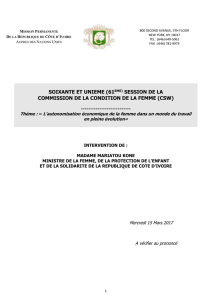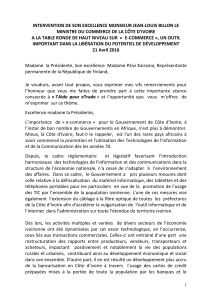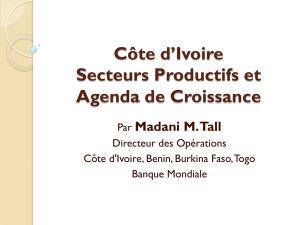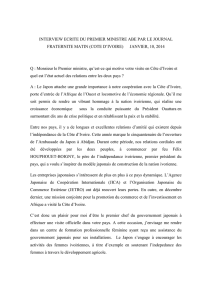GOUVERNANCE ET PLANIFICATION - CAPEC

1
GOUVERNANCE ET PLANIFICATION : QUEL ROLE DANS L’EMERGENCE DES PAYS ?
Présenté par
Zié BALLO (Chercheur à la CAPEC)
Assi KIMOU (Chercheur à la CAPEC)

2
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GÉNÉRALE ............................................................................................... 11
1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE ....................................................................................................... 11
2. OBJECTIFS ................................................................................................................................ 13
3. MÉTHODOLOGIE ......................................................................................................................... 13
SECTION 1 : EXPÉRIENCE DES PAYS ÉMERGENTS EN MATIÈRE DE PLANIFICATION
ET DE GOUVERNANCE ......................................................................................................... 13
I. LE RÔLE DU PLAN DANS LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DES PAYS ÉMERGENTS ...................... 13
1.1 CAS DE L’INDE .......................................................................................................................... 14
1.1.1.HISTORIQUE DE LA PLANIFICATION INDIENNE ............................................................................. 14
1.1.2. PLANIFICATION ET PERFORMANCE ÉCONOMIQUE EN INDE ......................................................... 15
1.2. CAS DE LA CHINE ...................................................................................................................... 18
1.2.1. HISTORIQUE DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE CHINOISE ........................................................... 18
1.2.2. PLAN VERSUS. MARCHÉ DANS L’ÉCONOMIE CHINOISE MODERNE ...................................................... 20
1.2.3 RÉSULTATS RÉCENTS .................................................................................................................... 22
1.3.L’EXEMPLE DES PAYS À STRUCTURES ÉCONOMIQUES PROCHES DE LA CÔTE D’IVOIRE : CAS DE LA MALAISIE ..... 23
1.3.1. EVOLUTION DE L’ÉCONOMIE MALAISIENNE ................................................................................ 23
1.3.2. LES PRINCIPAUX PLANS ET PROGRAMMES ÉCONOMIQUES ......................................................... 25
1.3.3. CADRE ET PROCESSUS DE PLANIFICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MALAISIE ............ 30
1.3.4. QUELQUES RÉSULTATS ................................................................................................................ 31
II- LES MODÈLES DE GOUVERNANCE ET LEUR IMPACT SUR LA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE DES PAYS ÉMERGENTS ............................................................................. 35
2.1. LE MODÈLE DE GOUVERNANCE CHINOIS ............................................................................. 36
2.1.1. LES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE CHINOIS DE GOUVERNANCE ............................................. 36
2.1.2.- L’IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU MODÈLE CHINOIS DE GOUVERNANCE ................................. 38
2.2- LE MODÈLE DE GOUVERNANCE INDIEN .......................................................................................... 38
2.2.3. LE MODÈLE DE GOUVERNANCE MALAYSIEN : UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE D’ÉRADICATION DE LA
CORRUPTION .......................................................................................................................................... 41
SECTION 2 : ANALYSE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GOUVERNANCE EN CÔTE
D’IVOIRE ................................................................................................................................. 47
I- LA PÉRIODE 1960-1980 ............................................................................................................ 47
1.1. PERSPECTIVES DÉCENNALES DE DÉVELOPPEMENT 1960-1970 ET PLAN QUINQUENNAL 1971-1975 ............. 47
II. LA PÉRIODE 1981-1999 ...................................................................................................... 53
2.1.LES PROGRAMMES D’AJUSTEMENT STRUCTURELS (PAS) ......................................................... 53
2.1.1. LA PÉRIODE 1981-1986 ................................................................................................................... 53
2.1.2- LA PÉRIODE 1987-1993 ................................................................................................................... 54
2.1.3 LA PÉRIODE 1994-1998 : L’AJUSTEMENT MONÉTAIRE ET LA POURSUITE DES REFORMES ............................... 55

3
2.2. L’ETAT DE LA GOUVERNANCE SUR LA PÉRIODE 1981-1999 ........................................................................ 55
III. LA PÉRIODE 2000 À 2012 ............................................................................................................ 57
3.1.LE DSRP 2009 ................................................................................................................................. 57
3.1.1. LES AXES DU DSRP ........................................................................................................................... 57
3.1.2- LES RÉSULTATS OBTENUS ........................................................................................................... 57
3.1.3. LES RÉSULTATS ENREGISTRÉS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE .................................................. 58
3.2.LE PND ............................................................................................................................................ 59
3.2.1. LES OBJECTIFS DU PND 2012-2015 ........................................................................................... 59
3.2.2- LES RÉSULTATS STRATÉGIQUES DU PND 2012-2015 ................................................................. 60
3.2.3 LES RÉSULTATS ENREGISTRÉS SUR LA PÉRIODE 2012-2013 ......................................................... 61
3.2.4 LES RÉSULTATS ENREGISTRÉS DANS LE DOMAINE DE LA GOUVERNANCE ................................... 61
IV-ANALYSE SWOT DE LA PLANIFICATION ET DE LA GOUVERNANCE EN CI AU
REGARD DES PAYS ÉMERGENTS ....................................................................................... 64
4.1. LA VISION .............................................................................................................................. 68
4.2. LA PLANIFICATION ................................................................................................................... 68
4.2.1 AU NIVEAU DU CADRE DE PLANIFICATION .................................................................................. 68
4.2.2. AU NIVEAU DU PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PND ................................................................ 68
4.2.3. AU NIVEAU DE LA MISE EN ŒUVRE DU PND ............................................................................... 69
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ........................................................................... 70
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : synthèse des principaux plans quinquennaux en Inde ........................................................ 16
Tableau 2: performance du 11ème plan quinquennal (2006-2010) ....................................................... 22
Tableau 3:incidence de la pauvreté ....................................................................................................... 26
Tableau 4: Comparasion de PPP entre la Côte d’Ivoire et la Malaisie (1990-2012) ............................. 32
Tableau 5: part des IDE dans les investissements de la Malaisie .......................................................... 32
Tableau 6: Evolution du marché de travail de la Malaisie .................................................................... 33
Tableau 7: synthèse de l’impact de l’e-gouvernance sur la lutte contre la corruption en Inde ............. 40
Tableau 8: récapitulatif de la planification et de la gouvernance dans les trois pays ............................ 43
Tableau 9: évolution de l’indice de corruption et de démocratie en Côte d’Ivoire de 1983 à 1999 ...... 56
Tableau 10: Evolution des indicateurs de gouvernance sur la période 1996-2011 ............................... 56
Tableau 11: Résultats stratégiques du PND et Cibles de développement ............................................. 60
Tableau 12: Forces et Faiblesses de la planification et de la gouvernance en Côte d'Ivoire ................. 65

4
Tableau 13: Matrice d'actions ............................................................................................................... 72
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Processus de Planification Economique de la Malaisie ........................................................ 31
Figure 2: comparaison de la structure des exportations en 1991 et 2012 .............................................. 33
Figure 3: évolution comparée du PIB/tête de la Malaisie ..................................................................... 34

5
RESUME ANALYTIQUE
La réflexion sur le développement économique en Afrique porte de plus en plus sur les
conditions de succès de la transformation des économies de l’Afrique subsaharienne. Les
débats théoriques interrogent bien souvent la dichotomie entre un rôle poussé de l’Etat et une
régulation axée sur le marché. En effet, malgré l’amélioration de ses indicateurs
macroéconomiques, l’Afrique fait encore face à un taux de pauvreté élevé et devra surmonter
de nombreux défis en matière de gouvernance et de gestion économique.
Néanmoins, des pays qui présentaient, il y a quelques décennies les mêmes caractéristiques
économiques que l’Afrique subsaharienne, ont pu réduire durablement les inégalités sociales,
transformer les structures de leur économie pour constituer aujourd’hui les moteurs de la
croissance de l’économie mondiale. Il apparait dès lors que le sentier emprunté par ces pays
pourrait constituer une source de bonnes pratiques pour l’Afrique subsaharienne.
Pourtant, dès l’accession à leur indépendance, plusieurs initiatives ont été prises par les pays
africains pour mettre rapidement les jeunes nations sur la voie de la prospérité. Ces actions
vont de la promotion de l’industrie de substitution aux importations à l’exportation accrue de
produits primaires. Ces politiques qui tantôt accordaient une place de choix au capitalisme
d’Etat, tantôt un ancrage au libéralisme économique, n’ont pas abouti de manière satisfaisante
aux résultats escomptés.
A l’instar des autres pays africains, la Côte d’Ivoire a élaboré un ensemble de plans
quinquennaux (1971-1975 ; 1976-1980 et 1981-1985) dans lesquels le marché et la puissance
publique ont coexisté. Si sur la période de planification l’on a constaté une embellie
économique avec un taux de croissance annuel moyen du PIB réel d’environ 7% au cours de
la décennie 70, la crise de la balance des paiements des années 1980 a consacré l’éloignement
de l’Etat de la sphère productive. Ainsi, la Côte d’Ivoire a mis en œuvre des programmes
d’Ajustement Structurels (PAS) en remplacement des plans quinquennaux. Pourtant,
aujourd’hui, les nouvelles économies émergentes combinent harmonieusement plan et
marché.
Les résultats mitigés de ces PAS conjugués aux crises sociopolitiques qu’a connues la Côte
d’Ivoire ont conduit à une aggravation de la pauvreté dont le taux est passé de 10% en 1985 à
48,9% en 2008. C’est ainsi que le pays a été éligible à l’initiative PPTE en mars 1998 et
adopté en 2009 son Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), disposant
ainsi d’un cadre de référence qui fixe les grandes orientations en matière de réduction de la
pauvreté et de développement économique, social et culturel.
Par ailleurs, pour lutter efficacement contre la pauvreté, le Gouvernement s’est engagé dans le
processus OMD. L’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du DSRP et des OMD a
donné des résultats mitigés (PND 2012- 2015). En conséquence, pour prendre en compte
d’une part, les nouveaux défis nés de la crise et d’autre part, les engagements conduisant au
point d’achèvement de l’initiative PPTE, le gouvernement a élaboré le Plan National de
Développement (PND 2012- 2015). Ce plan vise à transformer la Côte d’Ivoire en un pays
émergent à l’horizon 2020. Depuis 2012, la Côte d’Ivoire connaît un taux de croissance
annuel moyen du PIB réel supérieur à 9% et figure, selon le rapport Doing Business 2014 de
la Banque Mondiale, parmi les dix pays les plus réformateurs qui connaissent une dynamique
économique notable. Cette performance économique qui met en exergue l’une des conditions
nécessaires de la transformation structurelle vers une économie émergente risque d’être
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
1
/
76
100%