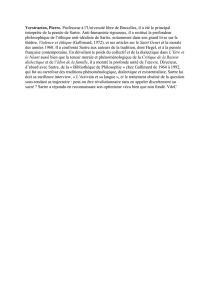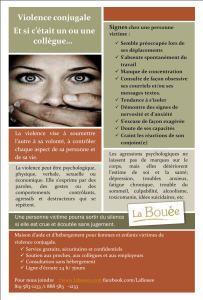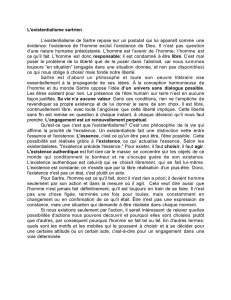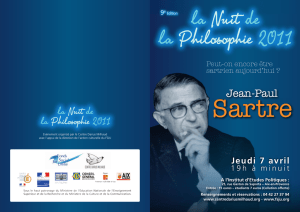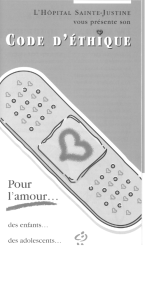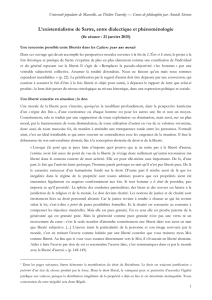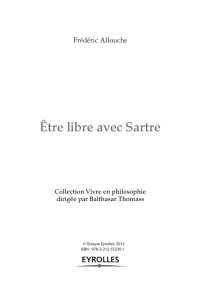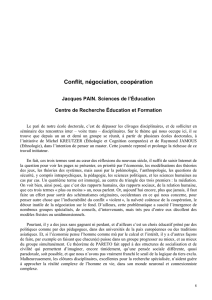Éthique et violence dans les Cahiers pour une morale de Sartre

Revue internationale
International Web Journal
www.sens-public.org
Éthique et violence dans
les
Cahiers pour une morale
de Sartre
GÉRARD WORMSER
Résumé : Rédigeant les
Cahiers pour une Morale
(Paris, Gallimard, 1983), Sartre poursuit, dans
la ligne du « Pour-autrui » de
l'Être et le néant
, et de ses
Réflexions sur la question juive
, la mise
à jour des modes selon lesquels la situation qui scelle notre être-dans-le-monde pose les
conditions initiales d'une historicité qui, à cette date (1948) reste encore à thématiser dans
nombre de ses dimensions. Bien qu'il ne les ait pas publiés, il est indéniable que les aspects les
plus incisifs de ces
Cahiers
ouvrent le questionnement qui conduira à la
Critique de la raison
dialectique
.
Voir le sommaire du DOSSIER : « Sartre : philosophie, littérature, politique... »
Contact : redactio[email protected]

Éthique et violence dans
les
Cahiers pour une morale
de Sartre
Gérard Wormser
édigeant les
Cahiers pour une Morale
(Paris, Gallimard, 1983), Sartre poursuit, dans
la ligne du « Pour-autrui » de
l'Être et le néant
, et de ses
Réflexions sur la question
juive
, la mise à jour des modes selon lesquels la situation qui scelle notre être-dans-
le-monde pose les conditions initiales d'une historicité qui, à cette date (1948) reste encore à
thématiser dans nombre de ses dimensions. Bien qu'il ne les ait pas publiés, il est indéniable que
les aspects les plus incisifs de ces
Cahiers
ouvrent le questionnement qui conduira à la
Critique de
la raison dialectique
. Sartre voudrait « comprendre comment la violence apparaît dans le monde
comme pure possibilité dès que l'homme surgit » et la saisir « comme type de rapport avec
l'autre » (p. 224). Il met en correspondance la typologie des comportements avec la hiérarchie des
valeurs, selon que la liberté y transparaît plus ou moins, d'une manière qui n'est pas sans rappeler
les travaux de Scheler. Il mentionne « la thèse générale et formelle » de Brentano et Scheler qui
fait de la position d'une fin une valeur en elle-même (p. 286)1. Scheler fait l'objet d'une lecture
critique de la part de Sartre : la notion de valeur est fondamentalement aliénée en ceci qu'elle
oppose à l'existence concrète un Moi idéal et fixe qui n'est jamais donné, et justifie l'opposition
abstraite de l'être et du devoir-être. Dans la ligne de Scheler les seules valeurs authentiques sont
celles que l'on peut reconnaître dans les sentiments affectivement éprouvés.
R
Les
Cahiers
décrivent les attitudes existentielles qui maintiennent la violence euphémisée au
principe des relations interhumaines : prière, exigence, et autres positions de négociation avec
autrui présupposent une violence originelle et chacun joue la comédie des mœurs apaisées. La
pacification apparente des relations reflète l'impossibilité pour chacun de résoudre la question de
la conversion à des relations généreuses soustraites aux mensonges et aux calculs pervers. Sartre
présente d'abord le degré zéro du rapport à l'autre, la violence comme comportement qui nie
l'altérité et même l'existence de l'autre. La violence adopte une relation équivoque à l'usage
technique : c'est faute de parvenir à enfoncer un clou par des gestes mesurés que je me mets à
taper comme un sourd, comptant sur le hasard pour réussir. À moins d'un péril extrême et
1 Voir à ce sujet de Brentano,
L'origine de la Connaissance morale
(1889), traduction par Marc de Launay et
Jean-Claude Gens, Paris, Gallimard, 2003, et de Max Scheler,
Le Formalisme en éthique et l'éthique
matériale des valeurs
, Paris, Gallimard, 1955, trad. par Maurice de Gandillac.
Article publié en ligne : 2005/03
http://www.sens-public.org/spip.php?article158
© Sens Public | 2

GÉRARD WORMSER
Éthique et violence dans les
Cahiers pour une morale
de Sartre
immédiat, les rapports avec autrui ne sont pas indifférents aux moyens car la violence altère les
fins qu'elle se propose. L'univers de la violence est un univers de masses faisant obstacle et
d'actions non composées visant la satisfaction immédiate. La violence suppose un ordre, un Bien,
mais un ordre tel qu'il serait moins à construire qu'à délivrer en détruisant ce qui fait obstacle. La
violence refuse de s'appuyer sur le monde, de faire avec lui, préfère la destruction du but à la
connaissance des droits et de l'opération légale. C'est le rêve de la destruction continuée. Ici,
« nous retrouvons l'analyse hégélienne du terrorisme » (p. 183), et Sartre décrit l'antinomie de la
violence, qui énonce un « droit à la violence » contre le fait. Pourtant, la violence se présente elle-
même contradictoirement comme un fait sans justification, et balance entre l'affirmation de la fin
générale de destruction du monde et l'exigence d'une reconnaissance par autrui de la légitimité de
cette violence. Or, cette reconnaissance ne peut pas être obtenue par la violence : l'autre résiste,
et je suis un monstre, ou il cède, et abdique la liberté requise. Ce paradigme permet l'analyse des
violences réelles – le viol, l'autodafé (violence fanatique) – et Sartre énonce les principes de la
morale de la force, autojustification de la violence fondée sur l'idée de la valeur de l'Être
indéterminé et la condamnation de la manière d'être. Cette « morale » exposée pp. 195-196,
regroupe divers traits de morales existantes en un tout cohérent portant à l'absolu certaines
tentations ou tendances. Elle consiste avant tout dans l'affirmation de l'absolu, et la lutte contre le
temps par création de l'irrémédiable – la destruction.
La violence explicite et franche n'est que le cas limite, et la « morale de la force » manifeste
trop son instabilité de principe pour être autre chose qu'un symptôme malheureusement fort
coûteux du caractère inopérant de la violence pure. La description sartrienne de la violence en fait
ainsi un principe d'usage non technique de la force. Là où l'emploi de techniques décompose les
phases d'une opération et réduit les forces à mettre en œuvre, la violence, en dépit de l'idée
qu'elle voudrait parvenir au but par n'importe quel moyen, indifférente aux moyens là même où ils
sont indissociables de la fin, n'emploie pas réellement de moyens et détruit son propre but. Il
reste que
« l'intransigeance du violent est l'affirmation du droit divin de la personne humaine
à avoir tout, tout de suite. L'univers n'est plus moyen, mais l'obstacle dense et
inessentiel entre le violent et l'objet de son désir. (...) Si le but ne doit être atteint
que par l'utilisation d'un instrument, alors périsse le but même et l'instrument. (...)
Et l'image que me renvoie mon opération est l'image d'un Moi qui au lieu d'être le
fondement de mon être est le fondement de son non-être. (...) La violence est
affirmation inconditionnée de la liberté. Ici nous retrouvons l'analyse hégélienne
du terrorisme... » (pp. 181-182)
Article publié en ligne : 2005/03
http://www.sens-public.org/spip.php?article158
© Sens Public | 3

GÉRARD WORMSER
Éthique et violence dans les
Cahiers pour une morale
de Sartre
À laquelle Sartre ajoute que le violent est de mauvaise foi, car il compte sur le monde pour
absorber son assaut et y résister, et il se compare volontiers à une force de la nature :
« Les expression d'impitoyable, d'inexorable sont fréquemment employées dans
les serments de violence... » (p. 184)
Après la violence qui détruit son but, le cas d'une violence qui veut atteindre son but dans
l'indifférence aux moyens : sous cet aspect, le viol manifeste le consentement comme exigence de
la liberté, et fait de la relation des moyens à la fin le critère de justification de l'action. C'est ce
critère que récuse le violent, qui détruit la finalisation elle-même. Sartre esquisse une
hypothétique « morale » de la force, fondée contradictoirement sur l'apologie du fait et de l'être
brut, dont il repère l'emprise dans les attitudes éducatives.
Ainsi, quand les parents disent à l'enfant, anticipant une sanction automatique : « Si tu ne
mets pas ton manteau, tu vas attraper froid » (au lieu de « Si tu ne mets pas ton manteau, tu
risques de prendre froid ») leur attitude contrevient à toute entreprise de l'enfant : toute
entreprise suppose l'acceptation de risques, et l'attitude des parents signifie pour l'enfant un
interdit absolu. Le père est irrémédiable, sa parole suivie d'un silence sans appel : l'enfant doit se
conformer à ses exigences et non poser des fins. Pour Sartre évoquer l'univers de l'enfance est
truqué : quand il n'est pas peuplé d'impératifs, il l'est de raisons qui lui échappent, quand même
elles viseraient son bien futur. De toutes façons, l'enfant doit croire. L'enfant dont la liberté est
limitée par l'ignorance est dans l'erreur, d'une façon telle que nous ne pouvons l'en tirer – il y
faudrait le temps pour lui de devenir adulte. On admettra qu'on ne puisse dire toute la vérité aux
enfants, ou, ce qui revient au même, qu'ils ne la comprendraient pas entièrement. Mais c'est
justement ce qui marque une situation de violence, puisque ses initiatives ouvrent sur des
résultats que d'autres ont prévus et pas lui, qu'il agit sous contrôle, et que le sens de ses actes lui
échappe. Tenue à la soumission, l'enfance incarne une aliénation naturelle, qui provient de la seule
présence de l'adulte. Il y a là un modèle constitutif essentiel chez Sartre (dont a fort bien traité
Josette Pacaly) selon lequel l'ignorance est aliénation quand elle est savoir pour autrui.
De façon analogue, la ruse et le mensonge sont des violences : l'autre est joué, vit dans un
monde truqué sous l'un de ses aspects, précisément celui sous lequel s'appuie l'autre. La
justification de la violence est son redoublement quasi-juridique : « exigence du plus fort d'être
traité comme une personne par celui qu'il asservit » (pp. 150-166). La manipulation est au cœur
de la violence, car elle sape la liberté de l'intérieur. Et si la violence peut receler une affirmation de
liberté – Sartre évoque le Groupe Stern qui met l'accent non sur la libération abstraite de l'homme,
mais sur celle de la Palestine – le mensonge brouille les repères mêmes du monde : après qu'un
« type de la Gestapo » a exécuté l'un des élèves de Sartre et son père, il persuade la maîtresse du
Article publié en ligne : 2005/03
http://www.sens-public.org/spip.php?article158
© Sens Public | 4

GÉRARD WORMSER
Éthique et violence dans les
Cahiers pour une morale
de Sartre
père qu'ils sont dans un camp en France et qu'il leur portera des lettres (p. 205). La falsification
est ici la pire violence, car elle suscite des sentiments et des conduites authentiques sur le fond
d'une tromperie cachée qui annule toute la signification de ces actes.
Que penser dans ce cadre des mensonges accomplis « pour une cause aux tenants de cette
cause eux-mêmes ? » (p. 209). Dans le cas de la religion pour le peuple la mystification n'atteint
son but qu'en induisant des actions à vide, et jusqu'à des sentiments sans objet, afin de perpétuer
un ordre ; dans celui du mensonge aux membres d'un parti par les dirigeants de ce parti, le coup
de force est un sophisme qui veut que tous ayant la même fin, ils en veulent aussi les moyens ;
certains militants le jugeront admissible – la non-divulgation d'un échec peut aider la troupe à
conserver le moral et à l'emporter finalement sur l'adversaire. Mais cette fidélité apparente est une
trahison analogue au viol qui préjuge du consentement en manifestant le refus de toute réserve ;
si la fin suprême est le maintien d'une foi dénuée des motifs de croire, la mystification est totale.
Le chef décide alors de ce que « veulent » des libertés, et que la fin déterminante soit l'efficacité
par rapport à des buts spécifiques qui deviennent arbitraires. Sartre, avec peut-être la pensée de
Paul Nizan, cite le mot de Valentin Feldman au peloton d'exécution du Mont Valérien : « Imbéciles,
c'est pour vous que je meurs » (p. 212).
La violence défensive, que Sartre examine à la suite, est celle que j'emploie pour me défendre
alors que l'on ne m'a pas fait violence. C'est par exemple le refus de la discussion, alors qu'un
désaccord s'est fait jour entre deux personnes, ou bien l'emploi d'arguments
ad hominem
(p. 217).
Soit le jugement de goût : un désaccord entre nous est échec pour la liberté. Mais refuser de
discuter les raisons de l'autre (des goûts et des couleurs...), c'est user de violence défensive, dont
Sartre donne plusieurs exemples.
Le concept de violence ne connaît-il pas alors une extension excessive ? Paradigme du non-
rapport, il devient une modalité normale des rapports quotidiens avec l'autre et Sartre entend
montrer que les rapports avec l'autre sont toujours faussés par les asymétries de situation entre
les personnes. D'où une suite de descriptions morales de ces asymétries ordinaires : les situations
de prière et d'exigence, puis d'appel, d'acceptation et de refus déboucheront sur l'approche de
l'ignorance et l'échec qui sont des rapports objectivement faussés, qui serviront à élaborer le
concept d'oppression, ce rapport à autrui qui mobilise les formes du droit au service de la
violence.
Les types de demande à l'Autre
Prier, c'est se soumettre à la décision ou à l'événement et désirer que soit suspendu son effet.
Une liberté s'adresse à une autre, reconnue comme souveraine : la prière renvoie à une
Article publié en ligne : 2005/03
http://www.sens-public.org/spip.php?article158
© Sens Public | 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%