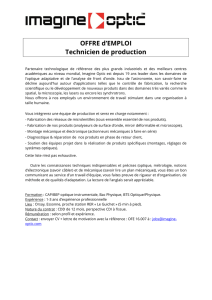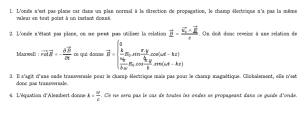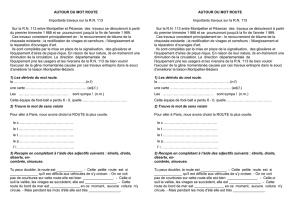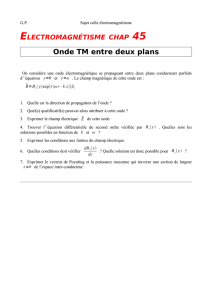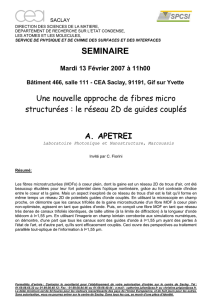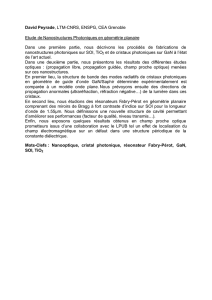Caractérisation par Microscopie en Champ Proche Optique de

Conclusion et Perspectives :
VERS L’ETUDE DE
COMPOSANTS
NANOPHOTONIQUES

Conclusion et Perspectives : VERS L’ETUDE DE COMPOSANTS NANOPHOTONIQUES
134
CONCLUSION
Au cours de ce travail de thèse, nous avons effectué la mise en place d’une
expérience de microscopie en champ proche optique appliquée à l’étude de composants
de l’optique intégrée, qui soit opérationnelle dans le domaine des longueurs d’ondes des
télécommunications (1.3-1.55 µm). Nous avons mis en œuvre l’utilisation d’une platine
piézoélectrique dédiée à l’injection de lumière dans les structures guidantes et utilisé la
technologie de l’optique fibrée de manière à optimiser la puissance injectée ainsi que la
collection du signal de champ proche.
Nous avons appliqué cette technique à l’étude de composants de l’optique intégrée
sur verre à base de guide multimode. Nous avons mis en évidence l’influence de la
position d’injection sur le processus de formation des images d’interférence au sein d’un
guide faiblement multimode. L’étude de la propagation au sein d’un tel guide nous à
conduit à calculer une longueur de battement pour cette structure différente de celle
prédite par la théorie. Une analyse de l’excitation modale de la structure s’appuyant sur
les paramètres dérivés de nos mesures nous a en outre permis de redéfinir le calcul de
longueur de battement et ainsi de faire concorder nos mesures à la théorie.
Notre deuxième étude a consisté en l’analyse précise du processus de formation des
images d’interférence au sein d’une structure de T-magique optique selon divers modes
d’excitation. La cartographie du champ propagé nous a permis d’établir un retour sur les
paramètres physiques de la structure et sur son fonctionnement. Nous avons notamment
mesuré la position exacte des guides d’accès et montré l’existence d’un couplage de
lumière à hauteur de 10% entre eux. Nous avons également mis en évidence l’asymétrie
de la jonction Y et son influence sur la formation des images d’interférence. Notre étude
nous à également conduit à déterminer une largeur de section multimode supérieure à
celle donnée par les dimensions du masque d’échange. Enfin, nous avons mis en
évidence une longueur de section multimode idéale qui serait supérieure à celle prédite
par la théorie. Cette étude à permis de mettre en évidence l’apport incomparable de la
microscopie en champ proche optique pour l’étude de tels composants car elle permet,
de manière précise et non destructive, un retour sur les paramètres physiques de la
structure. Se pose néanmoins le problème du nombre d’excitations accessibles pour une
structure donnée. En effet, la résolution du problème inverse qui consiste, à partir d’une
carte de champ donnée, à recouvrir la valeur des paramètres définissant les structures,
nécessite un nombre d’excitation de cette structure le plus grand possible afin de
pouvoir décorréler les différents effets liés à chacun de ces paramètres.
Enfin, nous avons porté notre attention sur l’étude d’un imageur MMI conçu en vu
de son utilisation comme recombineur pour 4 télescopes astronomiques. L’étude de cette
structure pour une excitation donnée nous a dans un premier temps permis de mettre en
évidence une valeur pour le contraste d’indice plus élevée (∆n = 2.8x10
-3
) que celle
initialement escomptée (∆n = 1.3x10
-3
). L’analyse de la propagation pour une excitation
différente nous a ensuite conduit à remettre en question l’approximation de la
modélisation de la structure par un profil à saut d’indice. Nous avons montré qu’un
profil d’indice modélisant un gradient d’indice conduit à une simulation de la structure
en excellent accord avec ce qui est observé en champ proche. Le modèle utilisé reste
cependant une approximation relativement simpliste du véritable profil d’indice de la

Conclusion et Perspectives : VERS L’ETUDE DE COMPOSANTS NANOPHOTONIQUES
135
structure et des études complémentaires sont en cours afin de déterminer précisément,
via le calcul du profil des contraintes induites par l’échange, le profil d’indice réel de
ces structures. Notre étude à également permis la mise en évidence d’un certain
dysfonctionnement de la structure pour l’application de recombinaison de quatre
signaux, puisque, pour une excitation donnée, un des signaux de sortie est absent. Nous
avons néanmoins pu établir que le dispositif présentait une longueur optimisée de
recombinaison de 6200 µm pour un fonctionnement à trois signaux d’entrée seulement.
Nous avons donc montré, à travers ce travail, que la microscopie en champ proche
optique est un outil inégalable pour l’étude et la caractérisation de composants de
l’optique intégrée sur verre. Les cartes du champ propagé obtenues permettent, par
résolution d’un problème inverse, un retour fin sur les paramètres physiques des
structures étudiées. Nous avons vu qu’il est cependant nécessaire d’avoir plusieurs types
d’excitation de ces structures afin de résoudre pleinement ce problème inverse.
Néanmoins, nous avons montré, qu’à partir d’un nombre d’excitation suffisantes, le
comportement du composant peut être décrit de manière précise et que nous pouvons
calculer les valeurs de certains des paramètres optimisant le fonctionnement des
structures.

Conclusion et Perspectives : VERS L’ETUDE DE COMPOSANTS NANOPHOTONIQUES
136
PERSPECTIVES
Le potentiel inégalable de la microscopie en champ proche optique pour l’étude de
composants de l’optique intégrée voit encore son intérêt s’accroître par le pouvoir de
résolution que procure cette technique. En effet, le besoin actuel de dispositifs optiques
de tailles toujours plus faibles rend cette méthode de caractérisation locale très
attractive. Le domaine des interconnexions optiques, notamment, qui vise à terme le
remplacement des connexions métalliques dans les circuits intégrée par des connexions
optiques, nécessite une réduction drastique de la taille des composants optiques en vue
de leur intégration sur les circuits développée par la microélectronique. Cette réduction
nous conduit de nos jours à des composants de tailles inférieures à la longueur d’onde.
Ce domaine constitue donc un champ d’investigation parfaitement adapté à l’utilisation
de la microscopie en champ proche optique. Deux voies principales sont empruntées
jusqu’à présent dans le but de réduire les tailles des dispositifs. L’une d’elles, appelée
réfractive, consiste en l’utilisation de matériaux dont le contraste d’indice est élevé
(typiquement supérieur à 2) ce qui conduit à un très fort confinement de la lumière et
permet le développement de fonctionnalités sur des distances très faibles (MMI NxN de
quelques dizaines de microns, virages à angle droit à faibles rayons de courbure…).
L’autre voie consiste en l’utilisation des cristaux photoniques qui permettent également
la conception de dispositifs optiques complexes de basse dimensionnalité (guide sub-
microniques, virages, micro-cavités…).
L’étude de composants nanophotoniques (sub-longueur d’onde) par microscopie en
champ proche optique à été initiée au cours de ce travail. Nous en présentons les
premiers résultats ci-après. Notons toutefois que si l’utilisation de la microscopie en
champ proche optique pour l’étude de ce type de structure paraît toute indiquée, elle
souffre néanmoins de certains handicaps. Premièrement, les structures à fort contraste
d’indice aussi bien que celle à base de cristaux photoniques sont sujettes à une forte
diffusion de la lumière dans la direction verticale si des défauts sont présents. Ceci
influe alors sur la dynamique de détection du signal et il est bien souvent difficile de
percevoir le champ évanescent (de niveau faible) qui se retrouve noyé dans le signal
diffusé. Mais le point principal limitant l’étude de ces composants de basse
dimensionnalité reste la pointe SNOM. D’une part la taille de l’ouverture doit être faible
(typiquement inférieure à 100 nm) mais nous devons également posséder une très bonne
reproductibilité de ces pointes. Ce sont les deux paramètres majeurs qui ont limités notre
travail sur des composants nanophotoniques.

Conclusion et Perspectives : VERS L’ETUDE DE COMPOSANTS NANOPHOTONIQUES
137
STRUCTURES REFRACTIVES SUR SOI
Le choix de la filière SOI pour le développement de dispositifs pour les
interconnexions optiques se base sur les critères suivants :
La filière SOI est compatible avec la technologie CMOS. Le Si du SOI
forme naturellement un guide d’onde optique à la longueur d’onde de
1.3 µm avec de très faibles pertes si épaisseur d’oxyde > 0.5 µm.
Utilisation des techniques de fabrication de la microélectronique.
Possibilité d’introduction d’un confinement latéral -> guides Si
entourés de SiO2.
Grand contraste d’indice Si/SiO2 -> fort confinement -> réduction des
tailles des guides à des dimensions sub-microniques et virages à faible
rayons de courbure sans pertes prohibitives. De plus quelques microns
d’espacement entre guides d’onde suffisent pour éviter la diaphonie.
Densité d’intégration importantes dans une techno totalement
compatible (intégrable) avec la microélectronique Si.
L’étude que nous présentons ici a pour principal but de mettre en évidence la
possibilité d’effectuer des mesures quantitatives par microscopie en champ proche
optique. Après une brève description de la structure étudiée, nous nous attacherons à
déterminer l’origine des pertes observées et à les mesurer.
Description du composant
Les structures des guides d’ondes sur SOI ont typiquement l’architecture de la Figure
p-1. Un oxyde de silicium est déposé sur un substrat de silicium sur une épaisseur
d’environ 1 µm pour isoler le guide du sus-mentionné substrat. On fait alors croître une
couche de silicium de 400 nm d’épaisseur sur l’oxyde enterré et diverses étapes de
gravure sont réalisées afin d’obtenir un guide confiné latéralement de largeur environ
400 nm. Une couche de silice d’encapsulation est alors déposée au dessus du guide
formé. Nous avons donc ainsi un guide d’onde de 400 nm par 400 nm, théoriquement
monomode à la longueur d’onde de 1.3 µm.
Figure p-1 : Architecture des guides d’ondes sur SOI étudiés. Le guide de silicium est
encapsulé dans une matrice de SiO2 d’environ 0,4 µm d’épaisseur. Une épaisseur d’1 µm
d’oxyde enterré est choisi de manière à isoler totalement le guide du substrat.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%