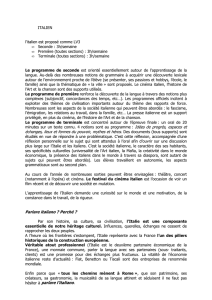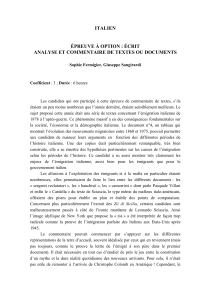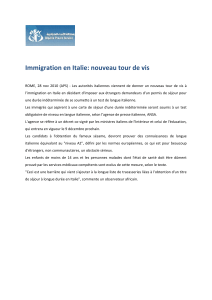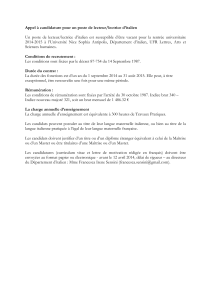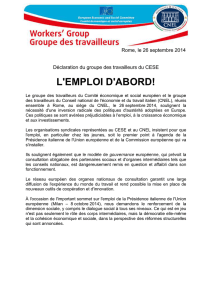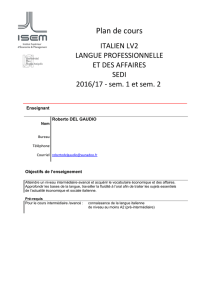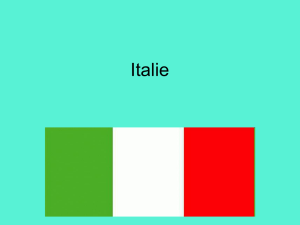L`Italie : un destin européen

Questions
Imprimé en France
Dépôt légal :
1er trimestre 2013
ISSN : 1761-7146
N° CPPAP : 1012B06518
DF 2QI00590
9,80 €
Printed in France
CANADA : 14.50 $ CAN
Dossier
L’Italie : un destin européen
Ouverture. Des rayons et des ombres
Serge Sur
La longue marche de la démocratie italienne
Marie-Anne Matard-Bonucci
«Crise permanente»?
La difficile institutionnalisation de la «IIeRépublique»
Hervé Rayner
Du miracle économique à la stagnation
Céline Antonin
La société de Janus: l’Italie à l’épreuve de la modernité
Stéphane Mourlane
Le régionalisme: du dépassement au retour inachevé
Christophe Roux
La construction européenne: le guide et le bâton
Dominique Rivière
Une politique extérieure entre Europe et Méditerranée
Jean-Pierre Darnis
Et les contributions de
Roberto Aliboni, Antonio Bechelloni, Olivier Forlin, Jean Gili, Marie Levant,
Charlotte Moge, Camille Schmoll et Jean-Michel Tobelem
Chroniques d’actualité
Guerre et économie: les liaisons dangereuses
Jacques Fontanel
L’ONU, un «machin» bien utile
Renaud Girard
Questions européennes
L’Ukraine, ou le réveil de la république des confins
Alain Guillemoles
Regards sur le monde
L’Azerbaïdjan vingt ans après l’indépendance
Bayram Balci
Présidentielle américaine de2012: les aléas du processus électoral
Anne Deysine
Histoires de Questions internationales
NapoléonIII et l’unité italienne
Yves Bruley
Documents de référence
Les questions internationales sur Internet
Abstracts
&:DANNNB=[UUZ^[:
L’Italie : un destin européen N° 59
dF
Questions
internationales
L’Italie
Un destin européen
CANADA : 14.50 $ CAN
&’:HIKTSJ=YU^]U^:?a@a@f@t@k"
M 09894
- 59 -
F: 9,80 E
- RD
L’Ukraine : le renouveau ?
L’Azerbaïdjan sous tension
Un bilan de l’élection américaine
Napoléon III et l’Italie
Janvier -février 2013 N° 59
Questions
internationales
Questions
internationales
N° 59 Janvier-février 2013
QI N°59 L'Italie-CORLET.indd 1 20/12/12 16:02
503120210-Couv.pdf - Décembre 24, 2012 - 1 sur 2 - BAT DILA

Avertissement au lecteur : Les opinions exprimées dans les contributions n’engagent que les auteurs.
© Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2013.
«En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toute reproduction partielle ou
totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans autorisation expresse de l’éditeur. Il est rappelé à cet égard que
l’usage abusif et collectif de la photocopie met en danger l’équilibre économique des circuits du livre.»
Numéros parus :
- Le Sahel en crises (n°58)
- La Russie au défi du XXIesiècle (n°57)
- L’humanitaire (n°56)
- Brésil : l’autre géant américain (n° 55)
- Allemagne : les défis de la puissance (n° 54)
- Printemps arabe et démocratie (n° 53)
- Un bilan du XXe siècle (n° 52)
- À la recherche des Européens (n° 51)
- AfPak (Afghanistan – Pakistan) (n° 50)
- À quoi sert le droit international (n° 49)
- La Chine et la nouvelle Asie (n° 48)
- Internet à la conquête du monde (n° 47)
- Les États du Golfe: prospérité & insécurité (n° 46)
- L’Europe en zone de turbulences (n° 45)
- Le sport dans la mondialisation (n° 44)
- Mondialisation: une gouvernance introuvable (n° 43)
- L’art dans la mondialisation (n° 42)
- L’Occident en débat (n° 41)
- Mondialisation et criminalité (n° 40)
- Les défis de la présidence Obama (n° 39)
- Le climat: risques et débats (n° 38)
- Le Caucase: un espace de convoitises (n° 37)
- La Méditerranée. Un avenir en question (n° 36)
- Renseignement et services secrets (n° 35)
- Mondialisation et crises financières (n° 34)
- L’Afrique en mouvement (n° 33)
- La Chine dans la mondialisation (n° 32)
- L’avenir de l’Europe (n° 31)
- Le Japon (n° 30)
- Le christianisme dans le monde (n° 29)
- Israël (n° 28)
- La Russie (n° 27)
- Les empires (n° 26)
- L’Iran (n° 25)
- La bataille de l’énergie (n° 24)
- Les Balkans et l’Europe (n° 23)
- Mondialisation et inégalités (n°22)
- Islam, islams (n° 21)
- Royaume-Uni, puissance du XXIe siècle (n° 20)
- Les catastrophes naturelles (n° 19)
- Amérique latine (n° 18)
- L’euro: réussite ou échec (n° 17)
- Guerre et paix en Irak (n° 16)
- L’Inde, grande puissance émergente (n° 15)
- Mers et océans (n° 14)
- Les armes de destruction massive (n° 13)
- La Turquie et l’Europe (n° 12)
- L’ONU àl’épreuve (n° 11)
- Le Maghreb (n° 10)
- Europe/États-Unis: Le face-à-face (n° 9)
- Les terrorismes (n° 8)
- L’Europe à25 (n° 7)
- La Chine (n° 6)
- Les conflits en Afrique (n° 5)
- Justices internationales (n° 4)
À paraître :
t-FTWJMMFTNPOEJBMJTÏFT
t-B'SBODFEBOTMFNPOEF
Questions
internationales
Direction
de l'information légale
et administrative
La documentation Française
29-31 quai Voltaire 75007 Paris
Téléphone : (0)1 40 15 70 10
Directeur de la publication
Xavier Patier
Commandes
Direction de l’information
légale et administrative
Administration des ventes
23 rue d’Estrées
CS10733
75345 Paris cedex 07
Téléphone : (0)1 40 15 70 10
Télécopie : (0)1 40 15 70 01
www.ladocumentationfrancaise.fr
Notre librairie
29 quai Voltaire
75007 Paris
Tarifs
Le numéro : 9,80 €
L’abonnement d’un an (6 numéros)
France : 48 € (TTC)
Étudiants, enseignants : 40 €
(sur présentation d'un justificatif)
Europe : 53,90 € (TTC)
DOM-TOM-CTOM : 53,50 €
Autres pays : 56,60 €
Conception graphique
Studio des éditions DILA
Mise en page DILA, impression CORLET
Photode couverture :
La façade d’un immeuble à Turin
pavoisée de drapeaux italiens
à l’occasion du 150e anniversaire
de l’Unité, en mars 2011.
© AFP / Mathieu Gorse
2e de couverture:
La skyline de Shanghai.
© AFP / Philippe Lopez
Prochain numéro
Les villes mondialisées
QI N°59 L'Italie-CORLET.indd 2 20/12/12 16:02
503120210-Couv.pdf - Décembre 24, 2012 - 2 sur 2 - BAT DILA

Questions
internationales
Éditorial
1
Questions internationales no 59 – Janvier-février 2013
L
’
image de l’Italie est souvent associée à de nombreux clichés,
le dernier en date étant celui d’une économie d’un pays «Club
Med». Loin de ces lieux communs, l’Italie est avant tout une
grande puissance européenne, un État-nation au développement
économique brillant, une puissance industrielle, une société
civile active, une intelligentsia remarquable, l’un des principaux pôles
culturels et artistiques de l’Europe. Ce sont ces caractères qui font de
l’Italie l’un des piliers de la construction européenne, et que le présent
dossier entreprend d’analyser. Son fil rouge est que l’Italie est une
composante indissociable de cette construction, qui lui imprime sa marque
et oriente sa politique, même si l’attraction de l’Alliance atlantique et des
États-Unis est parallèlement forte.
Le dossier, y compris avec les «Histoires de Questions internationales»
et les «Documents de référence», ne néglige pas la dimension historique
de l’État italien, encore relativement récente. Il s’attache à la réalisation de
l’unité italienne, à la construction de l’État et à l’implantation progressive
d’un régime démocratique, mais aussi aux difficultés contemporaines,
difficultés politiques et institutionnelles, stagnation économique, déclin
démographique, clivages objectifs et subjectifs, régionaux, économiques
et sociaux de la société civile, modestie de la politique extérieure. Sur
ces différents points, l’Italie possède certes sa spécificité, mais nombre
d’entre eux sont communs aux membres de l’Union européenne.
Pour les rubriques récurrentes, on retrouvera les «Chroniques d’actualité»,
mais aussi une étude sur la dernière élection présidentielle américaine. De
façon plus synthétique, deux études sur l’Ukraine d’un côté, l’Azerbaïdjan
de l’autre. Ces deux États récents, à la périphérie de l’Union européenne
mais membres du Conseil de l’Europe, ont un passé commun comme
républiques de la défunte URSS. En dépit de cette proximité, beaucoup
de traits les opposent, langue, religion, traditions, ressources naturelles,
dimension, situation géographique, voisinage… À des titres divers, les
deux États illustrent les difficultés de la sortie de l’héritage soviétique et
cherchent leur place aux frontières non stabilisées de l’Union européenne
ou de l’OTAN, voire à l’intérieur. Avant cependant que ces perspectives
ne leur soient ouvertes, un long chemin reste à parcourir.
Cette première livraison de Questions internationales en2013 est aussi
l’occasion de souhaiter à ses lecteurs une année qui réponde à leurs projets
et à leurs espérances.
Questions internationales
Comité scientifique
Gilles Andréani
Christian de Boissieu
Yves Boyer
Frédéric Bozo
Frédéric Charillon
Georges Couffignal
Alain Dieckhoff
Robert Frank
Nicole Gnesotto
Pierre Grosser
Pierre Jacquet
Pascal Lorot
Guillaume Parmentier
Fabrice Picod
Philippe Ryfman
Jean-Luc Sauron
Ezra Suleiman
Serge Sur
Équipe de rédaction
Serge Sur
Rédacteur en chef
Jérôme Gallois
Rédacteur en chef adjoint
Céline Bayou
Ninon Bruguière
Rédactrices-analystes
Anne-Marie Barbey-Beresi
Sophie Unvois
Secrétaires de rédaction
Isabel Ollivier
Traductrice
Marie-France Raffiani
Secrétaire
Teodolinda Fabrizi
Houda Tahiri
Stagiaires
Cartographie
Thomas Ansart
Benoît Martin
Patrice Mitrano
(Atelier de cartographie de Sciences Po)
Conception graphique
Studio des éditions de la DILA
Mise en page et impression
DILA, CORLET
Conta
cter
la rédaction :
Questions internationales
assume la respon-
sabilité du choix des illus trations et de leurs
légendes, de même que celle des intitulés, cha-
peaux et intertitres des articles, ainsi que des
cartes et graphiques publiés.
Les encadrés figurant dans les articles sont rédi-
gés par les auteurs de ceux-ci, sauf indication
contraire.

No 59 SOMMAIRE
2
Questions internationales no 59 – Janvier-février 2013
L’Italie
Un destin européen
4 Ouverture – Des rayons
et des ombres
Serge Sur
8 La longue marche
de la démocratie italienne
Marie-Anne Matard-Bonucci
24 «Crise permanente»?
La difficile
institution nalisation
de la «IIeRépublique»
Hervé Rayner
36 Du miracle économique
à la stagnation
Céline Antonin
48 La société de Janus:
l’Italie à l’épreuve
de la modernité
Stéphane Mourlane
59 Le régionalisme:
du dépassement
au retour inachevé
Christophe Roux
© AFP / Mathieu Gorse
DOSSIER…
DOSSIER…

3
Questions internationales no 59 – Janvier-février 2013
69 La construction
européenne:
le guide et le bâton
Dominique Rivière
78 Une politique extérieure
entre Europe
et Méditerranée
Jean-Pierre Darnis
Et les contributions de
RobertoAliboni(p.76),
AntonioBechelloni(p.57),
OlivierForlin(p.34), JeanGili(p.84),
MarieLevant(p.53), CharlotteMoge(p.21),
CamilleSchmoll(p.44)
etJean-MichelTobelem(p.65)
Chroniques d’ACTUALITÉ
88 Guerre et économie:
les liaisons dangereuses
Jacques Fontanel
90 L’ONU,
un «machin» bien utile
Renaud Girard
Questions EUROPÉENNES
92 L’Ukraine, ou le réveil de
la république des confins
Alain Guillemoles
Regards sur le MONDE
99 L’Azerbaïdjan vingt ans
après l’indépendance
Bayram Balci
107 Présidentielle américaine
de2012: les aléas
du processus électoral
Anne Deysine
HISTOIRES
de Questions internationales
113 NapoléonIII
et l’unité italienne
Yves Bruley
Documents de RÉFÉRENCE
119 Les registres
de la puissance italienne
Napoléon Ier, Comte de Cavour,
Comte Ciano, Carlo Sforza
et Alcide De Gasperi (extraits)
Les questions internationales
sur INTERNET
124
Liste des CARTES et ENCADRÉS
ABSTRACTS
125 et 126
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
1
/
132
100%