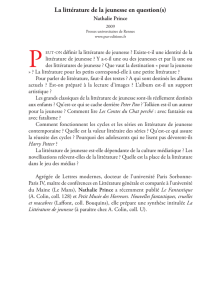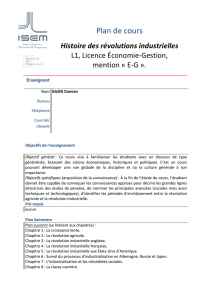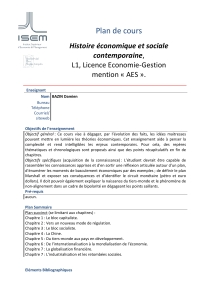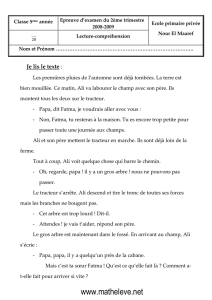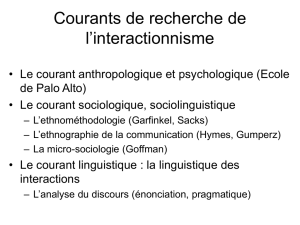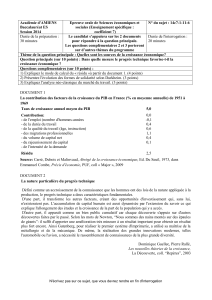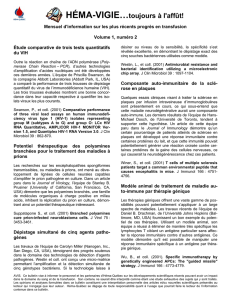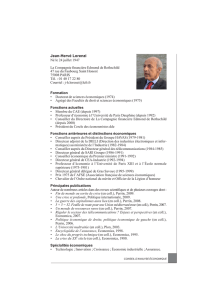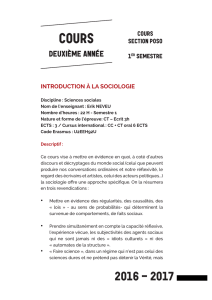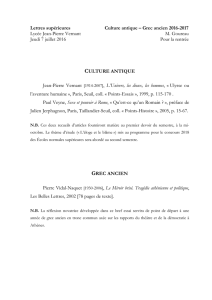Ghebaur_ARDIS121312 - Alliance de recherche sur les

1
Cosmina Ghebaur
Laboratoire CIMEOS, Université de Bourgogne
ATER, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Les non-publics au musée.
Un exemple de discrimination dans le domaine de la culture
Mes recherches portent sur les non-publics de la culture (Ancel & Pessin, 2004), ces
personnes en situation, à l’instant t, de non-pratique culturelle, de non-contact avec un objet
culturel donné. Je les aborde sous l’angle de leur fabrication institutionnelle, à savoir en tant
qu’ils sont produits par les institutions chargées, sur un territoire donné, des politiques
culturelles les concernant. Sur ce point, les quinze dernières années sont marquées en France,
dans le contexte de la décentralisation culturelle définie en 1982-1983, par un investissement
croissant des collectivités territoriales (Saez, 2009). Certaines villes – c’est sans doute
l’échelon le plus actif – mettent en œuvre des propositions très fournies en direction de leurs
populations. C’est notamment le cas à Fleury-la Rivière1, commune de la banlieue parisienne
appartenant à l’ancienne « ceinture rouge »2 (Merlin, 1998 : 64). Sa Direction de la Culture se
donne pour mission de combattre les « obstacles symboliques », à savoir le sentiment d’une
partie de la population – les « non-publics » justement3 – d’être « exclue » ou « non
concernée » par la programmation municipale. Il s’agit d’enclencher, subséquemment, une
« dynamique d’appropriation » : appropriation de « langages artistiques et culturels », de
« productions », de « lieux ».
Alors que des dispositifs de médiation sont institutionnellement mis en place pour
créer du « lien », du « contact » (Caune, 1999) entre des publics et des œuvres – des publics
pensés comme éloignés de la culture et des œuvres de la culture savante –, certains de ces
dispositifs produisent au contraire de l’absence, de la distance, des réticences et résistances.
Pour comprendre ce phénomène, le cas le plus intéressant est celui des migrants visés par des
politiques publiques d’intégration. Ce cas est à même de produire, me semble-t-il, un « effet
loupe », de grossissement sur la question des non-publics et de leur fabrication
institutionnelle. En effet, il permet d’aborder cette question dans un cadre où les acteurs font
l’objet d’une « pression assimilatrice » (D’Iribarne, 2009) : une imposition de normes,
valeurs, perspectives et au-delà, de phénomènes relevant de la violence symbolique, cette
violence « douce », « larvée » (Bourdieu, 1980 : 220), qui s’exerce au nom des croyances
légitimes de la société d’accueil. Et ce qui permet à cette violence de s’installer au cœur des
dispositifs de médiation évoqués et de les détourner de leur projet initial, ce sont parfois –
c’est ce qu’on verra dans cette communication – la stigmatisation et la discrimination des
personnes prises en charge.
1 Le nom de la ville, ainsi que les prénoms ont été changés afin de préserver l’anonymat des enquêtés.
2 La « ceinture rouge » est une couronne de communes ouvrières et communistes constituée autour de Paris à
partir des années 1930.
3 Ce terme n’est à aucun moment défini par la Direction de la Culture. Cette instance se contente d’affirmer, dans
son projet de service, la nécessité d’aborder « différemment » cette partie de la population « longtemps laissée
pour compte par les acteurs culturels ». La rhétorique utilisée laisse entendre que le terme est utilisé pour référer
aux classes populaires ; dans la perspective d’Ancel et Pessin dans laquelle je me place, il s’agit au contraire
d’une notion trans-classes. Quiconque peut être, note ainsi Martine Azam, « à la fois » public et non-public
s’agissant d’objets culturels différents, voire « plus ou moins » public au cours d’une même expérience de
réception, selon notamment le degré d’engagement aux œuvres (2004 : 69).

2
Pour appréhender ces mécanismes, je m’appuierai sur une enquête au cours de laquelle
j’ai participé à des sorties culturelles avec des migrants issus principalement des classes
populaires. Ces sorties – sur lesquelles je me suis, de fait, greffée4 – étaient organisées par
différentes structures municipales, dont un centre social situé dans les grands ensembles de
Fleury. L’enjeu pour moi était d’essayer de saisir ce qui, aux différents niveaux de la
médiation mise en place (dans les œuvres elles-mêmes, la façon dont elles sont montrées, les
discours institutionnels autour des sorties ou encore les modalités pratiques de la mise en
présence), est susceptible de nourrir des représentations pouvant multiplier par la suite, chez
les acteurs, les postures de méfiance, rejet, évitement. Concrètement, cela revient à aborder la
réception comme « adresse » et les dispositifs de médiation eux-mêmes en tant qu’ils posent,
construisent ou figurent socialement ceux auxquels ils s’adressent justement (Servais, 2010 ;
2013). La façon dont on s’adresse à l’autre opère, en effet, d’emblée, une distribution des
places : elle constitue l’autre en destinataire lui indiquant un rôle à investir, une relation
possible aux institutions et au corps social.
La sortie retenue ici a consisté à se rendre au Musée du Quai Branly pour une visite –
autonome – de l’exposition permanente. En effet, la Mairie de Fleury se contente de mettre
des cars à la disposition du centre social, ce dernier considère à son tour qu’il n’a pas les
moyens de payer un conférencier. Sachant par ailleurs que des sommes équivalentes sont
parfois déboursées lors de sorties loisirs (en tours de manège par exemple), on peut se
demander si ce n’est pas la dépense proprement culturelle qui tend en l’occurrence à être
considérée comme du gaspillage. Ou encore si, pour ce groupe d’acteurs institutionnels en
contact avec les récipiendaires des politiques culturelles, il ne suffit pas finalement d’une mise
en présence physique de publics et d’œuvres pour que l’appropriation visée ait lieu.
« N’importe qui peut, avance en effet de son côté la Directrice municipale de la Culture, être
touché par un texte de Baudelaire, d’Aragon, de Boris Vian ». Ce propos mobilise l’idéologie
du don de nature ou du goût naturel critiquée par Pierre Bourdieu dans L’amour de l’art
(1969) ou encore La Distinction (1979) ; il insiste surtout – c’est ce qui nous intéresse en
priorité – sur une sorte d’inutilité ultime des actions de médiation.
La visite évoquée prend place, d’autre part, dans un contexte particulier, que Fatma,
hôtesse d’accueil du centre social en charge des sorties5, décrit comme « communautaire ».
« Nous, on va sortir, explique-t-elle, avec la communauté maghrébine ; moi, je suis
Algérienne, donc pour elles… elles savent ». D’un côté, la sortie féminine est présentée à la
chercheure comme n’allant pas, socialement parlant, de soi (« c’est mal vu, très mal vu ») ; de
l’autre, il existe, d’après l’enquêtée, un cadre pouvant requalifier cette pratique, la rendre
honorable, licite. La condition est ainsi que les femmes sortent avec leur « communauté » ou
une « communauté » réputée proche, cette proximité étant posée par mon interlocutrice en
référence à la religion (« la plupart des Africains, ils sont musulmans, donc on a à peu près les
mêmes… pas traditions, mais presque, quoi, les mêmes… pratiques »).6 Dans cette logique,
4 Mon positionnement sur le terrain a alors été celui d’un « membre périphérique », pour reprendre l’expression
de Patricia et Peter Adler (Rémy, 2009 : 36). L’ethnographe ne participe que de manière « périphérique » aux
activités observées. D’une part, il entretient une proximité avec les enquêtés ; d’autre part, il a le souci constant
de réintroduire de la distance en leur rappelant par exemple les raisons de sa présence avec eux. S’il suscite des
attitudes ambivalentes sur le terrain, ce positionnement est aussi celui qui est le plus facile à tenir au plan
éthique. Le chercheur peut, en effet, considérer que les discours qu’il recueille ont été produits par les acteurs en
parfaite connaissance de cause.
5 C’est pour remplacer, pendant son congé parental, la coordinatrice animation du centre social que Fatma
accepte, dans l’espoir d’une promotion, la responsabilité des sorties.
6 Lors de la sortie analysée, le groupe est composé d’une douzaine de femmes originaires du Maghreb et
d’Afrique sub-saharienne, avec leurs enfants (une quinzaine, de moins de 10 ans) ; un seul homme est présent.
S’y ajoutent trois personnes extérieures à la cité (une bénévole invitée par le directeur, une amie et le fils,
collégien, de cette dernière).

3
Fatma, elle, met en avant, au cours de nos entretiens, tout comme dans les relations qu’elle
tisse avec ces femmes et leurs familles, sa qualité de « membre ». Elle insiste sur son respect
des règles du groupe – ces règles « connues de personne, entendues de tous » (Sapir, 1970 :
46) –, les qualifiant de « taboues ». De manière plus générale – et alors même qu’elle est née
en France –, elle se positionne comme « Française de papiers » : étrangère au même titre que
le public qu’elle vise professionnellement.
1/ Une séance de disqualification collective
Nous arrivons au Musée du Quai Branly vers 10h30 et passons grosso modo l’heure
qui suit à attendre dans les couloirs, à proximité du guichet destiné à l’accueil des groupes,
l’autorisation d’accéder aux salles d’exposition. Un employé nous demande d’abord de nous
ranger « bien contre le mur » pour « ne pas déranger le public », et, après moult vérifications,
remet les billets à Fatma avec le commentaire suivant lancé à la cantonade : « Bon, allez !
Mais, franchement, vous les encadrez à fond, hein, parce que le samedi, on a beaucoup de
monde ! ». Cette phrase sera répétée quasiment à l’identique quelques heures plus tard
lorsque, après un pique-nique dans le jardin du musée, nous nous présentons devant l’hôtesse
chargée de vérifier les billets au début du parcours d’exposition. L’entrée dans le musée est
clairement définie dans cette séquence comme une faveur concédée à la responsable du
groupe. La phrase citée (« Bon, allez ! Mais, franchement... ») relève, de surcroît, de ce
qu’Eric Auziol appelle la « double communication » (Mucchielli & Paillé, 2003 : 160), en
écho à la « double contrainte » théorisée par l’Ecole de Palo Alto (Bateson, 1980 : 14). Le
message s’adresse aussi bien à Fatma qu’aux autres personnes présentes qui constituent, elles,
le « public » : le public légitime (construit comme tel).
Cela se passe un peu comme si le personnel du musée souhaitait désavouer
publiquement le groupe du centre social, faire valoir qu’il n’est pas à sa place dans ces murs,
mais simplement toléré. C’est aussi, pour les employés, une façon de s’associer
symboliquement au « public », nécessairement gêné par ces « autres » dont les
comportements ne manqueront pas de s’inscrire en rupture avec les normes pressenties. Une
façon, surtout, d’ancrer une certaine définition de la situation, par le biais notamment de la
répartition des rôles énonciatifs (« on », « vous », « eux »). A cet égard, on peut noter que les
personnes qu’accompagne Fatma sont décalées vers le « eux/ils », la troisième personne7,
l’Absent dans la grammaire arabe. Les employés du musée les évoquent, de fait, comme si
elles étaient très précisément absentes. Ils les excluent d’abord du « public » – le « bon »
public (Bertrand, 2003 : 144) –, puis, dans un deuxième temps, de la dynamique « je »/« tu »8.
D’une part, il est demandé au groupe de se coller littéralement aux murs pour « ne pas
déranger » le public, la place physique qu’on l’autorise à prendre matérialisant la place
symbolique à laquelle il est assigné.
D’autre part, ses membres sont construits dans la situation comme totalement
dépourvus du droit à la parole : du droit reconnu à intervenir dans les conversations, à occuper
la scène, y compris lorsque le dit les concerne directement. Ils peuvent bien sûr s’emparer de
la parole et se constituer en participants de plein droit, mais on est là dans le « mode mineur »
(Piette, 1998 : 276) – les marges, la déviance – de l’échange tel que les employés du musée
tentent de l’instaurer. Dans les métiers au contact du public, existe parfois l’habitude de
7 Comme le note Emile Benveniste, la troisième personne a la particularité de posséder « comme marque
l’absence de ce qui qualifie spécifiquement le « je » et le « tu ». Parce qu’elle n’implique aucune personne, elle
peut prendre n’importe quel sujet ou n’en comporter aucun, et ce sujet, exprimé ou non, n’est jamais posé
comme « personne » » (1966 : 231).
8 C’est l’usage de la deuxième personne qui constitue, en effet, l’autre en co-énonciateur : en sujet potentiel
(Benveniste, 1966 : 260).

4
dénigrer celui-ci en son absence, l’exemple classique étant celui du commerçant qui, dans
l’arrière-boutique, commente sur un ton humoristique les interactions qu’il vient d’avoir avec
les clients désagréables. Dans la situation analysée, la particularité est que ce « dénigrement
de l’absent » se produit en sa présence, ce qui confère à l’acte de dénigrer une dimension
performative forte. C’est en dénigrant, en effet, les personnes du centre social, en les
rabaissant devant des témoins constitués du même coup en participants « ratifiés » de
l’échange (Goffman, 1987 : 15), que le personnel du musée les rend absentes, les évacue de la
situation d’énonciation et de la tension « je »/« tu » (« on »/« vous » en l’occurrence).
2/ Un individu « discréditable » comme levier de la situation
Fatma entérine cette répartition des rôles ; les deux fois où la phrase lui est adressée,
elle s’empresse de répondre en baissant la tête : « Oui, oui, bien sûr, ne vous inquiétez
pas… ». L’acteur tente d’abréger un échange qui met à mal son identité sociale, son sens-
pour-autrui, en le montrant en situation de faiblesse. Nous sommes donc tout à fait dans le
registre de la figuration au sens d’Erving Goffman ; celle-ci recouvre « tout ce qu’entreprend
une personne pour que ses actions ne fassent perdre la face à personne (y compris elle-
même) », elle vise à « parer aux « incidents », c’est-à-dire aux événements dont les
implications symboliques sont […] un danger pour la face » (1974 : 15). Pour garder celle-ci,
Fatma adhère à la vision qui lui est opposée, et cette adhésion – à éclipses, sans doute9 –
prend place dans une situation profondément ambivalente. D’un côté, l’acteur est coincé,
acculé ; en réalité, il n’a pas le choix d’adhérer ou non, l’adhésion lui est imposée ou
extorquée. De l’autre, ses interlocuteurs lui ménagent symboliquement une porte de sortie : ils
dissocient dans leurs discours – on a vu – les positions « vous » et « eux » (« Mais,
franchement, vous les encadrez… »).
Ce n’est pas Fatma – suggère-t-on – qui fait l’objet de la cérémonie de disqualification
en cours. Elle n’est pas assimilée au groupe mis à l’index, mais assiste tout simplement à la
scène, au même titre que le « public », catégorie honorable par excellence. La situation peut
néanmoins basculer à tout moment : c’est bien ce que l’acteur doit garder à l’esprit. Il peut,
d’un instant à l’autre, subir une dégradation énonciative et statutaire : être désigné
publiquement comme un individu au statut suspect, stigmatisé comme étranger (autre) au
monde du musée dans lequel il aspire à entrer. Le basculement en question aura notamment
lieu si l’acteur s’avise de contester la définition de la situation et la distribution des places
posées par le groupe en face. La place indiquée à Fatma est ainsi celle d’un individu, non pas
« discrédité », mais « discréditable » (Goffman, 1975 : 123) : son « stigmate » sera tu, et le
sursis prolongé aussi longtemps que la personne s’en tiendra à ne pas remettre en cause
l’ordre établi et le point de vue dominant sur la situation. C’est à une place de dominée que
l’acteur est au fond renvoyé ; et s’il s’empresse de la remplir, c’est bien parce qu’il a
incorporé – on imagine –, au moins en partie, la relation de domination et sa propre infériorité
en tant qu’allant de soi.
Des scènes comme celle que je viens de décrire sont récurrentes dans les musées
visités par le groupe du centre social ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle Fatma évite au
maximum de se présenter seule à l’accueil. Pour chaque sortie, elle fait en sorte de se faire
accompagner par une personne extérieure à la structure (la chercheure, une bénévole), qu’elle
présente au groupe le matin comme « connaissant très bien le musée ». Avec cette personne
instituée guide, elle tente ensuite de négocier une relation lui permettant de déléguer au
possible le face-à-face avec le personnel du musée. Dans le bus, elle essaie par exemple de lui
remettre le dossier avec les justificatifs du centre en prétextant qu’elle n’a pas la place dans
9 On peut se demander s’il s’agit de cette « capacité « léthargique », comme dirait Paul Veyne, à adhérer, en-
deçà de la conscience, à plusieurs niveau de vérités » (Piette, 1996 : 171).

5
son sac ; une fois à destination, elle propose de prendre la queue du groupe pour « chercher »
l’entrée, puis de rester avec les « gens » dans le couloir pour les « rassurer » pendant que la
guide se charge, elle, d’aller récupérer les billets, voir si une activité a été réservée, etc.
L’objectif est, pour Fatma, de se soustraire à tout prix à des interactions qu’elle perçoit
comme particulièrement risquées pour son image, aussi bien sociale que professionnelle. Ces
interactions sont, en effet, susceptibles de rendre visibles – c’est très exactement ce qui se
produit dans le cas analysé – sa faible connaissance des lieux culturels, ainsi que son
incapacité à gérer l’autre (l’autre social déjà) et à éviter au groupe des rapports de force et des
situations de subordination ad hoc.
3/ Du malaise au sentiment de persécution et de harcèlement
Lors de chaque sortie, Fatma affirme ne plus se souvenir si elle a réservé une activité
pour la journée (« Ça fait longtemps que j’ai fait ça, moi… »). Lorsque je lui pose la question,
elle me donne la pochette avec les courriels échangés pour que j’y cherche moi-même la
réponse. Sa connaissance des équipements culturels est, en effet, si faible qu’elle ne sait tout
simplement pas ce que recouvrent les réservations qu’elle fait enregistrer. En même temps,
elle évite de poser des questions afin de réduire au maximum les contacts pouvant faire
ressortir son ignorance sur le sujet. Au Musée du Quai Branly, devant le mécontentement de
plus en plus manifeste du groupe, Fatma fait savoir autour d’elle, à voix basse, que sa
« demande » n’a pas été « prise en compte ». L’expression qu’elle utilise renvoie à un
fonctionnement administratif mystérieux et implacable, façon pour Fatma de calmer les
esprits et de clore la discussion sur un lieu commun, « une opinion entérinée, une image
partagée » par le groupe (Amossy & Herschberg-Pierrot, 2009 [1997] : 43). Le recours à ce
type d’argument lui permet, déjà, de réaffirmer son allégeance au groupe et d’insister sur sa
qualité de membre (ou d’en demander, au contraire, la reconnaissance publique). Au-delà,
l’acteur tente de pousser ses pairs à se constituer en « nous » face à un « ils » indéfini, hostile
et difficile à affronter sur son propre terrain.10
« Apparemment, ils n’ont pas pris en compte nos réservations, me glisse, avec un air
entendu, une femme dans la file ; Fatma leur a demandé, ils ont dit oui, mais ils n’ont pas pris
en compte ». Ainsi recadrée, la situation suscite un malaise au sein du groupe des « nous » ;
ses membres ont le sentiment d’être traités comme une quantité négligeable, de ne pas être
« pris en compte » eux-mêmes en tant que personnes. On remarque au passage l’utilisation
elliptique, autosuffisante de l’expression « prendre en compte ». Celle-ci traduit chez mon
interlocutrice une adhésion pure et simple à l’explication qui lui est proposée – on peut bien
sûr se demander si elle sait à quoi l’expression fait référence ou si elle se contente de donner
suite, tout simplement, à la demande de reconnaissance de Fatma. Quoi qu’il en soit, durant la
matinée, le malaise évoqué bascule progressivement vers un sentiment de persécution que la
responsable du groupe ratifie après-coup en présentant l’obtention des billets comme un
exploit ou, en tout cas, comme une issue totalement inespérée. « J’ai réussi à obtenir des
places ! », nous lance-t-elle sur un ton enjoué, en agitant la liasse que l’employée vient de lui
remettre. Sa phrase traduit sans doute une volonté de valoriser son travail ; elle traduit surtout
son sentiment et celui des usagers du centre social d’être illégitimes au sein du musée, ainsi
que leur méconnaissance de cette institution comme service public.
Le point d’orgue de la journée se déroule au cours du pique-nique dans le jardin de
l’établissement lorsque les femmes accusent les agents de sécurité de les surveiller, voire de
les espionner :
10 Cette polarisation du discours des classes populaires en « nous » et « ils » a été mise en évidence par Richard
Hoggart dans son livre sur le style de vie des classes populaires anglaises de la première moitié du XXème siècle
(1970 : 115-146).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%