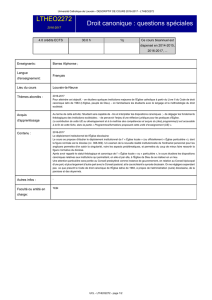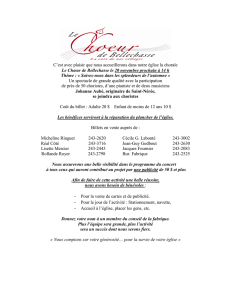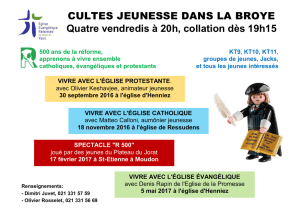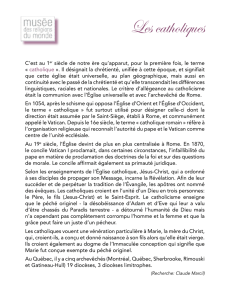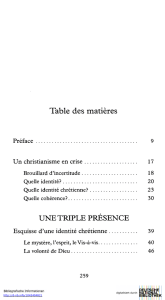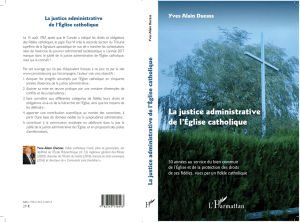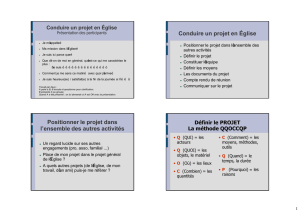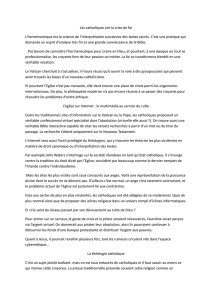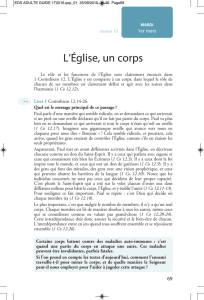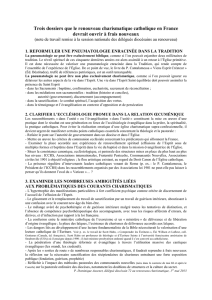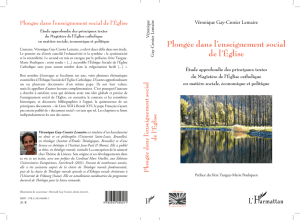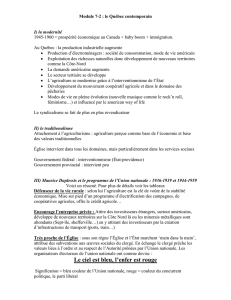TEOLOGIE L`ecclésiologie catholique et le droit canonique

Caietele Institutului Catolic I (2000) 12-30
TEOLOGIE
L'ecclésiologie catholique et le droit canonique
–Leçon académique à l’occasion du doctorat honoris causa
remis par l’Université de Bucarest –
Patrick Valdrini
Recteur de l’Institut Catholique de Paris
1. Introduction
L'organisation de l'Église, en droit canonique, est un ensemble de
règles dont le fondement et le contenu s'expliquent par l'ecclésiologie
qu'elles traduisent. Sans doute, cette proposition générale prend-elle un
sens très approprié lorsque l'on se prépare à présenter l'organisation de
l'Église Catholique et que l'on entre dans le corpus juridique que
constituent le code de droit canonique latin et le code des canons des
Églises orientales catholiques. Rappelons que le principe de
codification, c'est-à-dire le fait de rassembler l'ensemble du droit
canonique universel dans un code promulgué devenant source du droit
pour l'Église tout entière, a été adopté dans l'Église Catholique à la fin
du XIXe siècle. A ce moment-là on cherchait un moyen de rendre plus
accessible un droit dont les sources étaient dispersées dans trop de livres
et de textes. Le modèle que constituait le Code de Napoléon Premier fut
retenu. En 1917, on publia le premier code de droit canonique latin et
l'on mit en chantier une codification pour les Églises orientales
catholiques. Le code de 1917 fut utilisé pendant près de 70 ans et
remplacé en 1983 par un nouveau code promulgué cette année-là par le
Pape Jean-Paul II. Il devint donc la source principale du droit canonique
latin. Pour ce qui concerne les 21 Églises orientales catholiques, le
projet de codification prévu au début du siècle dernier n'aboutit jamais
totalement. Cependant, en 1990, on mit fin à d'importants travaux de

13 Patrick Valdrini
codification repris en 1972 dans l'intention de doter ces Églises d'un
corpus de canons aussi pratique que l'était le Code de droit canonique
latin. Ainsi, un Code des canons des Églises orientales catholiques fut
promulgué par le Pape Jean-Paul II le 18 octobre 1990. Comme nous le
disions, ces deux grands codes sont aujourd'hui utilisés comme sources
principales du droit, à côté d'autres textes ayant aussi une portée
universelle ou, en revanche, constituant l'ensemble du droit particulier
porté pour des communautés ayant un statut juridique propre à recevoir
des lois comme le sont, par exemple, les différents diocèses ou
éparchies. Ces codes ont repris l'ecclésiologie contenue dans les grands
textes du second Concile du Vatican (Concile Vatican II) qui s'est tenu
de 1962 à 1965. Notamment, ils s'inspirent de la Constitution
apostolique Lumen gentium (lumière des peuples) qui développe
solennellement l'ecclésiologie catholique. C'est à ce grand texte
conciliaire qu'il faut se référer si l'on veut comprendre, expliquer,
commenter et interpréter les codes. En effet, les règles juridiques, même
si elles ont le caractère obligatoire qu'on leur connaît, ne peuvent être
jugées comme si elles étaient à elles seules le tout de ce que l'Église
exprime sur elle-même. Elles doivent être placées dans un cadre plus
large. Celui-ci est de nature ecclésiologique. Certes, en droit canonique
catholique, nous tenons au maintien d'une nature propre et spécifique
des textes, de sorte qu'il n'y ait pas de confusion entre la présentation de
l'Église en termes ecclésiologiques et la description du statut des
institutions en termes juridiques. Mais ce maintien méthodologique
n'autorise pas à mettre une cloison étanche entre les deux disciplines,
l'ecclésiologie et le droit.
C'est cette relation entre ecclésiologie et droit qui a évolué dans les
années qui viennent de s'écouler. De ce point de vue, on reconnaît
facilement à présent que le Concile Vatican II a été le moment du
dépassement, voire d'une mise à l'écart d'une systématique canonique
touchant l'organisation de l'Église qui ne correspondait plus à
l'appréhension que cette dernière avait de son organisation. Le code de
1917 présentait l'organisation de l'Église Catholique selon une
systématique trop juridique. Aujourd'hui, celle-ci nous paraît ancienne et
marquée par l'histoire. En effet, le livre du code de 1917 consacré à
l'organisation de l'Église ressemble en beaucoup de points aux livres de
droit de l'époque moderne ou aux codes des sociétés séculières qui
présentent les institutions comme l'architecture des fonctions devant être

L’ecclésiologie catholique et le droit canonique 14
exercées pour qu'une société soit organisée. Mais peu de considérations
d'ordre théologique ou ecclésiologique ne sont mentionnées ou, même,
implicitement évoquées. Cette sécheresse a été dénoncée par certains
canonistes au milieu du XXe siècle, car elle avait peu de rapports, d'une
part, avec la manière dont, à l'époque, on parlait de l'être ecclésial,
d'autre part, avec l'expérience chrétienne que les fidèles avaient des
rapports entre les personnes à l'intérieur de l'Église. En tant que science
ecclésiastique séparée du droit canonique, l'ecclésiologie avait progressé
et c'est elle qui devait largement inspirer les textes du Concile Vatican
II. Mais, traitons une question préalable avant de dire en quoi les codes
actuels ont changé. Pourquoi le code de 1917 était-il aussi « juridique »
et laissait-il aussi peu de place aux éléments ecclésiologiques et
théologiques ? La réponse, rapide malheureusement, nous entraîne dans
l'histoire de l'Église Catholique, dans cette partie de l'Europe, à partir de
la fin du Moyen-Age. On reconnaît aujourd'hui que l'Église Catholique a
dû s'affronter à des systématiques de pensée, philosophiques, politiques
et religieuses, qui ont contesté ce qu'elle était et représentait dans la
société de l'époque. Une philosophie était, en germe, celle qui allait
conduire à l'affirmation d'une raison autonome donnant à l'individu des
responsabilités prométhéennes. La politique, notamment les traditions
gallicanes, préparait les systèmes juridiques actuels de séparation de
l'Église et de l'État et le rejet de l'activité de l'Église dans la sphère du
privé. Les nouvelles confessions issues de la Réforme s'organisaient
comme des sociétés séculières en écartant le caractère médiateur de
l'appartenance à une institution ecclésiale offrant des moyens d'obtenir
la grâce divine. L'Église Catholique s'est défendue. En conséquence,
aujourd'hui, il faut comprendre le caractère qui nous paraît trop juridique
de la présentation de l'organisation de l'Église comme le fruit d'un
déséquilibre dû à la volonté de protection des éléments propres d'une
ecclésiologie que des systèmes adversaires touchaient. Ainsi, le code de
1917 présente-t-il un corpus de règles où l'être profond de l'Église
n'apparaît pas dans sa richesse, comme le font les nouveaux textes
conciliaires et comme tentent de mieux le faire les deux codes
actuellement en vigueur. Mais, nous devons encore expliquer pourquoi
et comment s'est faite une évolution qui, à notre sens, a été déterminante
pour l'Église Catholique et qu'il est indispensable de connaître pour
juger la présentation actuelle de l'organisation de l'Église Catholique par
les deux codes.

15 Patrick Valdrini
2. Sacrements et statuts des personnes
Les combats menés par l'Église Catholique à partir du XVIe siècle
contre l'État moderne l'ont trop conduit à se présenter comme une
société structurée à l'image des sociétés séculières. Pour la définir, on a
eu recours pendant deux siècles à l'expression de «société juridiquement
parfaite». Cette expression appartenait au vocabulaire de philosophie
politique de l'histoire occidentale moderne, c'est-à-dire, surtout, à partir
du XVIIe siècle. Elle exprimait le fait qu'une société complète comme
l'État n'avait pas besoin d'une autre société pour exister. En d'autres
termes, cette expression était liée à l'idée de souveraineté de l'État.
Appliquée à l'organisation ecclésiastique, l'expression montrait que
l'Église avait une existence indépendante de l'État, en quelque sorte une
souveraineté dans l'ordre qui est le sien, nécessitant une liberté d'action
par rapport à l'État. L'Église avait sa propre organisation sans qu'elle ait
besoin de l'État pour s'organiser et décider ce qui est bon pour elle. Elle
montrait ainsi qu'elle agissait au titre d'une mission reçue de Dieu sur
laquelle l'État n'avait pas de pouvoir particulier. Mais l'on connaît ce
principe jamais démenti : lorsque l'on s'oppose à quelqu'un, le risque est
grand de ne mettre en valeur que des aspects nécessaires à la
controverse, laissant de côté d'autres aspects pourtant tout aussi
importants. C'est le cas de l'Église Catholique. Le cadre de discussion,
voire d'affrontement, entre Église et État était juridique. Dès lors,
l'ecclésiologie pendant trois siècles sera juridique. C'est cela qui
évoluera. L'aspect sociétaire et organisé, expliquant que l'Église se
présente avec une architecture hiérarchique d'institutions et de
personnes, devait être enraciné dans une ecclésiologie plus riche. Or
l'Église Catholique a connu un temps très précieux d'enrichissement de
son ecclésiologie. Ce fut la première moitié du XXe siècle, à la faveur
d'une évolution des rapports entre l'Église Catholique et les États
modernes et, parallèlement, d'une recrudescence chez les ecclésiologues
des études bibliques et patristiques accompagnant les premiers dialogues
œcuméniques. Les présentations de l'Église changèrent. Les dimensions
fondamentales, jamais oubliées, il est vrai, mais moins mises en valeur,
furent réétudiées. L'Église fut mieux présentée comme la société voulue
par Dieu pour être le ferment du salut des hommes. Le grand

L’ecclésiologie catholique et le droit canonique 16
ecclésiologue Yves Congar écrivit : «Au XIXe siècle encore, on a
beaucoup considéré le monde et l'Église comme domaine d'une autorité.
Le ressourcement biblique a davantage fait voir le monde comme sujet
d'une histoire dont le sens est relatif à son terme, c'est-à-dire à
l'eschatologie. Mais ceci n'a guère été acquis qu'après la seconde guerre
mondiale. L'Église ne se concevrait plus principalement comme pouvoir
rival de l'autre pouvoir, mais elle se verrait elle-même, elle verrait le
monde lui-même et son rapport à ce monde, en référence à
l'eschatologie»1. Cette évolution trouvera une signature solennelle dans
les textes du Concile Vatican II, ainsi ce texte qui sert de référence
essentielle au travail canonique : «Le Christ, unique médiateur, crée et
continuellement soutient sur la terre, comme un tout visible, son Église
sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité par laquelle il
répand, à l'intention de tous, la vérité et la grâce. Cette société organisée
hiérarchiquement d'une part et le Corps mystique d'autre part,
l'assemblée discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Église
terrestre et l'Église enrichie des biens célestes ne doivent pas être
considérées comme deux choses, elles constituent au contraire une seule
réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. C'est
pourquoi, en vertu d'une analogie qui n'est pas sans valeur, on la
compare au mystère du Verbe incarné » (Lumen gentium, 8).
Par conséquent, les statuts des institutions et des personnes à
l'intérieur de l'Église ne peuvent être fondés uniquement sur le besoin
d'organisation propre à toute société ou sur le besoin d'ordre que
réclame toute société qui cherche la meilleure organisation. Dans la
systématique qui préside à l'organisation de l'Église, des éléments
interviennent, éléments essentiels, dont l'origine sera la mise en œuvre
de ce que le Concile Vatican II appelle, décrivant l'Église, «la
communauté de foi, d'espérance et de charité». Dans cet ordre, les
statuts sont la traduction juridique de la mission confiée par Dieu pour
que se réalise la mission universelle de l'Église. Dès lors, les codes de
droit canonique, latin et oriental, sont construits sur la fondation de
ministères dont les pouvoirs viennent de Dieu. Trois sacrements sont
fondateurs de statuts fondamentaux : le baptême, la confirmation et
l'ordre. Par le baptême, on acquiert le statut de Christifideles, nom latin
1Y. CONGAR, L'Eglise. De Saint-Augustin à l'époque moderne. Paris, Cerf, dernière
édition, 1996, p. 462-463.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%