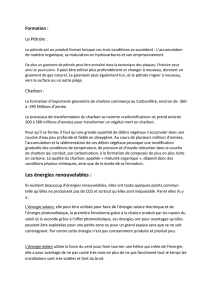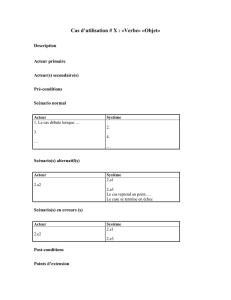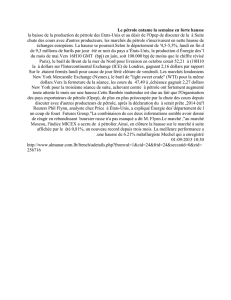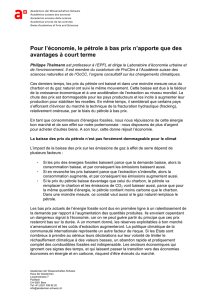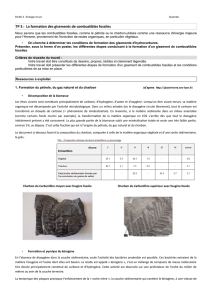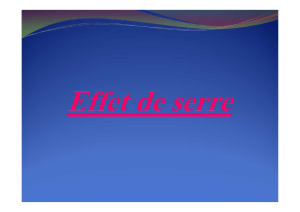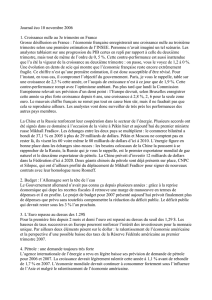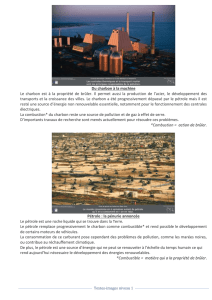World Energy Outlook

2
0
1
1
WORLD
ENERGY
OUTLOOK
RÉSUMÉ

2
0
1
1
WORLD
ENERGY
OUTLOOK
RÉSUMÉ
French translation

AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) est un organe autonome institué en novembre 1974.
Sa double mission est, depuis l’origine, d’une part de promouvoir auprès de ses pays membres une
politique de sécurisation des approvisionnements pétroliers reposant sur une réponse collective aux
perturbations et d’autre part, de produire des études et des analyses faisant autorité sur les solutions
permettant à ses vingt-huit États membres, et au-delà, de disposer d’une énergie fiable, abordable
et propre. L’AIE met en œuvre un programme très complet de coopération énergétique entre ses pays
membres, chacun d’eux étant dans l’obligation de détenir des réserves de pétrole équivalant à 90 jours de
ses importations nettes. L’Agence vise notamment les objectifs suivants :
n
garantir aux pays membres des approvisionnements sûrs et suffisants en énergie, notamment en
assurant des capacités de réponse urgente face aux perturbations des approvisionnements pétroliers ;
n
promouvoir des politiques énergétiques durables qui soutiennent la croissance économique et la
protection de l’environnement au niveau mondial, entre autres en termes de réduction des émissions
de gaz à effets de serre ;
n
améliorer la transparence des marchés internationaux en collectant et en analysant les données
énergétiques ;
n
faciliter la collaboration internationale dans le domaine de la technologie énergétique
en vue d’assurer les approvisionnements futurs en énergie tout en minimisant
leur impact sur l’environnement, grâce par exemple à une meilleure efficacité
énergétique et au développement et à la mise en œuvre des technologies
sobres en carbone ;
n
apporter des solutions aux défis énergétiques mondiaux grâce à
l’engagement et au dialogue avec les pays non membres,
l’industrie, les organisations internationales et les
autres parties prenantes.
Pays membres de l’AIE :
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Japon
Luxembourg
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République de Corée
République slovaque
République tchèque
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
La Commission européenne
participe également
aux travaux de l’AIE.
Veuillez noter que cette publication est
soumise à des restrictions particulières d’usage
et de diffusion. Les modalités correspondantes
peuvent être consultées en ligne à l’adresse
www.iea.org/about/copyright.asp
© OCDE/AIE, 2011
Agence Internationale de l’Énergie (AIE)
9 rue de la Fédération
75739 Paris Cedex 15, France
www.iea.org

3
Pays membres de l’AIE :
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Japon
Luxembourg
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République de Corée
République slovaque
République tchèque
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
La Commission européenne
participe également
aux travaux de l’AIE.
Résumé
RÉSUMÉ
« Si nous ne changeons pas de direction, nous arriverons là où
nous allons »
Peu de signes laissent à penser que le changement d’orientaon nécessaire des tendances
énergéques mondiales est amorcé. Bien que la reprise de l’économie mondiale depuis
2009 ait été inégale et que les perspecves économiques restent incertaines, le rebond
notable, de 5 %, de la demande mondiale d’énergie primaire en 2010 a porté les émissions
de CO2 à un nouveau pic. Les subvenons qui encouragent la surconsommaon de
combusbles fossiles ont dépassé les 400 milliards de dollars. Le nombre de personnes
n’ayant pas accès à l’électricité, 1,3 milliard, demeure intolérablement élevé et représente
quelque 20 % de la populaon mondiale. Malgré la priorité donnée dans de nombreux
pays à l’ecacité énergéque, l’intensité énergéque globale s’est détériorée pour la
deuxième année consécuve. Dans ce panorama guère promeeur, des événements
tels ceux survenus dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ou les troubles dans
certains pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord posent des quesons sur la sécurité
des approvisionnements énergéques. Cela alors que les problèmes des nances publiques
des États ont détourné l’aenon des gouvernements de la polique énergéque et limité
leurs moyens d’intervenon. Ce contexte semble peu propice à la réalisaon des objecfs
climaques convenus au niveau mondial.
Cee édion de l’Outlook évalue les menaces et les perspecves auxquelles le système
énergéque mondial fait face en s’appuyant sur une étude quantave rigoureuse des
tendances énergéques et climaques. Cee analyse inclut trois scénarios au niveau
mondial et de mulples études de cas. Le scénario central, « nouvelles poliques », table
sur une mise en œuvre prudente des engagements récemment pris par les gouvernements
même s’ils ne sont pas encore tous traduits par des mesures fermes. La comparaison avec
les résultats du Scénario « poliques actuelles », selon lequel aucune nouvelle mesure
ne vient s’ajouter à celles en vigueur au milieu de 2011, fait ressorr l’importance de ces
engagements et des plans qui s’y raachent. Par ailleurs, la comparaison avec les résultats
du Scénario 450 est aussi instrucve, car ce dernier part de l’objecf internaonal visant
à limiter à 2°C la hausse à long terme de la température moyenne mondiale par rapport
aux niveaux préindustriels an de tracer une trajectoire plausible vers sa réalisaon. Les
diérences importantes entre les résultats de ces trois scénarios meent en relief le rôle
décisif des gouvernements dans la dénion des objecfs et de la mise en œuvre des
poliques nécessaires pour déterminer notre avenir énergéque.
L’incertitude à court terme a peu d’effet sur la donne à plus long terme
Bien que les perspecves de croissance économique soient incertaines à court terme, dans
le Scénario « nouvelles poliques », la demande d’énergie s’accroît vigoureusement d’un
ers entre 2010 et 2035. Les hypothèses d’une augmentaon de la populaon mondiale de
1,7 milliard d’habitants et d’un taux de croissance annuel moyen du PIB mondial de 3,5 %

4
World Energy Outlook 2011
entraînent une demande de services énergéques et de mobilité toujours plus forte. Une
croissance de l’économie mondiale inférieure, à court terme, aux hypothèses de cet Outlook
n’inéchirait que marginalement les tendances à long terme.
La dynamique des marchés de l’énergie est de plus en plus déterminée par les pays hors
OCDE. Ces pays sont à l’origine de 90 % de la croissance démographique, de 70 % de la
croissance économique mondiale et de 90 % de la croissance de la demande d’énergie dans
la période comprise entre 2010 et 2035. En 2035, la Chine a conrmé sa posion de premier
consommateur mondial d’énergie qui représente près de 70 % de plus que les États-Unis,
devenus le deuxième consommateur mondial. Néanmoins, la consommaon énergéque
par habitant de la Chine reste inférieure de moié à celle des États-Unis à cee date. En
outre, les taux de croissance de la consommaon d’énergie en Inde, en Indonésie, au Brésil
et au Moyen-Orient surpassent ceux de la Chine.
L’invesssement nécessaire en infrastructures énergéques dans le monde pour la période
2011-2035 se chire à 38 000 milliards de dollars (en dollars de 2010). Près des deux ers
de l’invesssement total interviennent dans des pays hors OCDE. Les secteurs du pétrole et
du gaz combinés absorbent presque 20 000 milliards de dollars, reétant l’augmentaon à
moyen et à long terme à la fois des besoins d’invesssement en exploraon et producon
et des coûts associés. La majorité des invesssements restants sont desnés au secteur de
l’électricité, dont plus de 40 % vont aux réseaux de transport et de distribuon.
L’ère des combusbles fossiles est loin d’être révolue, mais leur prépondérance diminue.
La demande de tous les combusbles augmente, mais la part des combusbles fossiles dans
la consommaon mondiale d’énergie primaire faiblit légèrement, passant de 81 % en 2010
à 75 % en 2035. Le gaz naturel est la seule énergie fossile dont la part progresse dans le mix
énergéque mondial d’ici à 2035. Dans le secteur de l’électricité, les énergies renouvelables,
hydraulique et éolienne en tête, représentent la moié de la nouvelle puissance installée
pour faire face à l’augmentaon de la demande.
Des mesures vont dans la bonne direction, mais les chances
d’atteindre l’objectif de 2°C s’amenuisent à vue d’œil
Nous ne pouvons pas nous permere de remere à plus tard l’acon contre le changement
climaque si nous voulons aeindre à un coût raisonnable l’objecf à long terme d’une
limitaon à 2°C de l’augmentaon de la température moyenne mondiale : c’est ce que
montre le Scénario 450. Dans le Scénario « nouvelles poliques », le niveau des émissions
mondiales de CO
2
entraîne à long terme une hausse de la température moyenne de plus de
3,5°C. Si ces nouvelles poliques ne sont pas mises en œuvre, le monde s’oriente vers une
issue encore plus dangereuse, à savoir une augmentaon de la température de 6°C ou plus.
Les quatre cinquièmes des émissions totales de CO
2
liées à l’énergie admissibles d’ici
2035 dans le Scénario 450 proviennent des équipements existant aujourd’hui (centrales
électriques, bâments, usines, etc.). Faute d’entreprendre des acons radicales d’ici à
2017, les infrastructures énergéques déjà en place à cee date aeindront à elles seules
la limite d’émissions de CO2 permises jusqu’en 2035 dans le Scénario 450. La marge pour
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%