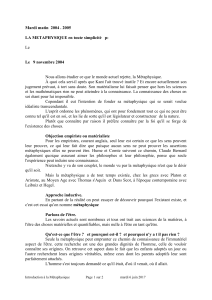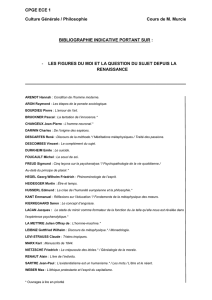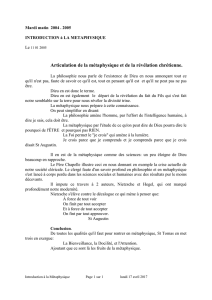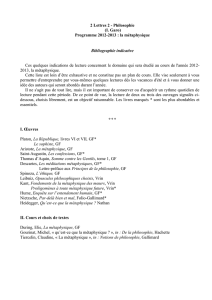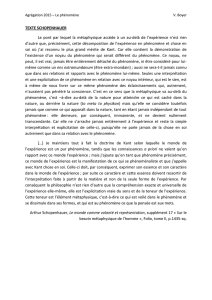H. et h. ou la métaphysique du boulanger

JEAN-PIERRE FAYE
CHIMERES
1
H. et h. ou la métaphysique
du boulanger
Jean-Pierre Faye est
écrivain.
1. Voir
« Computo, ergo
sum », p. 77.
JE VAIS VOUS RACONTER UNE HISTOIRE qui ressemble un peu
à celle d’Edgar Morin(1) sur les serpents à deux têtes que
l’on fabrique en Californie et qui ont, malheureusement, mal-
gré le privilège d’être bicéphales, des survies difficiles et
brèves puisqu’il arrive que les deux têtes se disputent l’ali-
mentation au point de les amener, l’une et l’autre, à mourir de
faim. Il y a un serpent à deux têtes qui est apparu dans le dis-
cours, d’une façon très « singulière », vers les années trente.
Je vais essayer de le décrire et vous d’ignorer, pendant
quelque temps, qui sont les personnages ainsi céphalisés au
bout d’un monstre commun. Nous le verrons, ils ont des noms
propres, et même des initiales propres…
Supposons qu’en 1933, deux amis aient combattu côte à côte
pour un certain Reich, le troisième dans la computation de
l’histoire. Vaillamment, ces deux amis avaient décrit le temps
nouveau comme celui du grand accomplissement. L’un
d’entre eux, celui qui porte la lettre “H” (et qui n’est pas tout
à fait celui auquel vous pensez, même si tous deux – le mien
et le vôtre – brandissent la hache), avait eu le privilège de dire
que le grand H. était vraiment « la réalité d’aujourd’hui et de
demain ». Il avait même souligné le mot « est », ist, pour mon-
trer que l’« être » lui-même était en cause. La « révolution »
de 1933, de son propre aveu une contre-révolution, n’était
ainsi rien d’autre que le « retour à l’essence de l’être », le
WiederLehren Wesen des Seins… Auguste langage, où sont
investis les grands concepts de l’histoire philosophique

JEAN-PIERRE FAYE
CHIMERES
2
occidentale, depuis les langues grecque et latine jusqu’à la
grande langue de l’idéalisme allemand.
Pendant toute l’année 1933, K. (nous allons voir que ce “K”,
dangereux, n’est pas le même que celui de Kafka) est au
coude à coude avec H., ou plutôt le petit H. Tous deux, K. et
petit H. admirent le grand H. Mais voilà qu’au tournant de
l’année 1934, quelque chose se passe de très désagréable pour
l’un d’entre eux. Les destins de K. et de petit H. se séparent
de façon discrète, presque mutique. K. se met à envoyer des
messages, des petits récits aux fonctionnaires du grand H.,
contre le petit H., en disant que cet homme-là n’est pas le
« philosophe compétent » de cette époque si glorieuse ; que,
contrairement aux apparences, il n’est qu’un dangereux-
déviationniste, un presque dissident ; que, loin d’avoir la qua-
lification qui lui est « attribuée couramment » de
« philosophe du national-socialisme », il est « tout autre
chose »…Ce « tout autre chose » va soudain apparaître et ce
sera un moment singulier du discours sur lequel j’aimerais
insister. Parce que c’est précisément ça qui échappe à la phi-
losophie courante, scolaire, magistrale : cette singularité, ce
grain de singularisation dans la grande langue du discours
philosophique.
Au printemps de l’année 1934, monsieur K., en train de mon-
ter en grade et de devenir bientôt l’équivalent d’un lieutenant-
colonel affecté de deux “S” (Obersturmbanführer
lieutenant-colonel SS), va dénoncer monsieur petit H., le phi-
losophe qui n’est pas « compétent ». Il dit de celui-là : loin
d’être compétent en matière de national-socialisme, monsieur
petit H. est « tout autre chose »… C’est textuellement écrit :
« un nihilisme métaphysique, c’est-à-dire ce qui couramment
est représenté par des littérateurs juifs ». Et voici petit H.
devenu « littérateur juif », accusation extrêmement dange-
reuse à l’époque, et cela en tant que « nihiliste métaphy-
sique ». La dénonciation est publique ; monsieur petit H.
commence à trembler.
Une peur philosophique entre dans la langue philosophique.
De cette peur nous ne sommes pas sortis… Elle est mainte-
nant installée, pour ainsi dire, dans la « grande langue

H. et h. ou la métaphysique du boulanger
CHIMERES
3
philosophique » qui s’enseigne et, en particulier, dans la
langue française. La langue française s’attache consciencieu-
sement à diffuser ce message (si possible outre-Atlantique),
devenu maintenant un patrimoine commun de notre espèce
idéologique.
Car, dès l’année 1935, voilà que petit H., ex-recteur de l’uni-
versité de Fribourg (il a démissionné juste à ce moment-là),
va répéter que la métaphysique n’est pas autre chose qu’un
nihilisme qui oriente la chute de toute chose ; que l’histoire
humaine n’est depuis le commencement que cette chute, sur-
tout dans ce qui démarre avec la pensée athénienne et qui a
été nommé « philosophie » à l’époque des Athéniens du Ve
siècle.
Si le mot « métaphysique » est devenu un mot de manuel sco-
laire, de trait d’enseignement, on pourrait donc suivre son tra-
jet, qui est, d’ailleurs, très beau. C’est un mot de code pour
désigner quelques livres d’un Athénien d’origine macédo-
nienne, Aristote. Ces livres, tout de suite oubliés par les
Athéniens, complètement méconnus par les Romains, n’ont
commencé à être sérieusement lus que par les
Mésopotamiens, les Gréco-Syriaques de la vallée de
l’Euphrate et finalement par le monde des Arabes du Xesiècle
abbasside ; c’est là que commence à se faire le grand travail
sur une question que, par hasard, on appellera « métaphy-
sique » et qui est de savoir comment rendre cohérente la
langue : comment peut-elle être capable de tenir des proposi-
tions singulières ou générales sur le réel ou sur son propre
discours ?
Le mot « métaphysique » entre ainsi dans les langues de
l’Occident par ce long détour de l’Asie centrale, par Boukhara
et, finalement, Cordoue et Marrakech. C’est de Marrakech
que nous recevons ce mot « métaphysique », transcrit de
l’arabe en latin par Michael Scott, celui qui a traduit le
Subjectum movens, montrant que tout à coup, venant de la
langue arabe, le « sujet » fait son entrée dans l’Occident latin.
Une entrée très curieuse : c’est un « sujet mouvant », un sujet
un peu guattarien, qui arrive sur la place aux XIIe/XIIIesiècles,
bien avant son heure… parce que, ensuite, ce n’est pas ainsi
qu’on l’a enseigné dans les petites écoles qui furent les nôtres.

JEAN-PIERRE FAYE
CHIMERES
4
Mais voici monsieur petit H. qui continue, après la guerre, ce
discours. Simplement, il expliquera que ce qu’il appelait
« nihilisme », ce n’est plus du tout la même chose… En 1935,
« nihilisme », c’était les « littérateurs juifs » (dont il ne vou-
lait pas être). Dix ans après, ce même mot désigne ceux-là qui
viennent de s’en aller, ceux qui ont perdu la guerre : mainte-
nant, ensevelis sous un champ en ruines ou dans des camps
de dénazification, ceux-là, il ne les connaît plus… Le nihi-
lisme, c’était le fascisme… Par conséquent, monsieur petit H.
faisait, lui, bataille pour la bonne cause. Voilà comment
Martin H., après la guerre, a repris du service et est venu
apporter des aliments, en particulier à la culture française.
Le mot « déconstruction », Abbau, qui commence à apparaître
à ce moment-là dans le langage de petit H., est justement
l’opposé symétrique de ce qui a été la grande idée des années
trente, la mobilisation totale, la Totalmobilmachung d’Ernst
Jünger. Nous en reparlerons, mais à l’envers : nous la pré-
senterons comme une « déconstruction », comme une Abbau,
terme qui apparaît dans l’hommage à Jünger de Martin
Heidegger, en 1955, quand l’un et l’autre se donnent des
cadeaux d’anniversaire chaque fois qu’ils atteignent soixante
ou soixante-dix ans…
Nous avons là une grandiose singularité. Une sorte de bosse
surgie dans la langue, née de la peur. Un grand kyste de peur
installé dans notre langue et qui nous explique que nous
sommes à tout moment dans une longue et interminable
chute… Et tout ce qui pouvait être une tentative pour donner
un peu de luminosité et de cohérence au langage, les lampes
de bifurcation, nous allons les enfermer dans un placard, sorte
de corps noir où toutes les vaches, tous les chats sont gris.
Je quitte cet événement de singularisation pour en trouver
d’autres, un peu plus éclairants, ou un peu moins désastreux.
Dans la philosophie ou la langue, il y a eu d’autres moments
de singularisation et c’est par eux que nous devons passer
pour penser la langue de la pensée. Il y en a un qui est fort
étonnant, très oublié aussi. C’est celui qui a concerné un autre
Athénien, lequel avait tenté des expériences politiques en
Sicile, mais qui a eu le malheur, en rentrant chez lui, de se
faire vendre comme esclave. Imaginez un philosophe apa-
tride, de « très bonne famille », tout à coup vendu comme un

H. et h. ou la métaphysique du boulanger
CHIMERES
5
objet sur un marché, mais fort heureusement racheté par un
ami qui passait par là au bon moment : Aniceris, venu
d’Afrique par les mers athéniennes, rachète donc son ami
Platon et le ramène dans le bon chemin. Platon, du coup, un
peu désabusé de l’expérimentation politique, commence par
acheter un jardin et à s’y livrer à un certain nombre de dis-
cussions. Dans ce jardin, quelque chose que l’on pourrait
appeler une scénographie curieuse, très belle, se met à exis-
ter. De cette cartographie-là procède ce qui se tente depuis, et
le Protagoras de ce Platon sera une protocartographie du mot
« philosophia ». C’est là, dans ses écrits post-esclavage, que
la philosophie commence. Point de singularité particulière-
ment intéressant.
Je voudrais remonter plus haut, là où deux fleuves d’Asie se
touchent, un peu comme un violon se resserre, là où, dans le
resserrement de ces deux vallées fluviales, quelque chose
s’est passé, deux langues se sont touchées. L’une est celle de
Sumer, l’autre celle d’Akkad ; les uns savent écrire déjà, les
autres ne font que parler. Mais ceux qui n’ont que la parole
et le son ont gagné la bataille, ils sont les conquérants : le roi
Sargon l’Ancien possède le pouvoir politique, et les scribes
sumériens prennent l’habitude peu à peu de noter autre-
ment… Non plus le dessin du sens, mais le son des mots du
conquérant.
Pour dire un épi de blé, vous l’appelez « shé » et vous dessi-
nez un petit épi. C’est du proto-sumérien. Maintenant, un
oiseau : en sumérien primitif, c’est très joli à faire, avec un
peu de queue et un peu de bec. Mais là aussi, ça se schéma-
tise et l’on fait quatre clous – toujours les clous du cunéi-
forme –, on leur donne une sorte de bec, et ça s’appelle «hu»
en sumérien ; donc, vous avez d’un côté le grain de blé, et de
l’autre l’oiseau.
Supposez que vous soyez un scribe sumérien, vous entendez
les Akkadiens qui parlent, les guerriers, les militaires qui
commandent. Il vous faut écrire quelque chose et vous ne
savez pas comment le faire puisque les Akkadiens n’écrivent
pas. Vous finissez par comprendre que, quand ils disent
« shé-hu », ça veut dire tout à fait autre chose, ça veut dire la
« vision ». En sumérien, on va écrire comme ça : on va mettre
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%