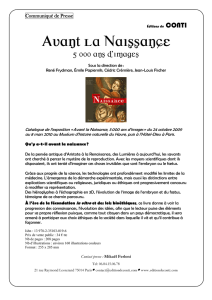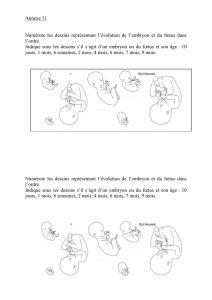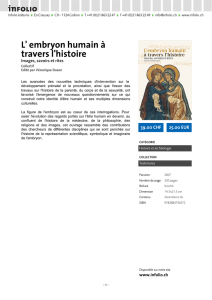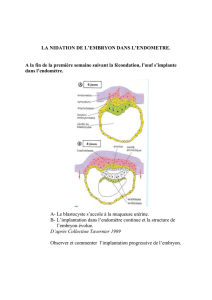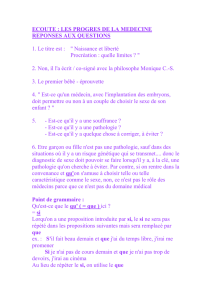Lire l`article complet

5
La Lettre du Gynécologue - n° 298-299 - janvier-février 2005
rance Queré, aujourd’hui disparue, donnait lors de la
première journée “Éthique, religion, droit et procréa-
tion”, en 1995, sa définition de l’éthique : “Ce que je
fais, c’est à quelqu’un d’autre que moi que je le fais. La moralité
se définit par la responsabilité, toujours sur le qui-vive, d’une
infraction possible au souci d’autrui.”
Le même souci d’altérité occupe l’esprit des différents interve-
nants de la dixième journée de cette manifestation, en 2004, dans
l’analyse des relations entre l’embryon, le fœtus, la mère, le
médecin et les différents domaines de la procréation permettant à
Claude Sureau de comparer, dans sa synthèse de la journée,
“Éthique de responsabilité” faisant reposer les décisions médi-
cales sur l’analyse des situations (en particulier le projet parental)
à une “morale de conviction” où seul le respect d’une croyance ou
d’un dogme est pris en compte.
LA MORALE DE CONVICTION
Cette expression préférée à celle d’“éthique de conviction”, pro-
posée par Max Weber au début du XIXesiècle (1), renvoie à deux
courants de pensée opposés : l’un religieux ou spiritualiste et
l’autre plus volontiers matérialiste.
Le courant religieux
La genèse des grandes religions remonte à une époque où les
mécanismes de la procréation n’étaient pas encore élucidés, aussi
importe-t-il plus de situer la conception, la grossesse et la nais-
sance par rapport à certains thèmes fondateurs des différentes
croyances plutôt que d’essayer de savoir ce que pensaient Jésus,
Bouddha ou Mahomet de l’embryon et du fœtus.
Le thème central et récurrent de toutes les grandes religions reste le
respect de l’individu, de l’être humain dès sa conception. Cette notion
passe par le concept de l’animation qui, selon les religions, peut être
contemporaine de la fécondation ou postérieure à la fécondation. Ces
incertitudes philosophiques, dont les premières remontent à l’époque
d’Aristote (2), furent au centre de discussions passionnées alors que
les mécanismes mêmes de la procréation étaient encore pour une
grande part ignorés. Les découvertes récentes et les progrès des tech-
niques, notamment dans le cadre de la fécondation in vitro, n’ont pas
apporté des réponses précises à ces interrogations métaphysiques mais
ont conduit les uns et les autres à envisager différemment les principes
doctrinaux en espérant d’autres réponses aux questions qui se posaient
et se posent toujours.
Sans négliger la vision de certains courants religieux comme le
taoïsme pour qui la conception est la rencontre du sperme et des sécré-
tions vaginales engendrant un enfant masculin ou féminin (union du
yin et du yang) ou le bouddhisme et l’hindouisme pour qui l’embryo-
genèse de l’individu est reliée à celle de la planète (3), ce sont les posi-
tions des grands courants monothéistes que nous allons envisager.
Les traditions religieuses plongeant leurs racines dans une histoire
ancienne, antérieure à toutes les connaissances scientifiques actuelles,
les réponses apportées ne peuvent être que des réponses indirectes ou
des analyses “au cas par cas”.
Ce n’est qu’au début du XVIIesiècle que la théorie de l’animation
immédiate de l’embryon commence à se développer dans la doc-
trine catholique et que des positions doctrinales concernant l’avorte-
ment apparaissent. Auparavant, saint Thomas considérait que
l’avortement était un acte grave en soi puisqu’il s’opposait à l’incli-
nation des êtres vivants vers la vie, mais qu’il ne s’agissait d’un
homicide que si le fœtus avait vraiment pris forme humaine. Il se
rapprochait ici de la conception d’Aristote pour estimer que l’ani-
mation survient au quarantième jour pour le fœtus mâle et au
quatre-vingtième pour le fœtus femelle. De ce fait sa position était
plutôt clémente pour ce qui est des avortements commis en deçà de
ces limites. Les écrits de Thomas Fienus au début du XVIIesiècle
(4) rendirent le jugement moral sur l’avortement beaucoup plus
sévère, quel que soit le terme de la grossesse. La doctrine catholique
ne définit pas l’embryon comme une personne mais elle affirme que
celui-ci “doit être entouré de la dignité et du respect qui conviennent
à une personne” (5). Il doit être respecté et traité comme une per-
sonne dès sa conception, dès ce moment donc, il convient de lui
reconnaître les droits de la personne et en tout premier lieu, le droit
inviolable et inaliénable de tout être innocent à la vie.
Comment interpréter le respect absolu dû à l’être humain dès sa
conception ? Quand situer la conception, origine du respect qui lui est
dû ? La connaissance scientifique nous montre qu’il n’y a pas fécon-
dation à un instant “t”, mais qu’un certain laps de temps s’écoule entre
le moment où la rencontre de deux gamètes “crée” une cellule et celui
où apparaît une entité humaine. Par ailleurs, la fécondation n’aboutit
pas immédiatement à la singularité de l’entité humaine. Ainsi, il peut y
avoir dédoublement (les jumeaux), arrêt de l’évolution (absence de
nidation, arrêt de la division cellulaire). S’il y a eu animation dès la
première cellule, l’âme se divise-t-elle pour se “partager” entre les
jumeaux ?… Que devient-elle lorsque la grossesse ne se poursuit pas,
dans le cas des œufs clairs, lors des grossesses extra-utérines ?… La
définition du statut ontologique de l’embryon demeure une question
ouverte et son argumentation un point de passage obligé de la
réflexion éthique.
Que dire du statut de l’embryon dans la tradition juive ? Il y a l’école
dite “de la mansuétude” où l’embryon, dans le ventre de sa mère, n’est
pas considéré comme l’égal de celle-ci. S’il y a avortement, le respon-
sable du dommage ne sera pas vu comme un criminel et “il paiera le
prix que lui demandera le mari, mais s’il lui arrive malheur (à sa
femme), ce sera âme pour âme, vie pour vie.” À l’opposé, l’école dite
“de l’intransigeance” qui s’appuie sur la traduction grecque de la
Septante, estime qu’il y a meurtre dès l’instant où l’embryon est confi-
guré ou plus précisément, comme l’expliquait Aristote, lorsqu’il a
acquis “la capacité de se mouvoir dans le ventre de sa mère”. De cette
GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
Le statut de l’embryon et du fœtus*
● I. Léguillette**, A. Proust**
*Texte rédigé à partir des interventions lors de la dixième journée “Éthique,
religion, droit et procréation” qui s’est déroulée le mardi 9 mars 2004 au
Palais des Congrès de Paris.
** Hôpital privé d’Antony, département de gynécologie-obstétrique, maternité
des Vallées, 1, rue Velpeau, 92160 Antony.
F

6
La Lettre du Gynécologue - n° 298-299 - janvier-février 2005
analyse découle la position d’une certaine tradition juive qui désigne
l’avortement comme un meurtre à part entière.
Toutefois, pour la majorité des commentateurs et décisionnaires de la
tradition juive, l’embryon fait partie intégrante de la mère. C’est une
vie en puissance alors que la mère est une vie en acte. La vie de la
mère prime sur celle de l’enfant non parce qu’elle est supérieure mais
parce qu’elle occupe, dans le monde, une position radicalement diffé-
rente. L’embryon comme le fœtus n’est pas encore de ce monde, la
mère, elle, est déjà de ce monde. Et lorsqu’il faut trancher, seul l’inté-
rêt de l’individu advenu à l’existence et qui porte l’individu en puis-
sance est invoqué, c’est celui-là qui prime. C’est la prévalence de la
vie existante par rapport à la vie potentielle.
Le courant matérialiste
Au sein même des courants se définissant par rapport à une “morale
de conviction”, l’influence du courant de la philosophie matérialiste
peut aboutir à des positions extrêmes comme celle suggérée par
Watson, pourtant prix Nobel en 1962 avec Crick et Wilkins pour
leur découverte de la structure de l’ADN : “Un enfant né ne doit être
admis à la vie, à la perpétuation de la vie que s’il est confirmé qu’il est
tout à fait normal.” Position qui, si elle est poussée à son extrême,
aboutit à des impasses allant jusqu’au rejet des individus qui ne corres-
pondraient plus aux normes établies (vieillards, inconscients,
débiles…), ne serait-ce pas là, à nouveau, une dérive eugénique que
nous connaissons et redoutons tous ?…
L’ÉTHIQUE DE RESPONSABILITÉ
C’est assurément celle la plus proche de la responsabilité médicale
actuelle (6), elle a pour rôle la protection de la vie et de la santé de la
mère que ce soit dans le cadre de la grossesse extra utérine, de l’inter-
ruption volontaire de grossesse ou de la contraception. C’est elle aussi
qui préside ou devrait présider aux réflexions, aux décisions et aux
actes qui animent les acteurs de la procréation médicalement assistée,
de la recherche ou encore dans le domaine du diagnostic anténatal.
Les interrogations actuelles viennent d’une situation paradoxale
comme le soulignait Jean Hamburger (cité par Claude Sureau dans
sa synthèse de la journée) : “Les données scientifiques contemporaines
se révèlent impropres à obéir à une morale qui est née sans les
connaître.” De la même façon, la législation reste en deçà des avan-
cées scientifiques et le “vide juridique” que nous connaissons en
regard du statut de l’embryon et du fœtus autorise de nombreuses dis-
cussions. À défaut de statut, le législateur a donné plusieurs définitions
qui permettent, dans le cadre de la pratique médicale, d’avoir des
points de repères :
•La personnalité juridique se définit comme l’aptitude à être titu-
laire de droits et à les exercer par soi-même ou par l’intermédiaire
d’un représentant. Tout être humain a donc une personnalité juridique
de sa naissance à son décès. Cette convention amène à définir juridi-
quement la naissance comme la venue au monde d’un être humain,
quelle que soit la durée de sa gestation définie par les critères de
l’OMS (22 semaines ou 500 g) à condition qu’il soit vivant et viable.
Le corps médical reste libre de l’appréciation des éléments nécessaires
à la personnalité juridique (terme, poids, cri à la naissance…).
•Le fait que la personnalité juridique ne commence qu’à la naissance
ne signifie pas pour autant que l’embryon ou le fœtus ne soit ni vivant
ni humain, mais renvoie à la définition de la “personne potentielle”.
Le droit prend en compte le fait que l’embryon puis le fœtus a pour
vocation première de donner naissance à une personne. Les disposi-
tions prises pour protéger l’embryon et le fœtus ont pour but de proté-
ger cette personne “en devenir”, cette “potentialité de personne”.
•À ce titre et au nom du respect de la dignité de la personne humaine,
les recherches sur l’embryon restent interdites dans le cadre général
de la loi et seules sont autorisées les études à caractères exceptionnels
qui ne portent pas atteintes à son développement futur puisque doit
être conservée sa vocation à être transféré en vue d’une grossesse (7).
•S’il est une potentialité de personne, le fœtus n’a pas pour autant des
droits à naître. Ainsi dans certaines situations comme les interruptions
de grossesses, qu’elles soient volontaires ou médicales, c’est avant tout
la liberté de la femme dans le premier cas et sa santé morale ou phy-
sique dans le second cas qui sont évaluées. En revanche, lorsqu’inter-
viennent des critères évaluant la qualité de vie de l’enfant à naître, la loi
a opté pour un parti éthique quelquefois contesté. Dans tous les cas, la
loi a essayé de réaliser un compromis entre la protection de l’embryon
ou du fœtus et d’autres intérêts comme la liberté et la santé de la
femme, la recherche et la qualité de vie de l’enfant à naître.
L’absence de statut juridique de l’embryon et du fœtus est criante dans
le domaine de la responsabilité médicale tant civile que pénale et donne
lieu à toutes les interprétations dont certaines jurisprudences récentes ont
été la traduction. Ces décisions rapidement contestées par le Conseil
d’État ou la Cour de cassation permettent de dire qu’actuellement :
•Sur le plan de la responsabilité civile, l’enfant à naître ne peut être le
destinataire d’une indemnité pécuniaire : s’il ne naît pas, ses parents
pourront réclamer une indemnité si la responsabilité médicale est
patente ; s’il naît, il pourra dans les mêmes conditions, être titulaire
d’un droit à indemnisation.
•Sur le plan de la responsabilité pénale, seules les blessures involontaires
sur la femme enceinte sont une incrimination recevable. Le droit pénal
protège les individus vivants en société, c’est le cas de la femme mais pas
encore celui du fœtus. En revanche, si un fœtus dont la mère a été victime
d’un accident, naît vivant puis décède, alors le responsable pourra être
poursuivi pour homicide involontaire sur la personne du bébé.
Le rôle du droit est de protéger les êtres humains accomplis et en
devenir. Il est aussi de concilier les intérêts particuliers des différents
acteurs de la vie sociale sans porter atteinte à l’intérêt général. À ce
titre, il semble essentiel de protéger le fragile équilibre qui existe entre
la protection de l’embryon et du fœtus, l’intérêt des mères, la
recherche médicale et la responsabilité médicale.
Devant les positions exposées tout au long de cette journée, il est clai-
rement apparu que si la diversité se devait d’être respectée, l’intérêt de
chacun également, et qu’il était de la responsabilité de tous les acteurs
autour de la procréation de garder à l’esprit que légiférer sur le permis
et l’interdit est la base même de l’évolution de notre discipline. Ainsi
“entre le bien à faire et le devoir à accomplir, la conscience morale ne
peut trouver le repos” (8).■
NOTE
1. Il existe alors deux écoles de philosophie morale : l’une absolutiste (relevant
de l’impératif catégorique de Kant) qui considère que les impératifs moraux
sont absolus et inconditionnels ; l’autre conséquencialiste qui considère, elle,
qu’entre deux maux résultant de deux décisions alternatives, il faut choisir la
moindre (futur courant pragmatique et utilitariste).
2. Premier à avoir envisagé le concept d’“animation”.
3. À l’origine, pour ces religions, il y avait un œuf cosmique dont la moitié supérieure
correspond à des étages célestes et la moitié inférieure à des régions souterraines.
4. www.eleves.ens.fr/home/nray/Rapports/ DEA/Cours/Sciences/reproduction-dvt.doc.
5. Donum Vitae, I-1, Cerf, 1987:17.
6. On peut la dire pragmatique ou conséquencialiste (voir note 2).
7. La loi du 8 juillet 2004 rappelle que “la recherche sur l'embryon humain est inter-
dite” mais l'autorise “à titre exceptionnel”, pour une durée de 5 ans, sur des
embryons surnuméraires sans projet parental. L’embryon et la recherche sur
l’embryon, www.genethique.org/doss_theme/dossiers/embryon/acc_embryon.htm.
8. Suzanne Rameix, Fondements philosophiques de l’Ethique médicale, Ellipes, 1996.
GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
1
/
2
100%