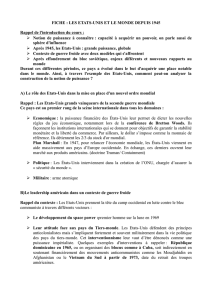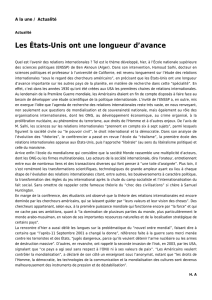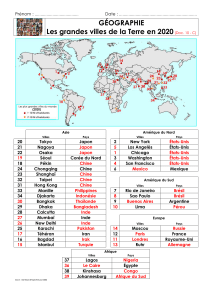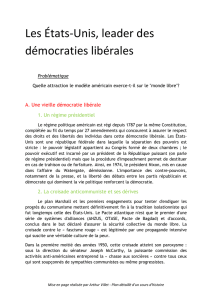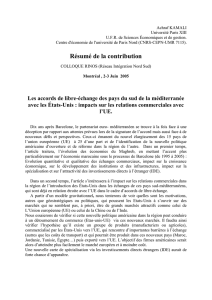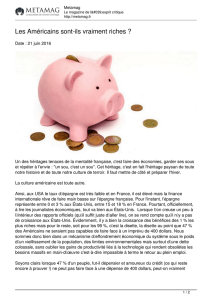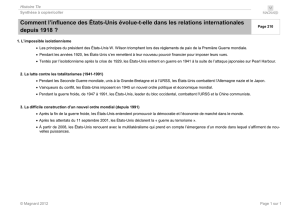Le Debat 129 - Eden Livres

Marcel Gauchet : Le problème européen
Ulrich Beck : Comprendre l’Europe telle qu’elle est
Maxime Lefebvre : L’Europe politique est-elle encore possible ?
Krzysztof Pomian : Pour un musée de l’Europe
Convergences et divergences atlantiques
Ran Halévi, Jed Rubenfeld
numéro 129 mars-avril 2004
Lionel Jospin : La relation franco-américaine
Emmanuel Devaud : La France qui va
André Ropert : Réflexions sur la conjoncture politique française
Philippe d’Iribarne : Intégration des immigrés : singularités françaises
Agnès Echène : Haine de la vieillesse
Les responsabilités de la science
Dominique Bourg et Kerry H. Whiteside, Jean-Pierre Dupuy, Étienne Klein
Extrait de la publication

mars-avril 2004 numéro 129
Directeur: Pierre Nora
CONVERGENCES ET DIVERGENCES ATLANTIQUES
4Lionel Jospin: La relation franco-américaine.
17 Jed Rubenfeld: Deux visions de l’ordre mondial.
27
Ran Halévi: France-Amérique. La scène primitive d’une mésintelligence pacifique.
EUROPE
50 Marcel Gauchet: Le problème européen.
67 Ulrich Beck: Comprendre l’Europe telle qu’elle est.
76 Maxime Lefebvre: L’Europe politique est-elle encore possible ?
89
Krzysztof Pomian: Pour un musée de l’Europe. Visite commentée d’une exposition
en projet.
FRANCE
102 Emmanuel Devaud: La France qui va.
111 André Ropert: Réflexions sur la conjoncture politique française.
123 Philippe d’Iribarne: Du rapport à l’autre. Les singularités françaises dans l’inté-
gration des immigrés.
136 Agnès Echène: Haine de la vieillesse.
LES RESPONSABILITÉS DE LA SCIENCE
144 Étienne Klein: La science en question.
153 Dominique Bourg, Kerry H. Whiteside: Précaution: un principe problématique
mais nécessaire.
175 Jean-Pierre Dupuy: Le problème théologico-scientifique et la responsabilité de la
science.
Sommaire.qxd 19/01/2005 16:06 Page 1
Extrait de la publication

Convergences
et divergences
atlantiques
Nous poursuivons, avec les trois articles
réunis ici, l’exploration de ce qui constitue
l’axe déterminant de notre présent: les rap-
ports transatlantiques. Le 11 Septembre a
fonctionné comme un révélateur: il a fait
apparaître une dérive des continents dont la
nature et les conséquences ne sauraient être
scrutées de trop près. Nous continuerons.
Lionel Jospin expose la vision de la rela-
tion franco-américaine que lui suggèrent à la
fois l’histoire, son expérience politique et les
développements de la récente crise irakienne.
Jed Rubenfeld propose une interprétation
originale de la différence des conceptions du
droit international qui se sont affirmées de
part et d’autre de l’Atlantique depuis 1945.
Elles s’enracinent, montre-t-il, dans des lec-
tures opposées de la même expérience du
conflit mondial, en ce qui concerne les liens
entre droit et démocratie.
Ran Halévi, enfin, remonte aux sources
de l’incompréhension amicale qui prévaut si
souvent entre la France et les États-Unis. Elle
est d’origine, fait-il ressortir; elle est donnée
dès la Révolution française. La scène primi-
tive recèle le secret de la suite.
Chap. 1.qxd 19/01/2005 15:52 Page 3
Extrait de la publication

Lionel Jospin
LA RELATION
FRANCO-AMÉRICAINE
J’ai choisi de vous parler de la relation entre la France et
les États-Unis : puisqu’elle traverse un moment difficile, il
faut rechercher les occasions de s’expliquer.
Il est vrai qu’il n’est pas toujours aisé d’aborder de façon
équilibrée et raisonnable la relation entre les États-Unis et la
France. On l’idéalise au passé et on la noircit au présent.
D’un côté, invoquant les figures illustres de Benjamin
Franklin, de Thomas Jefferson, de Beaumarchais ou de La
Fayette, on transforme en idylle le processus politique et
diplomatique en réalité très complexe qui a conduit la France
à vos côtés dans la guerre d’Indépendance. Or, ni la France
monarchique de l’Ancien Régime ni celle de la Terreur révo-
lutionnaire débouchant sur le césarisme de Bonaparte ne
pouvaient se trouver tout à fait en symbiose avec la jeune
République démocratique américaine, malgré nos références
communes aux Lumières.
Lionel Jospin a été Premier ministre de 1997 à 2002.
Le présent article reprend
le texte d’une conférence pro-
non
cée à Harvard le 4 décembre
2003.
Je remercie Stanley Hoff-
mann,
de l’université Harvard,
et
Suzanne Berger, du Massa-
chusets
Institute of Technology,
de leur invitation.
001.jospin 16/06/14 16:06 Page 4
Extrait de la publication

5
De l’autre côté, comme si vous et nous étions infidèles à
cet âge d’or mythique et virtuel, dès qu’apparaissent entre
nous des problèmes ou des désaccords, ceux-ci sont drama-
tisés. Ce fut le cas à plusieurs reprises, sous de Gaulle mais
aussi avec Mitterrand à l’époque de la guerre froide et du
monde bipolaire. Cela semble se reproduire aujourd’hui dans
le monde unipolaire où s’affirme sans ambages la puissance
américaine.
On explique souvent l’ambivalence de la relation franco-
américaine par le fait que nos pays, toute question de puis-
sance mise à part, ont tous deux des approches universalistes
du monde, sans qu’elles coïncident toujours. C’est vrai.
Il y a peut-être une autre explication pour la difficulté que
nous avons parfois à nous comprendre : l’absence d’immi-
gration française aux États-Unis au
XIX
e
et au
XX
e
siècle. La
misère et l’oppression n’ont pas été telles chez nous qu’elles
aient conduit mes compatriotes à quitter massivement leur
pays. Les Anglais, les Irlandais, les Italiens, les Portugais, les
Nordiques, les Grecs, les Allemands, les Polonais et les
populations juives d’Europe de l’Est ont nourri les grands
courants migratoires venus aux États-Unis. Nous sommes
restés étrangers au melting-pot né de la grande migration.
Nous n’avons pas connu les États-Unis modernes de l’inté-
rieur. Vous-mêmes n’avez jamais eu pendant cette époque à
intégrer une vaste communauté française qui aurait été chez
vous comme un écho de ce que nous sommes.
Mais l’histoire nous livre un autre constat tout aussi sin-
gulier et que j’ai plaisir à rappeler : nous n’avons jamais été
ennemis. Vous avez été en guerre avec l’Angleterre, l’Es-
pagne, l’Allemagne, l’Italie, la Chine, le Japon et, d’une cer-
taine façon, avec la Russie. Jamais avec la France. Nous
sommes donc des amis, mais des amis qui trop souvent se
caricaturent l’un l’autre.
Pour nous défaire de ces caricatures, il nous faut refuser
l’anti-américanisme ; il vous faut ne pas céder à la francophobie.
L’anti-américanisme, culturel ou politique, participe depuis
longtemps à un certain imaginaire français. Au
XIX
e
siècle,
il a pris naissance, autour de la figure du Yankee, quand s’est
Lionel Jospin
La relation
franco-américaine
001.jospin 16/06/14 16:06 Page 5
Extrait de la publication
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%