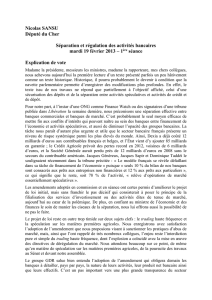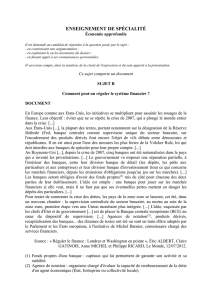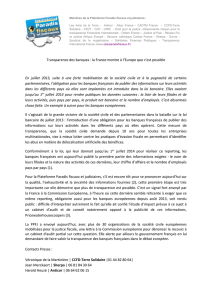La réforme bancaire du gouvernement Di Rupo est un coup d`épée

Réponse aux questions du SETCa Finances, 07-05-2014
Chère Madame Desmet, Cher Monsieur Cappoen,
Nous vous remercions pour votre lettre du 28 avril 2014. L’analyse que vous faites est très intéressante et
correcte. Á juste titre vous attirez l’attention sur le problème de l’emploi dans les banques.
Comme parti de gauche, nous voulons bien entendu être un appui politique aux revendications du monde du
travail, servir de caisse de résonance à des problèmes et des propositions qui ont trop peu voix au chapitre dans
nos différents parlements. Nous répondons donc volontiers à vos questions. Nous répondrons d’abord avec notre
vision globale sur les banques pour ensuite nous focaliser plus sur la problématique de l'emploi.
1. Un nouveau modèle de banque
La réforme bancaire du gouvernement Di Rupo est un coup d’épée dans l’eau parce que le
gouvernement ne veut pas toucher à la logique du profit des banques. Malgré les appels réitérés en
faveur d’un capitalisme « éthique », les grandes institutions financières multinationales continuent à
spéculer. C’est logique. À l’ère actuelle du capitalisme financier, où les activités industrielles et
spéculatives sont étroitement imbriquées, investir et spéculer vont main dans la main. C’est dans
l’ADN du système. Dans ce cas, il ne faut pas s’attendre non plus à la moindre « sécurité » ou
« éthique » de la part d’acteurs privés qui ne recherchent que le profit. Une réglementation qui fait
confiance au privé est vouée à l’échec.
La réforme bancaire du gouvernement Di Rupo est bien plus modérée que les mesures prises dans
les années 1930. Elle est aussi bien plus modeste que les réformes qui ont été approuvées ces
dernières années aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Elle est moins radicale que la réforme
américaine Volcker de 2010, qui interdit tout lien financier entre la banque de dépôt et la banque
d’affaires. Elle est même moins radicale que la réforme britannique Vickers, qui impose aux banques
traditionnelles une interdiction pour toute activité de trading et qui, pour le trading, exige une entité
totalement à part, même si cette entité peut rester au sein du même groupe.
Nous devons nous éloigner de cette voie sans issue des activités bancaires et spéculatives privées, où
– quand ça fonctionne bien – les avantages vont à une poignée d’actionnaires privés, et où – quand
ça foire – l’État doit supporter les charges. Notre société ne peut plus se permettre une deuxième
crise bancaire.
Nous devons changer de cap et tourner à gauche. Pour pouvoir épargner en sécurité et pour obtenir
des crédits bon marché, une scission entre la banque de dépôt et la banque d’affaires ne suffira pas.
La collectivité qui, aujourd’hui, paie les pertes de cette politique, doit pouvoir déterminer elle-même
ce que devra être cette politique bancaire et aussi pouvoir en tirer les bénéfices. Nous voulons une
banque publique version 2.0. Naturellement, un statut public n’offre pas une garantie d’étanchéité
totale. Mais la spéculation sauvage et les opérations à risque avec l’argent des économies peuvent
toutefois être plus facilement évitées dans ce cas. Nous pouvons imposer des règles strictes – pour
les salaires des administrateurs aussi – et les faire contrôler par des syndicats du personnel et des
associations de consommateurs.
« Moins d’intervention de l’État, le privé est plus efficace que l’État », répètent les chantres du
néolibéralisme. Mais aucune étude ne confirme cette déclaration. Au contraire. Durant 130 ans, des
banques comme la CGER et le Crédit communal ont été gérées par le secteur public. Cela marchait
très bien. Mais quand elles ont été vendues au privé, il n’a pas fallu dix ans avant qu’elles ne fassent

faillite. L’État a dû intervenir à coups de milliards pour les sauver. C’est donc le privé qui ne s’est pas
montré capable de gérer un secteur aussi important que celui des banques.
Plus grave encore, ce système privé des banques a une responsabilité déterminante dans la crise
de 2008. Et quelle leçon ces banques en ont-elles tirée ? Qu’elles pouvaient faire ce qu’elles
voulaient. Les États allaient de toute façon les sauver, puisqu’elles sont too big to fail.
Mais la logique est celle-ci : si l’État alloue des fonds, il doit aussi tenir la barre et contrôler
l’utilisation de cet argent dans l’intérêt des gens. Le monde des banques est bien trop important pour
le laisser aux mains du privé, qui a une fâcheuse tendance à jouer avec le feu.
Nous sommes partisans d’une banque publique version 2.0. Un nouveau modèle de banque où
l’État est garant de l’argent de l’épargne, où l’on ne cherche pas de marchés à haut risque et où
l’on ne rachète pas de crédits toxiques, où les rentrées retournent vers la société avec des
investissements dans l’économie réelle, dans l’énergie verte, dans la mobilité et le logement. La
continuité est assurée, parce que les services à fournir sont essentiels pour les citoyens et parce
que l’intérêt général prime sur les critères de la rentabilité financière. La rentabilité sociale passe
avant la rentabilité financière. Si des bénéfices sont réalisés, ils doivent servir à assurer la
continuité du service. Le profit ne peut donc être un but en soi.
Les banques publiques devraient êtres des banques pour lesquelles l’État n’intervient pas seulement
comme ‘investisseur’, mais aussi et avant tout comme ‘gestionnaire’ actif. Ce n’est qu’à cette
condition là qu’une banque publique peut travailler en fonction des besoins de la société. Et il est
clair que les besoins sont nombreux : besoins de proximité d’agences, de services de qualité basés
sur des relations humaines et des conseils fiables. Besoin d'une banque où tout le monde est traité
sur pied d'égalité quel que soit le pouvoir financier du client. Pour la banque publique 2.0 l’emploi
n’est pas un mal nécessaire, que du contraire, les travailleurs dans les agences et au siège seront le
cœur de la banque publique.
2. Des Banques publiques, c’est réaliste
Il existe de Banques publiques dans des dizaines de pays. Ainsi, les banques publiques dans les
économies émergentes (BRICS) agissent comme moteur pour leur économie puissante. Ainsi, des
banques publiques dans nos pays voisins les Pays-Bas et la France assurent la continuité et un
financement de l’État. Ainsi la Kiwibank en Nouvelle Zelande a prouvé que les clients étaient
extrêmement contents du service et des produits bancaires offerts.
Les institutions sauvées avec de l’argent de la collectivité belge, profitent presque toutes, toujours
encore du financement et/ou des garanties d’état. En outre l’état se porte garant pour tous les
dépôts à hauteur d’un montant de 100.000 euro par personne, par institution financière, abstraction
faite de l’origine, nationale ou internationale de l’institution. L’État a donc bien son mot à dire dans
le secteur financier si au moins il fermait sa porte au lobby des banques et l’ouvrait aux syndicats
ainsi qu'à la société civile.
Dans notre vision :
1. Il est clair que des institutions comme Belfius et Bpost Bank doivent être transformées en
vraies banques publiques 2.0 qui développent l’emploi. D’autres banques qui ont été sauvées
par l’État, comme Fortis Belgique et KBC devraient être (re)nationalisées et ensuite
transformées en banques publiques.

2. Les banques fournissent un service essentiel à la société, il vaut donc mieux ne pas les laisser
dans les mains d’actionnaires privés. Dans l'immédiat, il faut au moins une interdiction de leur
cotation en bourse car celle-ci renforce la spéculation, la recherche du profit à court terme et
donc les diminutions continues de l’emploi.
3. En-dehors de ces mesures spécifiques pour le secteur, nous plaidons pour l’introduction d’une
loi générale Inbev qui interdit de licencier dans des entreprises rentables.
Le rôle que jouent les syndicats dans le secteur financier est très important. Vos combats quotidiens pour la
défense de travailleurs actuels et futurs dans le secteur ont tout notre soutien. Nous serons toujours à vos côtés
pour défendre l’emploi.
Nous sommes très intéressés par vos expériences et votre vision concernant les banques. Et nous serions ravis de
vous rencontrer.
Pour le PTB
1
/
3
100%