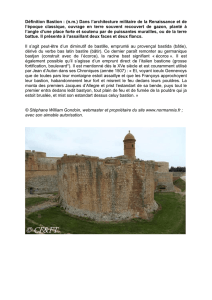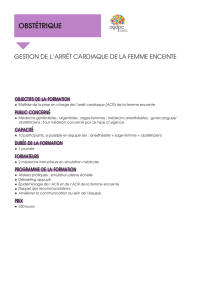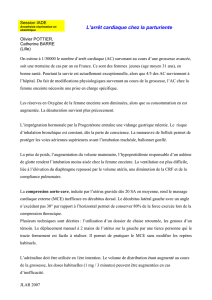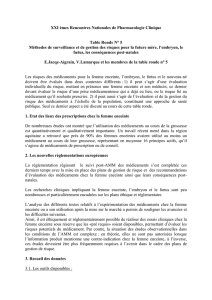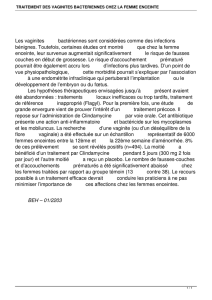Télécharger

1
Christian CORVISIER à
REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
Historien de l'architecture Direction de la Culture et du Patrimoine
34, Grande Rue 21, place Jules Guesde
02130 BRUYERES SUR FERE 13481 MARSEILLE CEDEX 20
tel: 03-23-71-20-93
e-mail: [email protected]
COMMUNE DE TOULON (Var)
ENCEINTE ET OUVRAGES DE DEFENSE
DU CORPS DE PLACE
DE
LA VILLE ET DE L’ARSENAL
HISTORIQUE, TOPOGRAPHIE ET TYPOLOGIE GENERALE
Jusqu'au cours du XVIe siècle, la ville de Toulon demeura étroitement close dans son
enceinte médiévale de dimensions restreintes, jalonnée de tours et de tours-portes de plan
carré, la croissance de la population entraînant le développement –d’ailleurs assez limité- de
faubourgs extra muros. La situation littorale et la configuration générale de la ville invitent à
comparer le cas de Toulon à celui d’Antibes, petite ville épiscopale enfermée dans l’enceinte
obsolète d’un castrum du Bas-Empire : dans les deux cas, les préoccupations d’auto-défense
et la prospérité de la ville n’étaient pas suffisantes pour justifier, de la part des échevins, un
effort coûteux d’agrandissement et de reconstruction de l’enceinte. Mais Toulon et Antibes
étaient vouées à devenir des places-fortes portuaires de l’Etat moderne dès le siècle de la
renaissance, du fait des avantages que leur port pouvait offrir à la flotte royale. C’est donc
d’abord le port que la puissance publique royale, avec le concours du corps de ville, entreprit
de mettre en sûreté, par un ouvrage de défense garantissant l’entrée ; et ce n’est que dans un
second temps, au terme de plusieurs tentatives avortées, que les représentants du roi de France
parvinrent à convaincre les échevins de financer en partie de nouvelles fortifications urbaines.
Cette étape, réalisée seulement autour de 1600, entraîna à Toulon la disparition de l’ancienne
enceinte, dissoute dans le parcellaire de la ville agrandie, ce qui ne fut pas le cas à Antibes.
Du fait des qualités stratégiques exceptionnelles de la rade de Toulon, c’est tôt dans le
XVIe siècle -dès la fin du règne de Louis XII et le début de celui de François Ier, de 1514 à
1524- que la « grosse tour » ou « tour Royale » fut bâtie sur un cap terminant la presqu’île du
Mourillon et contrôlant du côté est la passe d’entrée de la « petite rade ».
En octobre 1531, Renzo da Ceri, dit le capitaine Ransse ou seignor de Ransé, capitaine
milanais qui avait participé à la défense de Marseille assiégée par les troupes de Charles de
Bourbon, fut missionné à Toulon au nom du roi François Ier pour étudier la possibilité d’une
extension et d’une modernisation de l’enceinte de la ville, ce que le conseil de ville rejeta en
raison des destructions de faubourgs et d’arbres qu’un tel projet aurait entraîné. Les
délibérations municipales de novembre 1531 renseignent sur un projet alternatif proposé par
le même « seignor de Ransé, commissarius ad hoc », irréaliste et tout aussi inacceptable pour
les toulonnais, qui consistait à créer une ville neuve fortifiée sur la presqu’île du Mourillon,
dont la Grosse Tour aurait été le réduit, avec obligation aux habitants de participer au
lotissement, en acceptant d’abandonner leur maison dans la ville de Toulon en cas de péril

2
pour s’installer dans celle bâtie dans la nouvelle forteresse.
1
Si ce projet resta lettre morte, il
est intéressant de noter que l’idée d’un quartier neuf ou lotissement hors les murs de Toulon,
sur la presqu’île du Mourillon, à l’est du port, revint à plusieurs reprises au XVIIIe siècle
comme option des projets généraux des ingénieurs militaires royaux.
Au mois de janvier 1552, Claude de Savoie, comte de Tende-Sommerive, grand
sénéchal et gouverneur de Provence (de 1525 à 1566), soumettait au conseil de ville de
Toulon le projet d’une nouvelle enceinte urbaine, plus vaste que l’ancienne et fortifiée « à la
moderne » . La lettre du gouverneur proposait de « fère amplier, agrandir et fortifier la ville
de Thoulon et, ce fesant, y fère nouveaulx foussez, murailhes, balloards et plattes formes
requises pour la tuition et deffence de la dicte ville et port d’icelle ». Le sieur Mottet, premier
consul de Toulon, parent de Pierre Mottet, qui avait été, pour la ville, de 1517 à 1524, le
trésorier principal de la construction de la « Grosse Tour », réunit dès le 17 janvier 1552 un
conseil général extraordinaire de la communauté composé des deux conseils « vieil et
moderne » et de trente-cinq chefs de famille pour délibérer de cette question. La décision
soulevait un problème de financement, le gouverneur de Provence posant pour condition une
participation de la ville de dix mille écus, sur un montant total de vingt-cinq mille, en sorte
que le conseil répondit qu’il ne pouvait contribuer aux frais que pour la somme de dix mille
livres (soit le tiers des dix mille écus demandée), payable en cinq ans, par annuité de deux
mille livres, et seulement à compter du jour où les quinze mille écus engagés par le
gouvernement de Provence seraient dépensés, « veu que aultrement ne se sauroit fère sans
estre ruynés » . La délibération précisait que « ladicte ampliation et fortification de la ville de
Thoulon » était devisée « suyvant le pourtraict et exemplaire faict et monstré au conseil par le
sieur de Sainct-Rhemy, commissaire des fortifications »
2
Jean de Saint-Remy, commissaire de l’artillerie, expert en fortification mentionné à
partir de 1536, était alors à la fin de sa brillante carrière d’ingénieur militaire propagateur du
bastion –le seul alors qui ne fût pas italien. Il s’était illustré notamment par la conception de la
première enceinte bastionnée réalisée en Provence, et l’une des plus anciennes en France,
celle de Saint-Paul-de-Vence, achevée peu après la mort de François Ier en 1547. Il fut
chargé de diverses missions par François Ier, puis Henri II. Le premier de ces deux souverains
l’avait chargé d’une tournée des villes fortifiées de Provence en 1546, d’où il devait rapporter
« les portraitz et dessaing (des fortifications) pour les veoir et sur le tout oyr et entendre
votre advis et rapport », lui exprimant sa confiance en indiquant « que n’y pourrions envoyer
personnage qui soyt pour mieux satisfaire à nostre desir volompté intentions que vous, par
l’expérience et bonne intelligence que vous avez esd. fortifications »
3
. La mise de fonds de la
ville ayant été estimée insuffisante, le projet fut abandonné.
L’entrée de la petite rade de Toulon étant bien défendue par la Grosse Tour royale, la
fortification de la ville proprement dite n’était sans doute pas considérée comme
suffisamment névralgique pour que le gouvernement de Provence remît rapidement le projet à
l’ordre du jour. Cette circonstance n’intervint que vingt huit ans plus tard : Au début de mars
1580, le gouverneur de Provence récemment nommé était Henri d’Angoulême, fils naturel du
roi Henri II, abbé commendataire de la Chaise-Dieu et Grand Prieur de France. Lors d’une
1
Toulon, Arch. Communales, BB, Délibérations du Conseil de Ville, Séance du 7 novembre 1531, f°346.
Gustave Lambert, Histoire de Toulon , chapitre XI, « Toulon sous Charles VIII, Louis XII et François Ier ,1487-
1544», Bulletin de l’académie du Var, nouv. Série, t. XIV, 1888, , p. 266-269.
2
Arch. Comm. série BB art. 52, fortifications ; citations par Gustave Teissier, « Agrandissements et
fortifications de la ville de Toulon », Bulletin de la société académique du Var, 1873 (p. 325-481), p. 349 et par
Gustave Lambert, Histoire de Toulon, chapitre XII « Toulon pendant les guerres de Religion, 1530-1589»,
Bulletin de l’académie du Var, nouv. Série, t. XIV, 1888, p. 320-323.
3
BNF, Ms, coll. Dupuy, ms. 273, f° 73, cité par H. Charnier, « Notes sur les origines du génie, du Moyen Âge à
l’organisation de l’an VIII », Revue du génie militaire, t. LXXXVII, 1954, p. 39, et par H. Vérin, La gloire des
ingénieurs , l’intelligence technique du XVIe au XVIIe siècle, Paris, 1993, p. 120.

3
entrevue à Aix, il avait autorisé Pons Ricard, premier consul de Toulon, à réunir le conseil «
pour adviser et délibérer sur ce qu'il y avoit à fère à propos de la fortiffication (de la ville) et
d'avoyr les moyens de la pouvoir fère et la conséquence d'icelle ». Une épidémie de peste
retarda de plus d’un an la réponse du corps de ville, qui achoppait à nouveau sur la question
du financement partagé. Réuni le 9 juillet 1581 par le nouveau premier consul Rippert, un
conseil général composé de cent treize membres rendit exactement la même proposition de
contribution qu’en 1552, qui aboutit au même ajournement, cette fois de quatre ans
seulement. En 1585, les consuls prirent l’initiative, et proposèrent au roi de prendre en charge
la totalité du coût de construction des fortifications de la ville en l’échange de la confirmation
de privilèges, d’octroi de droits et d’exemptions de taxes, astreintes et services militaires.
L’intention des consuls était de garder la maîtrise de l’enceinte fortifiée, comme dans
la période médiévale, avec attribution de la charge de gouverneur au premier consul, en
évitant les servitudes militaires et astreintes imposées aux habitants par le statut de place forte
d’Etat.
Un nouveau plan des l’enceinte urbaine projeté, comprenant six bastions, avait été
dessiné : « la ville de Thoulon sera fortiffiée suyvant la forme du pourtraict fait par
l'engégneur de sadicte Majesté, le seigneur Herculles ». Une enquête fut confiée à deux
procureurs par le gouverneur de la province Henri d’Angoulème, et par le trésorier général de
France pour examiner la recevabilité des conditions avancées par la ville, et une commission
d’experts, composée de deux architectes, deux ingénieurs et deux maçons plâtriers, sous
l’autorité morale des évêques de Marseille et de Toulon, fut nommée pour procéder au tracé
sur le terrain des nouvelles fortifications, d’après « la carte du desseing dudict sieur
Herculles ». Le premier bastion fut placé « dans le quartier de Sainct-Jean, près de la mer »,
les cinq suivants, respectivement, « au chemin dict de Sainct-Lazare le vieux (…) au lieu
appelé Sainct-Philip (…) au lieu appelé la Lauze (…) au lieu appelé Nostre-Dame » (…)au
lieu appelé Saincte-Peyronne, près de la mer ». Les courtines devaient avoir sept cannes de
hauteur, une canne d'épaisseur dans les fondations; les bastions cinquante cannes de contour;
le fossé dix de largeur et quatre de profondeur, sur un développement de mille cannes. Un
môle « tirant despuis le bastion du costé du levant jusques au bastion du couchant », deux
cannes de largeur, serait créé « pour la commodité du port de ladicte ville »
4
.
Le sieur Herculles n’est autre que l’architecte et ingénieur militaire piémontais Ercole
Negro, ou Nigra (1541-1622), auteur de plusieurs dessins datés de la décennie 1580 figurant
le plan de villes fortifiées des Alpes et de la vallée du Rhône, aujourd'hui conservées dans les
Archives de l'Etat à Turin. Avant de passer au service exclusif du duc de Savoie, avec le titre
de comte de Sanfront, Ercole Negro, qui relevait féodalement du roi de France jusqu’en 1588,
avait participé à des campagnes militaires durant les guerres de Religion, et produit des
projets de fortification en qualité d’ingénieur attaché d’abord à François de Lesdiguières,
lorsque ce dernier était chef des protestants du Dauphiné , puis au représentant du parti
opposé, Charles de Lorraine, duc de Mayenne, en 1580. Le « desseing » de Toulon a été fait, à
la commande, à cette période. L’assassinat du gouverneur de Provence Henri d’Angoulême, le
2 juin 1586, provoqua l’arrêt des négociations, et l’ajournement du projet, le roi Henri III
refusant les conditions proposées par les Toulonnais.
La construction de la première enceinte bastionnée de la ville sous Henri IV, 1589-
1595 Bernard de Nogaret, duc de La Valette, nommé gouverneur de Provence en 1587 en
remplacement de son frère le duc d’Epernon, ne trouva pas le moyen de relancer le projet de
4
Citations par Teissier, p. 351, et par Gustave Lambert, Histoire de Toulon, chapitre XII», Bulletin de
l’académie du Var, nouv. Série, t. XIV, 1888, p. 331.

4
fortification de la ville avant la mort d’Henri III et l’avènement d’Henri IV, du fait des
désordres civils associés aux guerres de Religion. Les préparatifs d’ouverture du chantier de
construction eurent lieu à l’occasion de son séjour à Toulon du 19 au 27 août 1589, et, le 16
septembre était passé devant notaire le prix-fait pour le creusement des fossés, aux frais de la
ville de Toulon. Le financement du reste des travaux fut aussi assuré par la communauté, en
prélevant une part contributive sur les communes voisines.
Le 18 septembre 1589, le consul Garnier mettait le conseil de ville en demeure, par
ordre du gouverneur, de voter les fonds nécessaires au commencement des travaux,
comportant, outre le fossé, la construction d’un premier bastion « au devant du port », comme
en témoigne le procès-verbal de séance : « A esté remonstré, dit le que hier, dix-septiesme du
présent moys de septembre, Mr de la Valette, admiral de France, commandant générallement
pour le Roy en ce pays de Provence, auroit passé contract avec cappitaine Pierre Hubac, de
ceste ville, de fère les foussés et bastion dont il nous a souventes fois parlé et, en exécution
duquel contract, nous seroit adjoint de trouver argent promptement pour mettre ladicte œuvre
en exécution. » Le conseil dut décider « qu'il seroit vendu à l'inquant tout le bien de ladicte
ville ». Les archives des délibérations municipales donnent des indications précises sur la
chronologie et sur le déroulement u chantier, mené à bien entre le 19 novembre 1589 (pose de
la première pierre) et la fin de l’année 1595, au début sous la direction du sieur Pierre Hubac,
capitaine de ville et « homme d'entendement et de grand esprit » d’une famille toulonnaise de
vieille souche.
D’après l'acte de prix-fait qui lui fut passé le 8 novembre pour la construction des
bastions, des courtines et des deux portes de l'enceinte, les revêtements, ou murailles devaient
être « bien et duement massonnées à chaulx et à sable », sur une épaisseur de cinq pieds de
roi à la base, de trois pieds de roi au sommet
5
et sur une hauteur de quatre cannes -ce qui est
de beaucoup inférieur aux sept cannes du devis d’Ercole Negro- « toutes lesdictes murailles
embouchées par dehors, avec leurs contreforts de trois en trois cannes, et fera toutes les
encoignures de pierre dure de taille, pour le prix de six écus pour chaque canne carrée »
6
.
Les travaux étaient supervisés par un « ingénieur » non nommé, dont le capitaine
Hubac devait suivre les directives et qui, contrairement à ce que supposait l’historien
toulonnais Gustave Lambert, n’était certainement plus Ercole Negro, alors passé au service du
duc de Savoie.
Une différence autre que la hauteur murale, par comparaison avec le toisé réalisé en
1585 selon les plans dudit sieur Herculles, tient au
nombre des bastions à construire, passé de
six à cinq. Le premier bastion en partant de l'Ouest, prit le nom de Notre-Dame du fait de la
chapelle voisine de Notre-Dame-de-1'Humilité. Lui faisaient suite, dans le sens des aiguilles
d’une montre, le bastion Saint-Roch, puis les bastion Saint-Vincent, Sainte Catherine et Saint-
Jean, dont les appellations étaient toutes liées à la proximité d’une chapelle, celle de Saint-
Jean ayant été incluse à la gorge même du bastion, engagée dans son aire intérieure. Ces
bastions, tous à flancs retirés couverts par un orillon, comportaient deux casemates et trois
guérites sur cul-de-lampe en pierres de taille, ce que l’on peut supposer conforme au dessein
d’Ercole Negro. Toutefois, la carte du desseing dudict sieur Herculles n’ayant pas été
conservée, on ne peut exclure l’hypothèse de changements de forme apportés par l’ingénieur
mentionné mais non nommé par les sources municipales, auquel Hubac devait se référer. Les
bastions à orillons des citadelles de Valence et de Gap, bâties sur les plans d’Ercole Negro en
1580 et 1581, ressemblaient à ceux réalisés à Toulon, mais avec des flancs bas retirés à ciel
ouvert, ceux de Toulon étant casematés. Si les cinq bastions étaient semblables dans leur taille
5
En 1755, lors de l’écroulement d’un des bastions, les épaisseurs constatées du revêtement sont de 6 pieds à la
base, 3 au cordon, sans contreforts.
6
Citations par Gustave Lambert, Histoire de Toulon, chapitre XII», Bulletin de l’académie du Var, nouv. Série,
t. XIV, 1888, p. 360-361.

5
et leurs proportions, le plan polygonal de l’enceinte de Toulon n’était pas parfaitement
géométrique, comme en attestent de sensibles différences de longueur linéaire d’une des six
courtines à l’autre. Les deux portes de ville, celle de l’ouest dite de Notre-Dame et celle de
l’Ouest, de Saint-Lazare, faisaient pendant, mais aucune des deux n’était percée au centre de
la courtine correspondante. Ces deux portes avaient une façade en pierre de taille « à la
rustique » (à bossages), un passage voûté également en pierre de taille, un pont-levis à
flèches. La largeur du passage unique était inférieure à 4m (deux cannes). Le pont dormant
comportait huit piles de pierre.
La spécification de l’emploi de pierres appareillées à bossages rustiques pour les
portes de ville invite à penser que ce type de parement, employé à Toulon dans le premier
quart du XVIe siècle pour la Grosse Tour royale, ouvrage luxueux et ostentatoire, n’était pas
appliqué au revêtement courant des bastions et des courtines, dont seuls les angles saillants
semblent avoir employé la pierre de taille, le reste ayant pu être parementé plus
économiquement en blocage. Les bastions et courtines semblent avoir tous été couronnés d’un
parapet d’infanterie maigre au-dessus du cordon, à l’arrière duquel passait un chemin de
ronde adossé au rempart de terre formant banquette et parapet d’artillerie pour le tir à barbette
. Ce terre-plein ne comblait pas toute l’aire intérieure des bastions, mais y régnait, au revers
du revêtement, sur la même largeur qu’aux courtines, dégageant un vide intérieur assez ample
qui pouvait accueillir du bâti (chapelle Saint-Jean, magasins à poudres, maisons en
empiètement).
L’enceinte du port prolongeant et fermant celle de la ville, œuvre de Raymond de
Bonnefons, 1604-1640
Considérablement agrandie par cette grande campagne de fortification de 1589-1595
(passant d’un peu plus de trois hectares à un peu plus de treize, intra-muros), la ville n’avait
été dotée que d’une enceinte du côté de la terre. Le raccordement au front de mer, qui devait,
selon les intentions du duc de La Valette formulées en 1590, donner lieu à la construction de
deux autres bastions encadrant le quai du port et participant à la défense de la petite rade,
n’était pas traité.
En octobre 1595, Henri IV concédait aux Toulonnais, le droit de tracer deux rues
neuves le long du rivage, mais ce n’est qu’au début de 1604, que l’aménagement défensif du
front de mer fut pensé et mis en oeuvre. Le 3 janvier, le conseiller Garnier de Montfuron
établissait un procès-verbal après avoir reconnu les lieux propres à l’implantation du futur
arsenal : « Nous aurions avisé n’y avoir lieu plus propre ni plus commode pour la fabrique
des vaisseaux, que l’espace qui est entre la courtine de la porte Notre-Dame, jusques à la
mer, où conviendra faire un bastion
7
». Quelques mois plus tard, Charles de Lorraine, duc de
Guise, gouverneur de Provence, confirmait aux consuls de Toulon la nécessité de prolonger
jusqu’à la mer la courtine amorcée à la droite du bastion Notre-Dame « selon le plan et
dessein qu’en sera fait par le sieur de Bonnefons, ingénieur de Sa majesté
8
». En 1598,
Raymond de Bonnefons , ingénieur du roi pour la Provence, le Dauphiné et la Bresse, avait
édifié, à la demande d’Henri IV, sur l’île de Ratonneau au large de Marseille, une forteresse
en forme de « grosse tour » octogonale, parti qu’il réïtéra en 1602 à Saint-Tropez, pour former
le « donjon » de la future citadelle. A partir de 1603, il dirigeait à Antibes un chantier de
fortification de la petite ville portuaire, comparable à la configuration de Toulon, en
s’inspirant peut-être, pour le front de terre bastionné, d’un projet de peu antérieur, non réalisé,
dessiné par l’un des ingénieur militaires du duc de Savoie, alter ego d’Ercole Negro, Ascanio
Vitozzi. A Toulon, il eut pour mission d’achever par un front de mer embrassant le port et
7
Gustave Lambert, Agrandissements et fortifications de la ville de Toulon, Bulletin de la société académique du
Var, 1873.
8
Id.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
1
/
82
100%