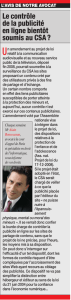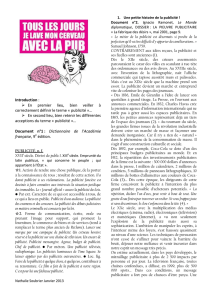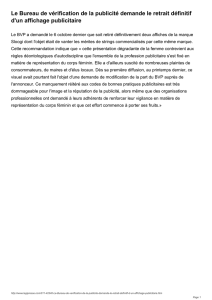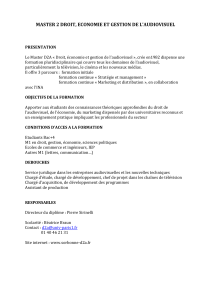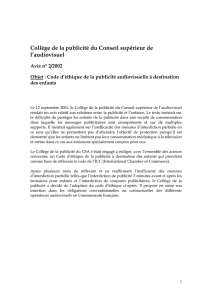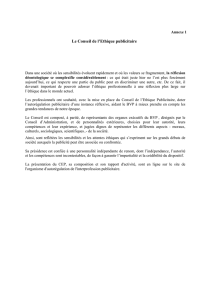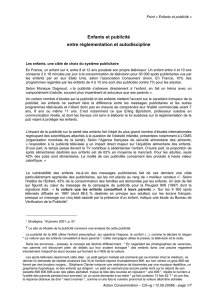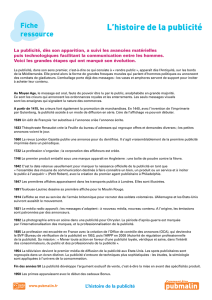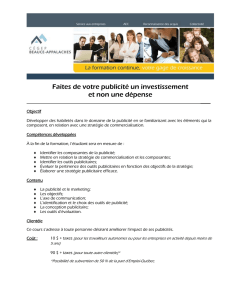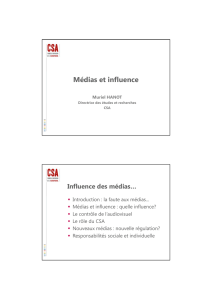LES MINEURS ET LA PUBLICITE TELEVISEE

© Tous droits réservés
LES MINEURS ET LA PUBLICITE TELEVISEE1
Adeline LACOSTE
Juriste
La préoccupation de la protection de l‘enfant face { la publicité
télévisée est ancienne. Ainsi, l’article 15 du règlement déontologique
de la Régie Française de Publicité2 disposait : « Une prudence toute
particulière peut être observée en ce qui concerne les enfants. En effet,
la puissance des moyens de la radio et de la télévision n’étant pas
proportionnée à leur fragilité, la publicité radiophonique et télévisée
doit respecter la personnalité de l’enfant et ne pas nuire { son
épanouissement ». Cette préoccupation majeure constitue aujourd’hui
l’une des missions clé du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), ce
dernier considérant que « certaines catégories de publics peuvent, en
effet, ne pas disposer de la maturité suffisante pour établir clairement
la différence entre ce qui relève d’un message publicitaire et ce qui
relève des programmes »3. Constitue une publicité télévisée « toute
forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre
contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou de
services, (…) dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle,
artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion
commerciale d’une entreprise publique ou privée »4. L’enfant faisant
l’objet d’une réglementation protectrice face { la publicité télévisée
est l’enfant mineur de moins de 18 ans, conformément à la
Convention internationale relative aux droits de l’enfant5.
1 Le présent texte est la version remaniée du Mémoire sous la direction de
Maître Alain HAZAN en vue de l’obtention du Master 2 (R) en droit de la
communication de l’Université Panthéon-Assas. Nos remerciements vont à
Mme Anne CHANON, de la Direction générale en charge du développement
déontologique et des relations institutionnelles au Bureau de vérification de la
publicité, Mme Laurence FRANCESCHINI, Directeur du développement des médias
(DDM), M. Arnaud ESQUERRE, chef de bureau des industries de programmes à la
Direction du développement des médias, ainsi qu’{ Maître Alain Hazan.
2 Créée en 1969 et liquidée en 1993, la Régie française de publicité était la
société qui gérait la publicité des trois chaînes de télévision et des quatre radios
du service public audiovisuel français.
3 Recommandation du CSA du 7 juin 2006, aux éditeurs de services de
télévision, relative { des pratiques publicitaires liées { la diffusion d’œuvres
d’animation et de fiction { destination des mineurs.
4 Article 2 du Décret n°92-280 du 27 mars 1992, transposant l’article 1 de la
Directive « Télévision sans frontière » du 3 octobre 1989.
5 Article 1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant,
adoptée par l’Organisation des nations unies (ONU) le 20 novembre 1989.

2
© Tous droits réservés
Il existe aujourd’hui une multitude de chaînes spécialisées en
programmes destinés aux enfants, dites « chaînes jeunesse »6. Ce
foisonnement s’explique par le fait que les mineurs sont des
consommateurs assidus de télévision et par conséquent de publicité
télévisée. Ainsi, selon l’association Action – Consommation, un quart
des enfants entre 8 et 12 ans en France aurait un téléviseur propre7,
de même que selon une enquête du journal de Genève en France et
en Belgique, les enfants entre 7 et 12 ans regarderaient en moyenne
la télévision 2h30 par jour8. Or l’enfant est un être humain en
construction, dont l’esprit, le sens critique et l’expérience se forgent
progressivement. Le risque consiste alors { ce que l’enfant ne
dispose pas d’un regard suffisamment critique pour appréhender la
publicité en tant que telle. Ainsi, selon Barbara Caplan, vice-
présidente de l’entreprise marketing Yankelovitch Partners en
1996 : « Face à la publicité, les adultes sont circonspects, flairent
l’arnaque et le baratin. (…) Les enfants, eux, regardent la télé et
s’exclament juste : c’est super ! »9. Par ailleurs, le danger réside
également dans le fait que selon de nombreuses études l’enfant
influencerait très largement les achats au sein d’une famille, les
parents suivant très souvent son avis concernant notamment ses
jouets, vêtements, mais aussi pour les aliments tels que les desserts
et les boissons10. Ainsi, selon une étude Ipsos-Sofinco effectuée en
Europe en avril 2003, l’influence des enfants sur les achats de leurs
parents serait à hauteur de 84% pour les vêtements, 80% pour les
loisirs et 76% pour les produits alimentaires concernant la majorité
des parents11. De même que selon Moeata Melard, spécialiste du
marché des enfants de l’agence MSM Marketing Research, « plus de
la moitié des innovations parviennent dans les foyers par le biais des
enfants ». Le caractère influençable et le rôle prescripteur de l’enfant
expliquent cet engouement des publicitaires pour les mineurs. Cette
sollicitation permanente, de même que la sensibilité et la fragilité
6 Pour n’en citer que quelques une : Gulli, Canal J, Cartoon Network, Disney
Chanel, Fox Kids, Mangas, Télétoon, Tiji et Baby first.
7 Association Action Consommation, « Enfants et publicité : entre
réglementation et autodiscipline », mars 2007, www.actionconsommation.org.
8 DUMONT Pascaline, journaliste française indépendante, « Publicitaires, lâchez
les enfants ! », Le courrier Unesco, septembre 2001, www.unesco.org.
9 MOREIRA Paul, « Les enfants malades de la publicité », Le Monde
Diplomatique, 1996.
10 Cf. Annexe Etude sur « l’impact de la publicité télévisée sur les mineurs »,
janvier à mai 2008, Lacoste Adeline.
11 RAMJAUN Tauheed, « Nouvelle génération : le soulèvement des tweens », 23
février 2005,
www.lexpress.mu.

3
© Tous droits réservés
des enfants, nécessitent une protection spécifique du mineur face à
la publicité télévisée. Ainsi, l’intérêt de l’enfant doit être préservé et
le Conseil national de la consommation « reconnaît que la valeur à
protéger, le développement mental, spirituel, éthique, civique et
psychique des enfants est un intérêt social majeur »12, conformément
à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant13.
Toutefois, les chercheurs, les professionnels et les associations de
consommateurs ne sont pas tous d’accord quant { l’étendue de cette
protection.
Ainsi, le psychologue et chercheur Jeffrey Goldstein14, estime que
« les gens exagèrent le pouvoir de la publicité car elle est omniprésente
et parce qu’ils ne comprennent pas complètement leur propre
comportement en tant que consommateur »15.
Il en découle qu’il convient de s’interroger sur l’efficacité et la
suffisance du système de protection des mineurs face à la publicité
télévisée.
Il s’agit donc de déterminer dans un premier temps l’étendue
actuelle de la protection des mineurs face à la publicité télévisée eu
égard aux réglementations française, européenne et internationale
(Partie I), pour dans un second temps, dresser le bilan de l’efficacité
de cette protection et étudier l’opportunité d’une protection plus
large ou différente au regard du droit comparé (Partie II).
12 Avis du Conseil national de la consommation sur la publicité et l’enfant, NOR :
ECO0000416V, du 25 octobre 2000.
13 Article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de
l’ONU, du 20 novembre 1989 : «Dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs,
l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14 Jeffrey Goldstein est psychologue et chercheur au Département des
communications de masse { l’Université d’Utrecht, aux Pays – Bas.
15 GOLDSTEIN Jeffrey, « Enquêtes sur les enfants et la publicité », étude pour le
compte de la Commission européenne, Newsletter 13, http ://europa.eu.

4
© Tous droits réservés
PREMIÈRE PARTIE : LA PROTECTION DES MINEURS VIS-A-VIS
DE LA PUBLICITE TELEVISEE
«Toute publicité doit se conformer aux lois, être décente, loyale et
véridique »16.
Plus que tout autre téléspectateur, l’enfant doit être protégé du
système publicitaire et de ses pièges. C’est pourquoi le législateur
français et l’Union européenne se sont attachés à mettre en place un
système de protection renforcée du consommateur encore mineur.
C’est ainsi que, d’une part, l’obligation de clarté et de loyauté de
l’annonceur et du diffuseur envers le consommateur se trouve
accentuée lorsque le message publicitaire est destiné à des enfants
(Chapitre premier) et que, d’autre part, des mesures de protection de
la santé tant physique que morale du mineur ont été instaurées
(Chapitre II).
Chapitre premier – Une obligation de clarté et de loyauté
renforcée
Les acteurs publicitaires doivent veiller à ce que tout message
publicitaire destiné à être perçu par un mineur soit facilement
identifiable en tant que tel par ce dernier et se distingue donc très
nettement des autres programmes (§ 1). Par ailleurs, le publicitaire ne
devra pas chercher { tirer profit de l’inexpérience de l’enfant (§ 2).
§ 1. L’exigence accrue d’une identification claire de la publicité
Tout message publicitaire doit être clairement distingué des autres
programmes et « identifiable comme tel » par le consommateur17 (A).
Est ainsi interdite toute publicité clandestine, effectuée dans la
violation des règles d’identification de la publicité (B).
16 Article 1er du Code international des pratiques loyales en matière de
publicité, de la Chambre de Commerce internationale, in C. GRELIER-LENAIN,
« L’enfant et la publicité », Gaz. Pal., 26-30 mai 1996, Doctrine, p.524.
17 Article 73, alinéa 1 de la Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 : « le message
publicitaire doit être clairement identifiable comme tel ». Idem article 8 du
Décret n°87-239, du 6 avril 1987 ; article 10.1 de la Directive n°89/552 du 3
octobre 1989 « Télévision sans frontière », modifiée par la Directive n°97/36
du 30 juin 1997 ; article 12 du Code international des pratiques loyales en
matière de publicité de la Chambre de commerce internationale.

5
© Tous droits réservés
A – La distinction nette entre le programme et la publicité
Afin de garantir une identification effective du message
publicitaire en tant que tel par les mineurs, le législateur a imposé la
diffusion d’un avertissement encadrant chaque séquence publicitaire
(1) et a strictement réglementé la publicité en faveur de dérivés
commerciaux de programmes destinés à la jeunesse (2).
1 – L’exigence d’un avertissement sonore et visuel
Chaque séquence de publicité diffusée par une chaîne de la
télévision doit être précédée et suivie par des « écrans
reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques »
permettant de clairement identifier le message publicitaire et de le
distinguer nettement des autres programmes18. Dans l’hypothèse où
les caractéristiques du service de télévision ne permettraient pas le
respect de la règle précédente, la convention et le cahier des charges
conclus entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la chaîne
concernée pourront alors définir les conditions permettant à la
publicité d’être clairement identifiée.
En pratique, l’avertissement encadrant les séquences publicitaires
télévisées se caractérise le plus souvent par l’apparition { l’écran du
mot « pub » ou « publicité », accompagné d’un jingle qui lui est
propre.
Lorsque le message publicitaire s’adresse { un enfant, l’exigence
de clarté a été renforcée par le Bureau de vérification de la
publicité19 et implique que celle-ci soit « nettement distinguée » de
l’ensemble des programmes diffusés20 et « rapidement identifiable »21
par l’enfant. Cette règle spécifique étant issue d’une recommandation
du Bureau de vérification de la publicité n’a donc pas valeur
législative. Toutefois, il est établi que les recommandations du
18 Article 14 du Décret n°92-280, du 27 mars 1992, pris pour l’application des
articles 27 et 33 de la Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les
principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en
matière de publicité, de parrainage de télé-achat ; ainsi que l’article 10.1 de la
Directive n°89/552 du 3 octobre 1989, « Télévision sans frontière », modifiée
par la Directive n°97/36 du 30 juin 1997.
19 Le BVP est devenu en 2008 l’Autorité de Régulation Professionnelle de la
Publicité (ARPP).
20 Recommandation du BVP « Enfant » de juin 2004, §1-1.
21 Recommandation du BVP « Enfant » de juin 2004, §1-2 : « Lorsqu’il s’adresse
aux enfants, le caractère du message doit être rapidement identifiable ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
1
/
72
100%