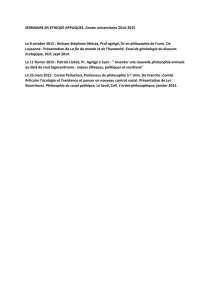La Philosophie politique et la question de la loi Pierre Manent1

1
La Philosophie politique
et la question de la loi
Pierre Manent
1
Pour citer cet article : Manent, Pierre, « La philosophie politique et la
question de la loi », CIPPA – EA, vol. I, 2012-2013, n° 3, disponible sur :
http://cippa.paris-sorbonne.fr
Conférence du 9 avril 2013
La question traitée sera plutôt : la question de la loi comme objet perdu de
la philosophie politique.
Quelques remarques d’abord sur la situation de la philosophie politique,
qui reste extrêmement précaire, en dépit de quelques repousses assez
vigoureuses ici ou là, y compris en France, dans la dernière période. Pourquoi
cet effacement qui a pu ressembler parfois à une disparition ?
Vous connaissez la réponse épigrammatique de Hannah Arendt : chaque
fois qu’on fut en droit d’attendre une philosophie politique, c’est une philosophie
de l’histoire qui est arrivée. Fair enough, mais il faut ajouter qu’en même temps
la philosophie, y compris finalement la philosophie de l’histoire, tendit à être
dévorée, absorbée et fut finalement remplacée par l’histoire tout court.
Que s’est-il passé ? Permettez-moi de donner une réponse historique et
politique à cette question. Au fur et à mesure que l’Occident se déploie dans le
temps, sur un arc de développement immense qui relie et rend
mystérieusement coprésents des mondes humains très éloignés (Athènes,
Jérusalem, Rome, le christianisme, les Temps Modernes), et que, dans l’espace,
il découvre et conquiert les autres mondes contemporains, le monde humain
considéré comme un tout acquiert une ampleur et une diversité telles qu’il
semble qu’aucune idée, ou ensemble d’idées, n’est capable de le faire tenir
1
Directeur d'études à l'EHESS.

2
ensemble. Alors que l’Occident se projette victorieusement vers et sur le monde,
l’abondance du monde vient le submerger en retour. Le monde l’a emporté. La
diversité infinie du monde l’a emporté. Nous vivons désormais dans l’Histoire
comme addition indéfiniment ouverte ou inachevée de particuliers, de
particularités de lieu et de temps.
L’Histoire comme montée au jour, comme « insurrection » des conditions
de lieu et de temps, a un pouvoir critique immense. Par exemple, les œuvres de
l’esprit ne sont plus saisies selon l’unité de leur intention, de leur visée, de leur
« vouloir-dire », mais selon la diversité de leurs éléments historiques. Critique
biblique, critique homérique. Tous les constituants du monde humain sont mis
dans l’Histoire comme dans un bain acide. On raconte « comment cela a
commencé ». Naissance de … Naissance de l’amour maternel, etc, y compris
bien sûr naissance de l’histoire.
Tout cela affecte considérablement la réflexion sur la politique. Il y a aussi
bien sûr une naissance de la politique. Or précisément, au commencement, la
politique paraissait envelopper l’histoire. En un double sens : l’ordre politique
paraissait sinon maîtriser du moins limiter et circonscrire la latitude des
événements ; et la philosophie politique paraissait envelopper – dominer sur -
l’enquête historique. Même chez Thucydide. Et l’histoire d’Athènes telle qu’elle
nous est rendue intelligible dans la Constitution d’Athènes par Aristote est
l’histoire du régime athénien, de la démocratie athénienne. Aristote n’écrit pas
une histoire d’Athènes au sens que nous donnons aujourd’hui et depuis déjà
longtemps à cette expression. Les Grecs étaient très attentifs au mouvement des
choses, y compris des choses humaines, mais ce mouvement, celui des choses
humaines, c’est fondamentalement celui de la chose politique, le mouvement du
régime, ou le mouvement déterminé par la dynamique et le mélange des régimes.
Fast forward. L’autre grande classification des régimes, avec celle d’
Aristote, dans l’histoire de la philosophie politique, c’est celle de Montesquieu.
Celui-ci est l’auteur le plus important, le plus éclairant, pour notre propos ou
pour ce moment de notre propos. Il se tient et intervient en ce moment
historiquement et épistémologiquement décisif où l’Europe comme quantité
politique et spirituelle est devenue indépendante de ses constituants successifs et
où ses conquêtes lui ont ouvert tout le reste du monde et l’ont ouverte à tout le
reste du monde. Il se trouve en ce point que j’évoquais en termes généraux au
commencement de cet exposé, en ce point où, pour la première fois, l’Europe
doit faire face à toute sa diversité intérieure et à toute la diversité extérieure :
« J’ai d’abord examiné les hommes, et j’ai cru que, dans cette infinie diversité
de lois et de mœurs, ils n’étaient pas uniquement conduits par leurs fantaisies. »
2
Montesquieu est sur le tranchant du rasoir. D’une part, comme Aristote qui
est son interlocuteur principal, il s’adresse au législateur : « Je le dis, et il me
semble que je n’ai fait cet ouvrage que pour le prouver : l’esprit de modération
doit être celui du législateur. »
3
En même temps, il adopte, ou il est sur le point
2
Préface de l’ Esprit des Lois.
3
Esprit des Lois, XXIX, 1.

3
d’adopter, ou il adopte presque sur les choses humaines un point de vue
purement théorique, c’est-à-dire le point de vue de la causalité matérielle ou
efficiente : « Plusieurs choses gouvernent les hommes : le climat, la religion, les
lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs,
les manières ; d’où il se forme un esprit général qui en résulte.
A mesure que, dans chaque nation, une de ces causes agit avec plus de
force, les autres lui cèdent d’autant. »
4
L’ordre politique n’est plus qu’une des
causes ou choses qui gouvernent les hommes, c’est-à-dire déterminent les
conduites humaines. Ces propositions de Montesquieu contiennent toutes les
sciences sociales. L’obscurité fameuse de Montesquieu sur la notion de loi –
nous dirions aujourd’hui que dans son Premier Livre il nous « enfume » - est très
éclairante. En même temps qu’il enseigne au législateur la meilleure manière de
concevoir la loi, qu’il l’éduque dans le meilleur « esprit », il déplace subtilement
et profondément le sens du mot « loi ». De cause directe des conduites humaines
- c’est ce qu’elle est nécessairement pour le législateur -, elle devient de plus en
plus effet. Et le même auteur qui enseigne comment organiser au mieux la liberté
politique, est en même temps celui qui conclut, certes à regret, que la servitude
est pour ainsi dire nécessaire sous certains climats – effet nécessaire de causes
naturelles.
Maintenant, le maître des législateurs et le père de la sociologie ne peuvent
être réunis dans le même esprit que parce que la législation que Montesquieu
recommande est orientée sur l’ « objet » nouveau qu’est la liberté politique telle
qu’elle est mise en œuvre par le régime anglais. Liberté qui consiste dans la
sûreté et l’indépendance de chaque citoyen ou plutôt de chaque « confédéré ».
5
La loi n’est que l’artifice qui assure la fluidité du mouvement des libertés. La loi
ne commande plus rien à proprement parler.
Nous en sommes là. Ou plutôt nous en sommes revenus là après plus de
deux siècles durant lesquels cette législation libérale a été subordonnée à, ou du
moins encadrée et guidée par, de vastes finalités collectives, orientées ou non
par des philosophies de l’histoire ambitieuses - parfois bien sûr aussi elle a été
rejetée ou abolie au nom de ces finalités. Notre point de vue sur la législation –
notre point de vue pratique - est aujourd’hui exclusivement celui de la liberté
comme sécurité. Et notre point de vue sur le monde humain – notre point de vue
théorique – est celui des sciences sociales. La seule chose qui nous sépare de
Montesquieu, mais cela fait une grande différence, c’est que nous avons perdu
confiance. Nous avons perdu confiance dans la liberté que, tout en la célébrant
emphatiquement, nous étouffons sous une prolifération infernale de règles ; et
nous avons perdu confiance dans la connaissance sociale, les sciences humaines
ayant renoncé en fait à leur projet fondateur – expliquer/comprendre – pour se
contenter désormais d’une survie réflexive et bien sûr institutionnelle – le projet
de connaissance étant dévoré par la méthodologie.
4
Ibidem, XIX, 4.
5
Ibidem.

4
*
Je suis passé très vite sur l’histoire de l’Europe dont le développement
intérieur, la succession de formes intérieures, ont conduit Montesquieu sur cette
hauteur à partir de laquelle, du haut de laquelle, il peut regarder les autorités les
plus vénérables, les masses spirituelles les plus puissantes, comme de simples
paramètres pour la nouvelle science, comme de simples « choses qui gouvernent
les hommes ». Quelles grandes autorités, quelles masses spirituelles ? D’abord
bien sûr, les républiques anciennes, et en général l’ordre politique comme ordre
du commun, la loi politique comme loi du bien commun. Ensuite, ou aussi, le
christianisme, la loi religieuse comme loi de l’âme, comme loi du salut. Cela ne
suffit pas. Tant que l’on reste dans la polarité république/ Église,
paganisme/christianisme, on reste sous le régime de la chrétienté. L’Europe
advient, comme Europe précisément, quand au point de vue républicain, puis
chrétien, s’ajoute un nouveau, un troisième point de vue. Les Temps Modernes
adviennent, trouvent leur légitimité lorsqu’est consolidé, lorsque s’impose … le
point de vue moderne. De quoi s’agit-il ?
J’ai parlé de point de vue moderne. Leo Strauss parlait du « projet
moderne ». Question disputée et qui doit l’être. Question à laquelle il faut
répondre avec une certaine netteté si nous voulons parvenir à une certaine clarté
à la fois sur notre histoire et sur notre situation. Alors qu’est-ce que le point de
vue moderne ? Une réponse s’impose. C’est la science. Qu’est-ce que la
science ? C’est le postulat, la pari, ou la certitude sans cesse vérifiée, que tout
phénomène peut ultimement être expliqué comme effet de causes accessibles à
l’intelligence humaine, y compris tout phénomène humain. Ou encore : la
science, c’est le point de vue théorique et le principe de causalité embrassant
aussi le monde humain qui n’est donc pas un empire dans un empire. Le pouvoir
de la science moderne est si grand, si intimidant, qu’il est difficile de ne pas lui
accorder le rôle central, sinon unique, dans la formation du point de vue
moderne. De fait nous ont été présentées des descriptions très persuasives d’une
modernité dominée par le principe de causalité, ou le principe de raison, par
l’idée claire et distincte, par le désir de certitude.
Il y a pourtant une difficulté. Comment le point de vue théorique a-t-il pu
s’imposer à ce point ? Les êtres humains en effet vivent principalement dans
l’action. La question que tous se posent, c’est : que faire ? Felix qui potuit rerum
cognoscere causas, peut-être mais peu nombreux sont les êtres humains
naturellement préoccupés de connaître les causes. Le point de vue humain, c’est
le point de vue pratique. Comment avons-nous laissé humilier si complètement
le point de vue pratique ? Comment l’avons-nous si aisément laissé glisser au
second plan ? On répondra : c’est à cause des succès de la science, des effets de
la science. Mais précisément, le projet de la science, et la foi dans la science, ont
nettement précédé ses effets. D’ailleurs, nous ne pouvons nous empêcher de
reconnaître comme « modernes » des développements qui ont précédé de loin
l’élaboration de la science moderne proprement dite, qui ont précédé de loin

5
Galilée et Descartes. Un auteur comme Machiavel par exemple n’avait aucune
idée de la science moderne, et pourtant une opinion répandue en fait le fondateur
de la science politique moderne. Faut-il penser alors que la science politique
moderne a précédé la science moderne, et que le projet moderne – gardons
provisoirement le mot – naît ou surgit comme projet politique et non pas d’abord
comme projet théorique ? Il naîtrait alors comme philosophie politique,
philosophie politique moderne.
C’est, vous le savez, la thèse de Leo Strauss, que j’accepte avec des
compléments ou des modifications, ou que je n’accepte qu’avec des
compléments ou des modifications. Strauss oppose la philosophie politique
moderne à la philosophie politique classique. C’est dans le livre sur Hobbes que
le sens de l’opposition est le plus clairement formulé. Selon Strauss, Hobbes est
préoccupé fondamentalement par autre chose que ce qui préoccupe Platon.
Platon cherche la norme, le critère le plus juste, le plus sûr. Hobbes cherche le
critère le plus applicable : « Respect for applicability determines the seeking
after the norm from the outset. » Et encore : « Hobbes’s political philosophy is,
therefore, different from Plato’s, that in the latter, exactness means the
undistorted reliability of the standards, while in the former, exactness means
unconditional applicability, applicability under all circumstances, applicability
in the extreme case. »
6
Le souci dominant de l’applicabilité fait que le contenu
du critère n’est plus interrogé librement ou avec la plus grande ouverture
possible. Donc, rétrécissement de l’enquête de la philosophie politique, qui
entraîne l’obligation d’entériner des principes ou critères soit dérivés de Platon
(comme l’idée même de la philosophie politique) soit de la tradition ou opinion
commune (comme celle selon laquelle la paix est la finalité exclusive de
l’État). La thèse de Strauss est donc la suivante : la philosophie politique
moderne se constitue en se révoltant contre la philosophie politique ancienne,
mais sans être capable d’accéder à un critère propre ; et, simplement pour les
rendre applicables, elle abaisse et obscurcit les critères anciens dans la
dépendance desquels elle reste. Au fond, elle n’a pas de légitimité propre, mais
reste dépendante de la légitimité de la philosophie politique ancienne telle que
Platon l’a élaborée.
Cette interprétation, qui est puissante, a en outre l’avantage, en accordant
une telle importance à la notion d’applicabilité, de rendre assez aisée la jonction
entre la philosophie politique moderne et la science moderne de la nature. Quoi
qu’il en soit de ce dernier point, je voudrais interroger un peu cette notion
d’applicabilité. Pour le dire d’un mot, je ne pense pas qu’elle ait l’importance
que Strauss lui attribue. Je ne suis pas sûr que l’applicabilité soit si importante,
et donc je ne suis pas sûr que les critères soient aussi peu interrogés par la
philosophie politique moderne que le dit Strauss. Je partirai du même point que
lui en le formulant différemment. Au lieu de l’applicabilité du critère, je partirai
de sa distance, de son écart, de son discosto par rapport à la vie que mènent
effectivement les hommes. Le problème avec les critères de Platon, comme avec
6
Voir The Political Philosophy of Hobbes (1936), The University of Chicago Press,
1963, pp. 150-151.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%