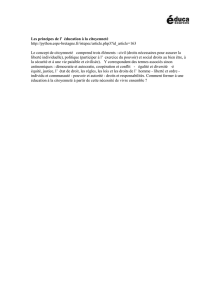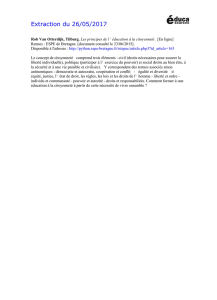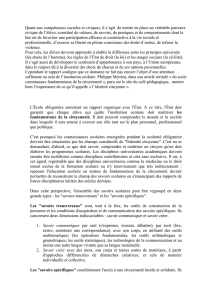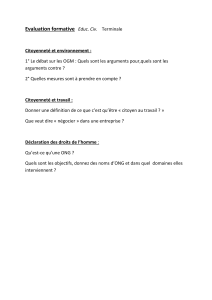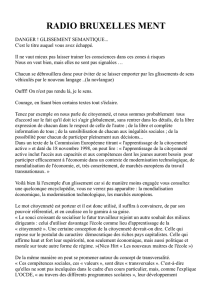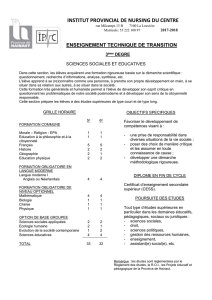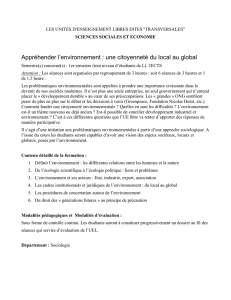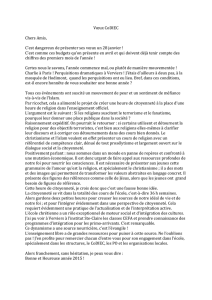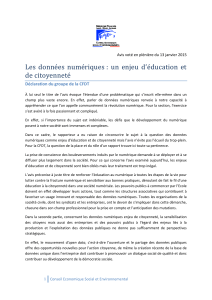PARLEMENT EUROPÉEN

Direction générale des Etudes
DOCUMENT DE TRAVAIL
LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
PROJET POLITIQUE POUR UNE UNION FÉDÉRALE
Série Libertés publiques
LIBE 114 FR

La présent document de travail est publié dans la langue suivante: FR.
Une liste des autres publications de la série "Libertés publiques" figure à la fin de ce document.
Editeur: Parlement européen
B-1047 Bruxelles
Auteur: Marcello Accorsi.
Responsable: Jean-Louis Antoine-Grégoire
Direction générale des Etudes
Division des affaires sociales et juridiques
Tél.: (0032) 284 2753
Fax: (0032) 284 9050
E-mail: jantoine@europarl.eu.int
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la position du
Parlement européen.
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la
source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci.
Manuscrit achevé en septembre 1999

Direction générale des Etudes
DOCUMENT DE TRAVAIL
LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
PROJET POLITIQUE POUR UNE UNION FÉDÉRALE
Série Libertés publiques
LIBE 114 FR
10-2001

La citoyenneté européenne: projet politique pour une union fédérale
PE 299.342
iii
Préface
Sommes-nous ou ne sommes-nous pas des citoyens européens à tous les effets? À ces questions et
aux autres questions de fond que se posent - consciemment ou non - les citoyens de tous les États
membres de l'Union, l'auteur répond de façon attentive et approfondie. Je le remercie de m’avoir
aimablement autorisé à présenter son œuvre qui, enfin, aborde un des problèmes les plus
épineux de l'identité communautaire sous le profil essentiel des relations entre citoyen et
territoire.
J'estime qu'il est important, tant en général qu'en particulier, de souligner avec clarté que la
souveraineté de l'État tire ses origines, à travers l'histoire, de l'identité commune d'un peuple, de
ses batailles pour l'indépendance des territoires, de la richesse de ses traditions, des us et
coutumes qui le caractérisent, de sa langue et de ses dialectes qui font partie d'un patrimoine
culturel et moral bien déterminé qui en constitue le principal point de référence.
Il s'agit d'une souveraineté qui, justement parce qu'elle se fonde sur ces principes et ces bases,
n'est pas et ne pourra jamais être remise en question ou "divisée" en deux ou plusieurs parties.
Les affirmations contraires à l'identité unitaire d'un pays, même observées à travers ses
différences stimulantes et inévitables, ne pourront jamais être acceptées ni trouver l'assentiment
de la population, ou du moins de son écrasante majorité. Heureusement, nous sommes
convaincus et prêts à défendre l'unité de l'Italie et son esprit religieux et sensible à ces valeurs.
La souveraineté de l'Union européenne quant à elle n’est pas née d'un négoce juridique,
cependant, étant issue d’un contrat, elle peut tout de même être considérée comme un dérivé.
C'est donc une souveraineté contractuelle et toutefois négociée qui a comme présupposé l'accord
unitaire de tous les États membres. J'ai voulu clarifier la position de départ d'un voyage dans
lequel nous sommes entièrement impliqués.
Les citoyens de tous les États membres sont aujourd'hui également des citoyens d'Europe et, en
tant que tels, jouissent de droits, mais ont aussi bien sûr des devoirs.
On ne peut par ailleurs parler d'une citoyenneté complète puisque les États membres n'ont pas
encore délégué ou voulu déléguer à l'Union européenne des pouvoirs forts qui en sont
l'expression fondamentale. Je pense ici au fameux troisième pilier qui, comme on le sait, touche
certains domaines essentiels non seulement pour l'institution, mais aussi et surtout pour les
citoyens qui ne peuvent être considérés comme tels s'ils ne jouissent pas de l'intégralité de
certains droits. L'Union ne peut pas encore garantir certains droits aux citoyens parce qu'elle
n'en a ni la légitimation, ni le pouvoir.
L'Union européenne, en effet, ne peut légiférer en matière de droit pénal, prérogative nationale
parmi les plus délicates. L'Union européenne, ne peut aujourd'hui que "recommander" aux États
membres d'insérer dans leur éventail juridique des normes pénales envisagées au niveau
communautaire (l'Italie, par exemple, a rapidement transposé l'indication sur les fraudes
commerciales dans les articles 640 bis et ter, etc.), mais ne peut pas "dicter" de lois en
garantissant en premier lieu certains droits aux citoyens face aux "nouveaux" crimes et aux
risques communautaires. Le même discours peut être tenu en matière de politique étrangère et
de sécurité intérieure, vis-à-vis desquelles les citoyens européens ne peuvent rester longtemps
démunis des droits relatifs à revendiquer "directement" à l'UE.

La citoyenneté européenne: projet politique pour une union fédérale
PE 299.342
iv
Ce sont de brèves réflexions qui tendent toutefois à montrer le chemin qu'il reste à parcourir,
surtout en vue de l'élargissement de l'Union qui nous oblige à affronter et à garantir, à côté de
ceux déjà définis, les droits attenants à un domaine aussi sensible pour la personne humaine que
celui exposé ci-avant. Il faut reconnaître que le mouvement de rapprochement s'intensifie, même
si on a perdu l'occasion précieuse conférée par Amsterdam d'accomplir un véritable saut dans le
sens de la qualité.
La coopération juridique et judiciaire, les nouveaux devoirs de l'Europe, la politique
méditerranéenne de l'Union, l'attention accordée aux pays de l'Est et au Tiers-Monde constituent
autant de bancs d'essai permettant de prévoir un virage courageux et nécessaire servant à faire
en sorte que le statut communautaire des citoyens puisse être complété et perfectionné.
La rédaction de la Constitution de l'Europe est en cours, laquelle a mis l'individu au centre en
faisant un choix éclairé, humain et chrétien, en poursuivant des valeurs qui, comme l'a rappelé
le président de la République italienne, doivent être défendus bec et ongles.
Toutes les conditions sont donc remplies pour parvenir au but recherché. Le travail de
M. Accorsi nous donne un coup de main précis pour tracer la bonne voie.
Enrico Ferri
Membre du Parlement européen
Vice-président de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des
affaires intérieures
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
1
/
52
100%