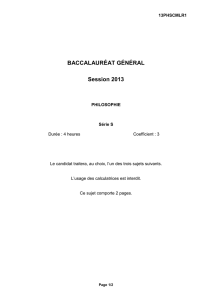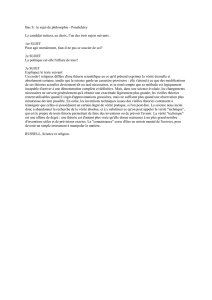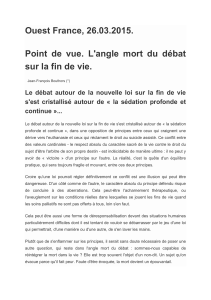BERGSON/La vérité .cwk - Fichier

TEXTE DE BERGSON SUR LA VÉRITÉ
« La vérité serait déposée dans les choses et dans les faits : notre science
irait l’y chercher, la tirerait de sa cachette, l’amènerait au grand jour. Une
affirmation telle que « la chaleur dilate les corps » serait une loi qui gouverne
les faits, qui trône [...] au milieu d’eux, une loi véritablement contenue dans
notre expérience et que nous nous bornerions à en extraire. [...] Cette conception
de la vérité est naturelle à notre esprit et naturelle aussi à la philosophie,
parce qu’il est naturel de se représenter la réalité comme un tout parfaitement
cohérent et systématisé, que soutient une armature logique. Cette armature
serait la vérité même ; notre science ne ferait que la retrouver. Mais l’expérience
pure et simple ne nous dit rien de semblable. L’expérience nous présente un flux
de phénomènes : si telle ou telle affirmation relative à l’un d’eux nous permet
de maîtriser ceux qui le suivront ou même simplement de les prévoir, nous
disons de cette affirmation qu’elle est vraie. Une proposition telle que « la
chaleur dilate les corps », proposition suggérée par la vue de la dilatation d’un
certain corps, fait que nous prévoyons comment d’autres corps se comporteront
en présence de la chaleur ; elle nous aide à passer d’une expérience ancienne à
des expériences nouvelles ; c’est un fil conducteur, rien de plus. La réalité coule
; nous coulons avec elle ; et nous appelons vraie toute affirmation qui, en nous
dirigeant à travers la réalité mouvante, nous donne prise sur elle et nous place
dans de meilleures conditions pour agir. »
BERGSON, La Pensée et le Mouvant, chapitre VIII.
1

Introduction.
Dans ce texte, extrait d’une préface rédigée par Bergson à l’occasion de la
traduction française, en 1911, du livre de William James intitulé Le
Pragmatisme (paru en 1907), Bergson aborde le problème de la vérité. Plus
précisément, il s’efforce de déterminer l’essence de la vérité ainsi que son
critère. Il s’agit donc de savoir en quoi consiste la vérité d’une assertion et
comment il est possible de reconnaître qu’elle est vraie.
Bergson soutient ici, du moins en ce qui concerne la vérité scientifique1, la
conception pragmatiste, selon laquelle la vérité est un guide pour agir sur les
choses. Ce qui revient à dire que la vérité se définit par les conséquences
avantageuses qu’elle entraîne pour l’homme sur le plan de l’action2. En
d’autres termes, le critère de la vérité, c’est la réussite et l’efficacité pratiques.
I. Bergson commence par rappeler la conception courante de la vérité,
conception reprise par certains philosophes, et qu’on peut nommer
intellectualiste, dans la mesure où elle se tient sur un plan purement
spéculatif ou encore purement théorique, sans souci, comme on le verra, de
la signification pratique de la vérité. Elle revient, selon Bergson, à confondre
vérité et réalité ou, du moins, à faire de la vérité une propriété des choses.
Ainsi, la vérité existerait dans la réalité elle-même. Une loi3, c’est-à-dire une
vérité scientifique comme celle qui énonce que « la chaleur dilate les corps »
serait une donnée de l’expérience, elle appartiendrait à la réalité objective
elle-même. En tant que propriété des choses, elle existerait donc
indépendamment de notre esprit.
1 Cf. « notre science » (lignes 1-2 et ligne 10). De plus, l’exemple choisi par Bergson : « la
chaleur dilate les corps » (ligne 3 et ligne 15) est un exemple de vérité scientifique.
2 En grec, pra~gma (lire : prâgma) signifie action (cf. William James, Le Pragmatisme,
Flammarion, 1968, p. 49).
3 Une loi, c’est-à-dire une relation constante entre certains phénomènes.
2

En tant que telle, elle préexisterait à la connaissance qu’on peut en avoir.
Et, puisque la vérité est cachée dans les faits comme une noix dans sa
coquille (Bergson, La Pensée et le Mouvant, in Œuvres, Éd. du Centenaire,
PUF, 1963, p. 1445), la connaissance (la science) se limiterait à une activité de
découverte, c’est-à-dire que son rôle serait seulement de dévoiler la vérité,
autrement dit d’ôter le voile qui jusqu’alors la masquait. En ce sens, le savoir
se réduirait à une simple mise en évidence de ce qui existe déjà : il
n’ajouterait rien à la réalité. L’emploi systématique, dans les deux premières
phrases, du mode conditionnel, traduit de la part de Bergson une intention
critique : c’est là le signe qu’il refuse une telle conception de la vérité.
II. Mais, avant de réfuter cette conception de la vérité, Bergson, dans une
seconde étape de son raisonnement, nous en explique l’origine. Elle a ses
racines, selon lui, dans une disposition naturelle de notre esprit à considérer
la réalité comme constituant un tout ordonné, et par conséquent stable (cf.
lignes 8-9 : « un tout parfaitement cohérent et systématisé », et ligne 9 : «
armature logique »). L’idée de Bergson, c’est qu’il y a là une exigence, un
besoin impérieux de notre esprit. Notre intelligence est caractérisée, dit-il, par
« un certain besoin de simplifier et de généraliser ce qu’elle perçoit » (Cours
I, PUF, 1990, p. 152). Nous avons donc spontanément tendance à organiser, à
unifier la réalité qui nous entoure, et cette mise en ordre du réel, c’est ce qui
constitue la raison. Pour Bergson donc, l’ordre n’est pas dans les choses, c’est
notre esprit qui l’y introduit. Mais pourquoi ? Parce que cela satisfait notre
raison qui retrouve dans la réalité comme une image d’elle-même (La Pensée
et le Mouvant, in Œuvres, op. cit., p. 1442). C’est ce qui explique que les
vérités scientifiques, les lois, constituent tout naturellement pour nous l’«
armature logique » de la réalité, c’est-à-dire que nous concevons le réel
comme étant en lui-même ordonné. Et ce que nous appelons vérité se
confondrait avec cet ordre immanent à la réalité.
III. Pourtant, si nous nous en tenons à ce que James appelait : «
3

empirisme radical » et que Bergson appelle ici « expérience pure », à savoir
une perception du réel à laquelle nous n’ajoutons rien – « qui ne se plie
d’avance à aucun système », dit Victor Delbos (Le Pragmatisme au point de
vue religieux, in Questions du temps présent, 1910, p. 124) – ni ne retranchons
rien – le mot important ici, c’est « pure » –, la réalité n’apparaît nullement
comme un ordre statique, « comme quelque chose de fixe ou de stationnaire
» (Delbos, ibid., p. 122), mais, dit Bergson, comme « un flux de phénomènes
» (ligne 12), c’est-à-dire comme quelque chose de fondamentalement
changeant et en perpétuel devenir. L’expérience nous invite, pour
caractériser la réalité, à remplacer l’image de l’horloge, symbole d’ordre et
d’harmonie, par celle d’une rivière ou d’un fleuve qui ne cesse de s’écouler
(La Pensée et le Mouvant, in Œuvres, op. cit., p. 1442). Cette comparaison de
la réalité avec une rivière ou un fleuve dont l’eau s’écoule sans cesse, déjà
présente chez Héraclite (Fragment B 91), se trouve en effet chez James lui-
même. Or, comme on va le voir la théorie pragmatiste de la vérité chez James
est étroitement dépendante de la conception qu’il se fait de la nature de la
réalité (Bergson, La Pensée et le Mouvant, in Œuvres, op. cit., p. 1449).
La définition classique de la vérité revient à dire qu’elle consiste dans la
concordance entre l’esprit et la chose (ibid., p. 1444). « La vérité est
l’adéquation de l’intellect et de la chose », disait saint Thomas d’Aquin. Ce
qui revient à dire qu’il y a vérité lorsque le jugement (cf. dans le texte «
affirmation », lignes 3 et 14) – juger, en effet, c’est affirmer quelque chose de
quelque chose – que l’on porte sur la réalité est en accord avec celle-ci. Cette
définition de la vérité est, selon les pragmatistes, tout à fait « respectable et
légitime » (Delbos, Le Pragmatisme au point de vue religieux, op. cit., p. 121),
mais elle pose un problème d’interprétation. Le problème est en effet de
savoir en quoi consiste un tel accord (James, Le Pragmatisme, op. cit., p. 142
et p. 218).
La conception que Bergson expose dans la première étape du texte,
4

conçoit cet accord en terme de ressemblance. Elle considère la vérité comme
un simple reflet de la réalité dans notre esprit (James, Le Pragmatisme, op.
cit., p. 142). Pour cette conception, notre jugement – ce que nous affirmons
de la réalité – s’accorde avec la réalité, donc peut être dit vrai, à la condition
d’en être le miroir fidèle, un peu comme un bon portrait ressemble à son
modèle (Bergson, La Pensée et le Mouvant, in Œuvres, op. cit., p. 1444). C’est
la théorie de la vérité-copie (cf. André Lalande, L’Idée de vérité, in Revue
Philosophique, janvier 1911, p. 3 ; Émile Durkheim, Pragmatisme et
Sociologie, Vrin, 1955, p. 45).
Mais si « la réalité coule » (ligne 20), c’est-à-dire si elle ne cesse de varier et
de devenir, la conception de la vérité évoquée au début du texte se révèle
insoutenable.
a) En effet, comment la vérité, qui est quelque chose de stable – une loi
scientifique est en effet définie comme un rapport constant, invariable entre
certains phénomènes. La loi scientifique selon laquelle « la chaleur dilate les
corps » n’est pas vraie un jour et l’autre non – pourrait-elle être à l’image
d’une réalité qui, elle, est perpétuellement mouvante et changeante ?
b) De plus, l’expérience ne nous donne que des cas particuliers, alors que
les vérités scientifiques sont des propositions universelles, valables pour tous
les cas qui tombent sous la loi. Elles ne sauraient donc copier le réel
(Bergson, La Pensée et le Mouvant, in Œuvres, op. cit., p. 1444-1445).
c) Enfin, comme l’avait déjà remarqué Kant, si la connaissance est conçue
comme une simple image du réel, comment peut-elle alors justifier sa
prétention à le représenter exactement ? Si l’objet lui est extérieur, comme
l’affirment les partisans du réalisme, par quel moyen garantir la conformité
de la copie au modèle extérieur ? Pour juger en effet de cette conformité, il
faudrait disposer d’un poste intermédiaire entre la pensée et l’objet, d’où
l’on pourrait comparer l’une à l’autre, comme on compare un portrait avec
l’original qu’il reproduit. Or, remarque Kant, il y a là une prétention
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%