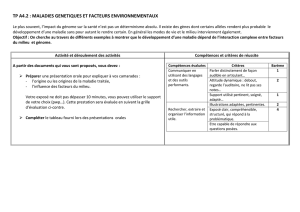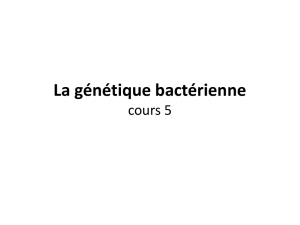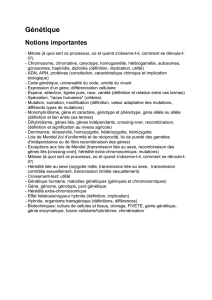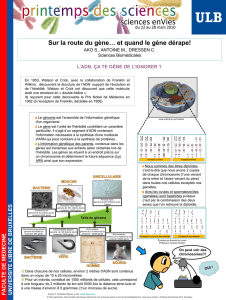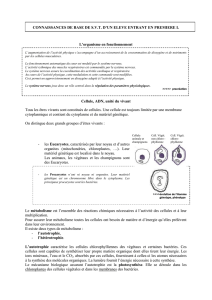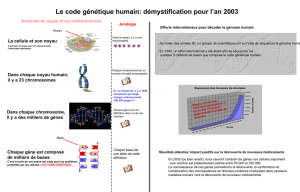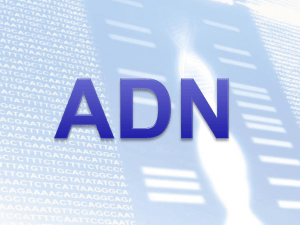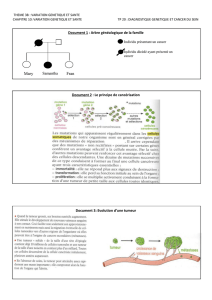on a séquencé le génome humain - Site SVT - Aix

Recherche
On a séquencé le génome humain !
Entretien avec Bertrand Jordan
Comme l'a été la conquête de la lune pour les années 60, le
séquençage du génome humain est le
grand programme scientifique de notre époque.
Une prouesse technologique qui a vu les laboratoires
impliqués dans cette recherche multiplier par dix leurs performances en deux ans ! De quoi s'agit-il
?
Le génome est l'ensemble de l'ADN (acide désoxyribonucléique) d'un organisme
vivant, qui contient
des messages génétiques de toutes natures. On appelle
séquençage la détermination de l'ordre des
nucléotides, les unités élémentaires
des ADN. Dans un climat de sévère compétition entre privé et
public, l'entreprise Celera a déjà annoncé détenir toutes les séquences mais pas dans
l'ordre ! De son
côté, le consortium international de laboratoires publics dit
posséder, en bon ordre, plus de 70 % du
génome humain. Au-delà des effets
d'annonce, d'ores et déjà "la recherche sur le génome humain a
produit une quantité impressionnante de résultats" souligne Ségolène Aymé. Il faut
s'interroger sur la
portée de ce qu'Antoine Danchin n'hésite pas à qualifier de
"révolution génomique". A partir de la
connaissance de la réalité dans ce
qu'elle a de complexe et de multiforme, sans impasse sur les
incertitudes de la recherche ni sur les contradictions sociales qu'engendrent ses avancées. Enjeux
?
Un impact majeur sur la société, son système de soins, un bouleversement de
l'organisation de la
recherche, de nouvelles questions éthiques, etc. Sans
oublier, bien sûr, des appétits financiers
aiguisés, à l'origine d'une véritable guerre économique dont Nicolas Chevassus-au-
Louis décrit les
dernières péripéties. Et puis, ce n'est pas le moindre, la façon dont on définit l'être
humain, son
comportement, son caractère. Comme le montre Bertrand Jordan, les
généralisations du "tout
génétique" sont trompeuses. Il faut se garder de
confondre prévision statistique et destin individuel :
le nôtre n'est pas inscrit dans nos gènes. L'hérédité et l'environnement, l'inné et l'acquis
interviennent
en proportions variables et souvent difficiles à définir, l'une ou
l'autre peuvent prédominer selon les
situations, c'est leurs interactions qui s'avèrent déterminantes. Avec le séquençage qu'apprend-
on sur
l'être humain, ses
maladies, son caractère, sa sexualité ? Quels sont les nouveaux horizons de la
biologie ? Que peut-on attendre pour la santé, diagnostic et thérapie ?
Le séquençage du génome humain est quasiment terminé. Est-ce le fin mot de l'humanité ? Est-
ce la clé pour tout connaître sur
l'Homme (ses maladies, son caractère, sa sexualité, son avenir,
etc.) comme on l'entend souvent ?
Bertrand Jordan : Non, bien sûr,
ce n'est pas "le fin mot de l'humanité". Le patrimoine génétique,
l'assortiment des versions (allèles) de gènes, dont nous héritons de nos parents intervient,
tout
comme notre environnement, notre histoire personnelle, les circonstances
économiques et sociales...
C'est de l'ensemble de ces éléments (et de leurs
interactions) que découlent finalement maladies,
caractère, sexualité... Mais il existe actuellement une forte tendance à tout attribuer au déterminisme
génétique : la mutation d'un gène rendrait fatalement malade ou homosexuel ou
criminel ; l'ensemble
des traits de l'individu (santé, caractère, comportement)
découlerait fatalement du patrimoine
génétique. Il s'agit là manifestement d'une
interprétation biaisée d'avancées scientifiques bien réelles.
Le débat à la fois idéologique et scientifique sur les rôles de l'hérédité et de l'environnement ne
date
pas d'hier. La fin du XIXe siècle et le début du XXe ont été dominés par
les théories eugénistes. Le
rejet du nazisme a conduit à privilégier les
explications selon lesquelles le comportement humain
résulterait avant tout des circonstances familiales, économiques ou sociales. Cette vision a parfois été
poussée à l'absurde dans les décennies d'après-guerre en attribuant par exemple
une responsabilité
écrasante aux parents d'enfants autistes ou attardés mentaux.
Mais l'actuel renouveau de crédit
apporté aux données génétiques va si loin que
l'ambiance à cet égard peut ressembler à celle des
années vingt ou trente ! Les raisons de ce raz-de-
marée du "tout génétique" sont aussi, et peut être
surtout, sociales et idéologiques. Avec le triomphe mondial du capitalisme, auquel ne
s'oppose plus
aucune alternative, nos sociétés marchandes tendent à se décharger
de toute responsabilité dans le
Page
1
of
3
REGARDS
-
On a séquencé le génome humain !
29/01/2009
http://www.regards.fr/article/print/?id=1955

devenir des individus. Elles accueillent donc
favorablement des théories qui attribuent le destin des
personnes à leurs gènes plutôt qu'à leur éducation, leur environnement et leur condition sociale, y
trouvant une justification "biologique" à l'existence d'inégalités qui tendent à
s'accroître, et en tirant
d'excellents arguments pour écarter les mesures,
forcément coûteuses, qui pourraient limiter cette
dérive. Ce n'est pas un hasard si cette tendance prévaut aux Etats-Unis.
Mais que peut-on en dire d'un point de vue scientifique ?
B.J. : C'est une erreur grossière qui consiste à
généraliser à partir de quelques cas où, en effet, une
certaine mutation dans un
certain gène entraîne systématiquement une maladie. Par exemple, une
maladie neurologique incurable, la chorée de Huntington, dépend d'un déterminisme
génétique très
fort. Si le gène est muté, la personne sera atteinte de cette
maladie, il n'y a pas de marge. La mutation
peut être décelée très tôt dès
l'enfance et la maladie apparaîtra vers 40 ans.Mais ce n'est pas le cas
général. Dans la plupart des maladies dites "génétiques", les gènes peuvent être altérés
de plusieurs
façons : il y a la version standard d'un gène que l'on retrouve
chez la grande majorité des personnes
"normales" et différentes variantes plus
ou moins fonctionnelles. Concernant, par exemple, la
mucoviscidose, plus de 600
anomalies ont été répertoriées. De plus, la même mutation n'a pas le
même effet
suivant les individus. Pour une même anomalie, une personne peut être gravement
malade et d'autres légèrement ou pas du tout atteintes ! L'effet du gène
dépendra de l'interaction avec
d'autres gènes et de très nombreux facteurs non
génétiques tels que la grossesse, l'alimentation,
l'histoire personnelle, etc.
Pour l'hémophilie qui dépend souvent d'une même défectuosité assez
simple, dont l'effet est constant, le résultat pour la personne dépend complètement de
l'époque et de
la société : avant 1950, il n'y avait pratiquement pas de
traitement, ensuite en moins d'une génération,
l'affection a été presque
entièrement contrôlée avec les produits coagulants, puis l'apparition du Sida
et la tragédie du sang contaminé ont entraîné la mort de la moitié des hémophiles
en France. L'état de
santé ne dépend pas que de la mutation d'un gène mais bien
de conditions sociales qui déterminent
l'accessibilité d'un traitement ou la
qualité du contrôle sanitaire. Tout cela renvoie à la différence
fondamentale entre génotype (ce qui est inscrit dans les gènes) et phénotype (l'état de la
personne à
un moment donné de son histoire). Notons enfin que la prédisposition
à une maladie n'indique en
rien l'état de la personne. Selon la version d'un
gène, une personne aura cinq fois plus de risques
d'être diabétique. Et des
employeurs ou des assureurs pourraient la considérer comme une personne
malade. Mais si en moyenne le risque d'être diabétique est de 1 %, il ne sera que de 5 %
pour cette
personne : elle aura donc 95 % de chances de ne pas être malade
!Quant au déterminisme génétique
de traits de caractère ou de l'orientation
sexuelle, c'est un domaine où la plupart des "résultats"
obtenus (et abondamment médiatisés) ont été contredits par les études ultérieures...
S'agit-il d'une révolution en biologie, à mettre au
rang des découvertes capitales comme par
exemple celle de l'ADN ? Quelles sont
les grandes questions qui demeurent et les nouveaux
horizons qui s'ouvrent à la biologie ?
B.J. : C'est effectivement une étape
capitale, et dont beaucoup pensaient qu'elle ne serait pas atteinte
si vite. C'est une découverte "programmée", moins nouvelle, moins imprévue que celle de
la
structure de l'ADN, mais elle aura certainement beaucoup de conséquences en
biologie. Le fait
d'avoir des sortes d'atlas des gènes accélère les travaux sur
de grandes questions fondamentales de la
biologie. La question du développement : comment un organisme complexe se développe-t-
il à partir
d'une seule cellule ? Celle de l'évolution : quels sont les mécanismes de filiation entre des
organismes différentes ? Sur ces deux questions, la comparaison entre les
séquences d'ADN humains
et d'autres organismes amènent des progrès rapides. On
trouvera plus facilement chez la mouche que
chez l'Homme, les gènes qui
gouvernent le développement. Et on pourra chercher ce qui dans le
génome humain ressemble à leur séquence complète. On va directement du mutant de la mouche
drosophile à l'identification chez l'Homme du gène impliqué dans le
développement. C'est une
grande accélération et un changement de nature de la
recherche biologique qui repose moins sur des
expérimentations et davantage sur
des similitudes repérées avec de puissants outils informatiques.
Pour
l'évolution, on se basera sur la proximité des séquences d'ADN. En revanche, en
neurobiologie,
Page
2
of
3
REGARDS
-
On a séquencé le génome humain !
29/01/2009
http://www.regards.fr/article/print/?id=1955

l'apport immédiat de la génétique est moins évident.
Du point de vue de la santé, quelles sont les
promesses en termes de prévention et en termes de
thérapie ?
B.J. : En termes de diagnostic individuel, des progrès
très rapides sont à attendre. La généralisation
sous forme de dépistage est plus
ou moins possible selon les cas (problème des multiples mutations
possibles). Les progrès en thérapie (qui en découleront certainement) sont à plus long
terme, qu'il
s'agisse de thérapie classique ou de thérapie génique. Donc on peut
prévoir un accroissement du
décalage entre diagnostic et thérapie, qui pose des
problèmes psychologiques et économiques tout à
fait sérieux. En reprenant
l'exemple de la chorée de Huntington, il faut distinguer la localisation du
gène, qui a été effectuée en 1983 et a aussitôt permis un diagnostic prénatal ou
présymptomatique, de
l'isolement effectif du gène qui n'est intervenu qu'en 1993. Et dix-
sept ans après, on commence à
peine à comprendre son
fonctionnement. Ce n'est qu'au terme d'expériences longues et laborieuses
que peut venir un traitement. Quant à la thérapie génique, cette approche
prometteuse se révèle plus
délicate que prévu. Tout ce que nous savons faire
aujourd'hui, c'est intégrer un gène au hasard, en un
point quelconque d'un
certain chromosome : on ne remplace pas le gène défectueux mais on rajoute
un gène équivalent et fonctionnel ailleurs dans le génome. On a cru aboutir à un
traitement en faisant
l'économie d'une étude détaillée de la manière dont le
défaut d'un gène entraîne une maladie mais
cette compréhension s'avère aujourd'hui indispensable. n
* Directeur de recherches au CNRS, anime une équipe du Centre d'immunologie de Marseille-
Luminy ; vient de publier les Imposteurs de la génétique, Seuil, collection Science ouverte, 178p,
95
F.
1er mai 2000 - Jean-Claude Oliva
www.regards.fr
Page
3
of
3
REGARDS
-
On a séquencé le génome humain !
29/01/2009
http://www.regards.fr/article/print/?id=1955
1
/
3
100%