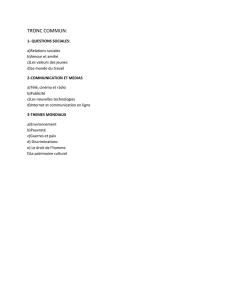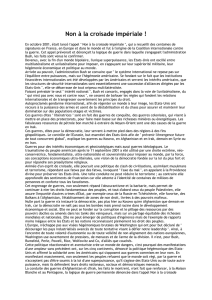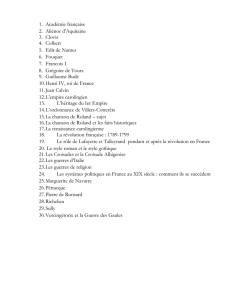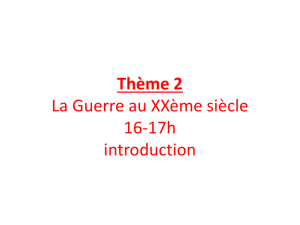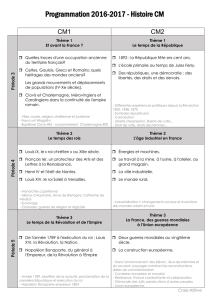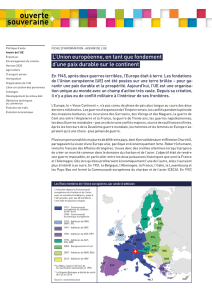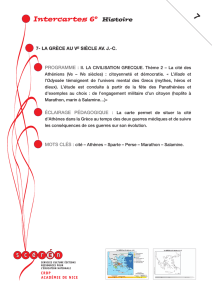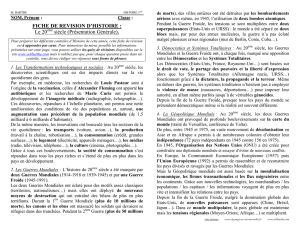Le Monde, De l`usage de la guerre en politique (19 nov. 2015)

Le Monde 2015_11, De l’usage de la « guerre » en politique
De l’usage de la « guerre » en politique
Soudain, la guerre a fait irruption dans nos vies. Le mot est sur toutes
les lèvres, à l’Assemblée nationale comme dans les studios de
télévision. Il est sur tous les petits écrans que nous consultons à
longueur de journée. Il est, désormais, dans nos têtes.
Dès le soir des attaques du 13 novembre, et avant même que le bilan
n’atteigne 129 morts, le président François Hollande a parlé
d’un « acte de guerre ». Il est allé plus loin les jours suivants, utilisant
pour la première fois le mot « armée » pour qualifier les auteurs des
attentats, l’organisation Etat islamique (EI) : une « armée terroriste »,
une « armée djihadiste ». Evitant l’expression « armée islamiste », qui
aurait donné une dimension religieuse à cette « guerre » – même si,
littéralement, djihad veut dire « guerre sainte ». « La France est en
guerre », a de nouveau martelé le président de la République le
16 novembre, devant les parlementaires réunis en Congrès à Versailles.
Lire aussi : « Nous sommes dans un état mal descriptible
entre la guerre et la paix »

La guerre, la France la connaît bien, depuis des siècles. La célébration,
en 2014, du centenaire du début de la première guerre mondiale, la
première aussi à massacrer les gens par millions, a donné lieu à
d’émouvantes et sincères cérémonies auxquelles ont très largement
participé les Français. Les anniversaires des dates marquantes de la
seconde guerre mondiale sont d’autant plus suivis que de nombreux
survivants sont encore parmi nous et en entretiennent la mémoire
orale.
C’est essentiellement cela, la guerre, dans l’imaginaire collectif : des
conflits armés entre Etats, à l’appui de revendications territoriales ou
de velléités de conquête, avec un début (déclaration de guerre) et une
fin (armistice). Clausewitz, le grand théoricien prussien de la guerre, la
définissait au XIXe siècle comme la continuation de la politique d’Etat
par d’autres moyens – en l’occurrence la violence.
L’émergence de la « guerre asymétrique »
Plus enfouies dans la mémoire française, bien que plus récentes, les
guerres coloniales et les guerres d’indépendance sont perçues comme
des guerres de contre-insurrection plutôt que comme des guerres
interétatiques ; l’ennemi aspirait, précisément, à devenir un Etat, mais
n’en avait pas encore le statut. Ce fut même parfois des guerres
censurées, comme lorsqu’il fallait parler pudiquement
des « événements d’Algérie » : officiellement, ce n’était pas une guerre.
Ce type de conflits a consacré l’émergence de la « guerre
asymétrique », dans laquelle les adversaires ne sont pas de même
nature. Et un nouveau type de rapport de forces : l’asymétrie ne
garantit pas nécessairement la victoire de ceux qui ont la supériorité
des forces !conventionnelles, comme l’ont prouvé, au détriment de
deux superpuissances, la guerre du Vietnam, que les Etats-Unis ont
perdue, et la guerre d’Afghanistan, pays dont les Soviétiques ont fini
par se retirer.
Consciente de la nécessité d’éviter la répétition de l’horreur des deux
guerres mondiales, la communauté internationale s’est organisée à
partir de 1945 en créant l’ONU ; le multilatéralisme est devenu la règle
pour gérer les relations internationales, et l’arme nucléaire, utilisée par
les Américains à Hiroshima et Nagasaki, a imposé la dissuasion

comme technique de limitation des affrontements militaires.
La guerre n’a pas disparu complètement, mais c’est un affrontement
sans violence généralisée qui oppose les deux blocs issus de la seconde
guerre mondiale : cette guerre-là est contrôlée, froide. L’Europe, elle,
s’est préservée de nouveaux désastres en construisant, sous
l’impulsion de la France et de l’Allemagne, une union institutionnelle.
La guerre froide prendra fin pacifiquement, symbolisée par un mur
que le peuple abat, à Berlin. L’empire soviétique s’écroule, presque
paisiblement, sous le poids de sa propre incompétence, deux ans plus
tard, en 1991.
Pour les Français, le XXe siècle s’achève sur les guerres des Balkans,
barbares et meurtrières, mais localisées et sans incidence sur le sol
français. Elles témoignent de l’affirmation d’une nouvelle justification
d’interventionnisme, la guerre d’ingérence, qui va déboucher sur le
débat juridique de « la responsabilité de protéger ».
Accent mis sur la paix
Pendant la dernière décennie du XXe siècle, pas moins de huit
interventions militaires menées au nom de la communauté
internationale affichent un objectif humanitaire, qui l’emporte
largement sur la justification sécuritaire (Somalie, Haïti, Bosnie-
Herzégovine, Rwanda, Sierra Leone, Kosovo, Timor oriental, RDC),
comme le souligne un excellent ouvrage collectif sur cette
question, Justifier la guerre ?, dirigé par Pierre Hassner et Gilles
Andréani (Presses de Sciences Po, 2013).
A l’aube du XXIe siècle, l’Europe aborde donc un monde où la guerre
interétatique est de plus en plus rare. Mieux : on « euphémise » la
notion de conflit, remarque Camille Grand, directeur de la Fondation
pour la recherche stratégique à Paris. L’accent n’est plus mis sur la
guerre mais sur la paix, qu’il faut « imposer », puis « maintenir », dans
le jargon des institutions internationales. On ne parle pas de guerre,
on est dans la « gestion de crises », dans la « prévention de conflits »
ou, à défaut, la « résolution de conflits ».

Cette construction intellectuelle, politique et juridique de l’après-
guerre froide bascule, le 11 septembre 2001, dans les ruines des Twin
Towers du World Trade Center de New York, pulvérisées par Al-Qaida.
Pour déloger les talibans, sponsors d’Al-Qaida, de leur base en
Afghanistan, les Etats-Unis de George W. Bush se parent des couleurs
du multilatéralisme, invoquant le droit à la légitime défense,
individuelle et collective, prévu par l’article 51 de la Charte des Nations
unies. Ils mobilisent les alliés de l’OTAN en vertu de l’article 5 du traité
de Washington. « On observe alors, se souvient Camille Grand, un
glissement juridique vers le domaine de la guerre. » Et pas seulement
juridique : « Il s’agissait de mobiliser contre le terrorisme des moyens
militaires pour des tâches qui, jusque-là, relevaient de la police et des
services de renseignement », donc de forces civiles.
Nouvel ordre juridique
Sous couvert de « coalition », c’est bien, en réalité, la puissance
américaine elle-même qui mène cette guerre en Afghanistan. Et, cette
fois, le sécuritaire a pris le dessus sur l’humanitaire. La preuve : le mot
« guerre » a refait surface. Le président Bush proclame la « guerre
globale contre la terreur », qui a même son acronyme, GWOT (Global
War on Terror). L’Amérique se sent en guerre, orne ses rues et ses

maisons de bannières étoilées, fait corps avec ses troupes. La guerre à
l’extérieur se double d’une offensive juridique visant à protéger le pays
et sa population du terrorisme : c’est le Patriot Act, arsenal législatif
sécuritaire adopté par le Congrès dans la foulée des attentats, et qui
restreint les libertés publiques.
Le « glissement juridique » évoqué plus haut fait naître de nouveaux
concepts, comme celui de « combattant ennemi », qui permet
d’échapper aux conventions de Genève sur les prisonniers de guerre.
La CIA commet de sérieuses entorses au droit international en
acheminant secrètement dans des pays alliés des suspects interpellés
en Afghanistan, qui vont être interrogés dans des prisons secrètes
sous-traitées à ces pays. La création la plus spectaculaire de ce nouvel
ordre juridique de la guerre antiterroriste est le camp de Guantanamo,
ouvert en janvier 2002, où les suspects, détenus sans jugement,
subissent des interrogatoires pour lesquels une forme de torture est
autorisée et qui, malgré les engagements pris par le président Barack
Obama, n’est toujours pas fermé à ce jour.
L’invasion puis l’occupation de l’Irak par l’armée américaine et
quelques pays alliés, à partir de 2003, poussent cette logique encore
plus loin. La justification initiale, qui est de lever la menace –
imaginaire – d’armes de destruction massive abritées par le régime de
Saddam Hussein, se transforme en un objectif de changement de
régime. Les Etats-Unis font la guerre, cette fois-ci, sous couvert de
promotion de la démocratie – guerre qui se solde par un fiasco total, et
dont le monde arabo-musulman et l’Europe paient encore les
conséquences.
Ennemi invisible
Férocement combattue, la nébuleuse Al-Qaida a essaimé. Aujourd’hui,
c’est l’EI qui, se nourrissant du chaos créé par la désintégration des
Etats au Moyen-Orient, menace les pays occidentaux et les régimes
arabes sunnites. Conçu au XXe siècle pour faire face aux guerres
interétatiques, l’ordre juridique international est dépassé. Et la
manière dont les Etats belligérants tentent de s’adapter à ce nouveau
type de guerres asymétriques entre en conflit avec le retour de la
morale dans la vie internationale de l’après-guerre froide, illustré
notamment par la montée de l’exigence d’une justice internationale.
 6
6
1
/
6
100%