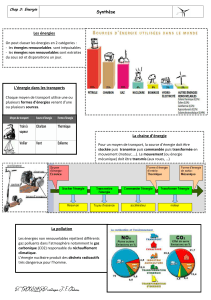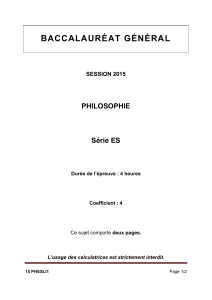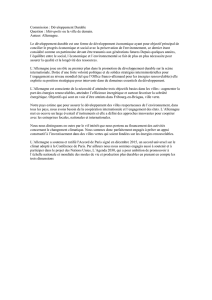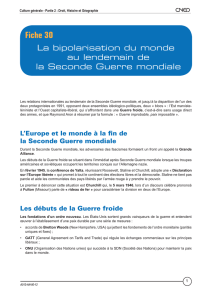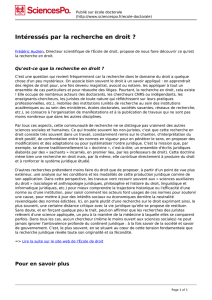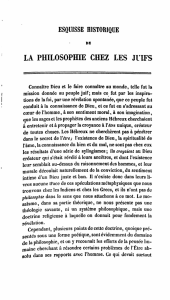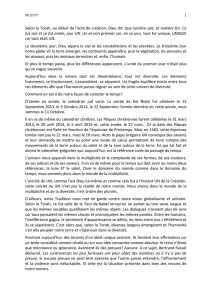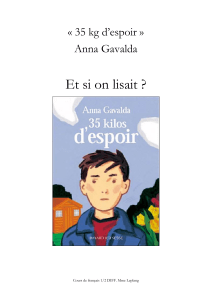cette page - Palamas und Akindynos

Présentation du projet
Titre
Acindynus et Palamas en dispute des énergies divines. Édition, traduction et analyse des œuvres principales de
la controverse (Epistula III de Palamas avec commentaire d’Acindynus, Antirrhetici des deux auteurs).
Contenu
Grégoire Acindynus et Grégoire Palamas sont les acteurs principaux des polémiques théologiques et ecclésias-
tiques qui agitaient tout l’Empire byzantin dans les années 1340. Dans la recherche scientifique, on parle au choix
des « querelles palamites », de la « controverse hésychaste » ou bien de la « dispute des énergies ». Pour la
légitimation théologique de la prière des moines contemplatifs, appelés hésychastes, et pour prouver que leurs
« visions de lumière » font véritablement parties de Dieu, Palamas reprit la distinction de l’Eglise ancienne entre
essence (ousía) et énergie (enérgeia) qu'il comprenait comme distinction réelle en Dieu. Ses adversaires, parmi
eux Acindynus, voyaient l’image de Dieu trinitaire-personnelle mise en danger à cause de cette distinction et
reprochaient dithéisme et polythéisme à Palamas. Tandis que la doctrine de Grégoire Palamas suscita un grand
intérêt autant dans la théologie orthodoxe moderne (surtout dans le soi-disant « néopalamisme » du 20ème siècle)
que dans la recherche occidentale de l’histoire du dogme, l’influence de Grégoire Acindynus dans l’histoire et la
recherche est éclipsée par les adversaires plus puissants de Palamas, Barlaam de Seminara et Nicéphore Gré-
goras, quoique ce premier ne participât plus aux discussions dans la phase la plus intense des polémiques autour
de la doctrine des énergies (1341-1351) et quoique ce dernier soit entré en controverse seulement après la mort
d’Acindynus en 1348. Le but de ce projet de recherche interdisciplinaire et interconfessionnel est la reconstruction
détaillée des différences théologiques relatives à la question de l’énergie divine entre Palamas et Acindynus, à
l’aide d’œuvres centrales, afin de prendre conscience d’Acindynus comme acteur et penseur indépendant et de
contextualiser la doctrine de Palamas et, ce faisant, de la présenter comme résultat d’un processus discursif. À
cette fin seront examinées des œuvres des deux auteurs qui donnent un aperçu immédiat de la controverse :
d’une part l’Epistula III de Palamas à Acindynus qui amena ce dernier à se détourner de la théologie de son an-
cien maître Palamas et qui fut transmise dans deux versions, avec un commentaire d’Acindynus; d’autre part les
écrits polémiques appelés Antirrhetici des deux auteurs dans lesquels les arguments théologiques principaux
sont développés et qui démontrent comment cette doctrine combattue fut reçue et (mé-)comprise de part et
d’autre. Les résultats des recherches seront publiés de manière différente : il est prévu de créer (1) une présenta-
tion synoptique digitale des versions de l’Epistula III de Palamas avec le commentaire réfutant d’Acindynus, (2)
l’editio princeps des Antirrhetici contra Palamam d’Acindynus en forme de livre, (3) ainsi qu’un rapprochement
monographique des doctrines des énergies divines d’Acindynus et de Palamas sur la base des Antirrhétiques.
Puisque la doctrine dite palamite des énergies – canonisée à la fin des affrontements par un synode à Constanti-
nople en 1351, alors qu’Acindynus fut explicitement condamné – joue également un rôle considérable pour les
discours œcuméniques d’aujourd’hui entre les églises orientales et occidentales, le projet de recherche est impor-
tant non seulement pour la reconstruction de la controverse historique, mais il peut aussi engendrer des pistes
pour les discussions actuelles. Pour cela, la composition du groupe de recherche semble être particulièrement
prometteuse pour deux raisons : d’une part la coopération d’une théologienne de tradition occidentale (K. Hey-
den) et d’un théologien gréco-orthodoxe (Th. Alexopoulos) évitera des intérêts de recherche liés à la confession
et des positions unilatérales ; d’autre part, les connaissances linguistiques disponibles permettent la réception et
la mise en relation des discours de recherche occidentaux et néogrecs (Th. Alexopoulos, R. Burri) ainsi que
russes (R. Burri, K. Heyden).
1
/
1
100%