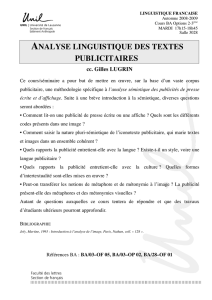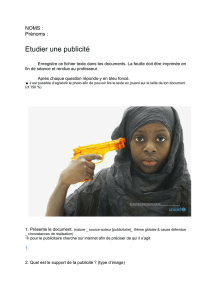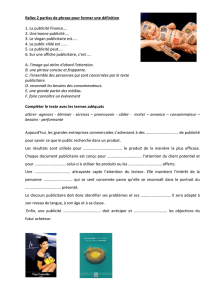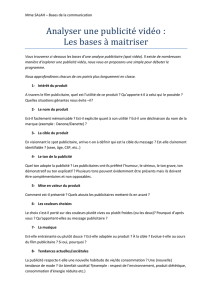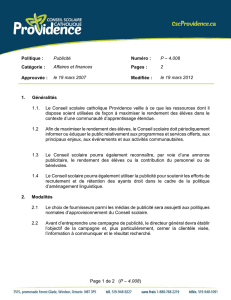UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE La publicité au passé

1
UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
ÉCOLE DOCTORALE V – Concepts et langages
GRIPIC – EA 14 98
T H È S E
pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
Discipline : Sciences de l’Information et de la Communication
Présentée et soutenue par :
Emmanuelle FANTIN
le : 4 décembre 2015
La publicité au passé
Approche communicationnelle d’une médiation ordinaire du passé
Sous la direction de :
Mme Karine BERTHELOT-GUIET, Professeure des Universités, Celsa Paris-Sorbonne
Membres du jury :
Mme Karine BERTHELOT-GUIET, Professeure des Universités, Celsa Paris-Sorbonne
Mme Marie-Emmanuelle CHESSEL, Directrice de Recherche, Sciences Po - CNRS
Mme Simona DE IULIO, Professeure des Universités, Université Lille 3
M. Yves JEANNERET, Professeur des Universités, Celsa Paris-Sorbonne
M. Frédéric LAMBERT, Professeur des Universités, IFP Université Panthéon-Assas
Mme Katharina NIEMEYER, Maître de conférences, IFP Université Panthéon-Assas

2
Position de thèse
Cette recherche en Sciences de l’Information et de la Communication interroge le
geste de médiation du passé par le discours publicitaire. Autrement dit, notre démarche
consiste à questionner les circulations du passé dans l’espace du discours marchand, en
cherchant à saisir les opérations résultant de cette association, et à comprendre quel type de
relation au passé s’instaure à travers la médiation spécifique de la publicité.
La problématisation d’une telle recherche présuppose une circonscription théorique
du passé apte à dépasser les pensées aporétiques du temps héritées de la philosophie.
L’intersubjectivité du marquage phénoménologique du temps nous conduit à le penser en
miroir comme un marquage culturel continuellement retravaillé qui vient surdéterminer son
observabilité. Nous appréhendons le passé à travers sa sémiotisation, et l’entendons comme
une pluralité de formes qui possèdent des propriétés favorisant une action perceptive
intersubjective de saisie d’une antériorité temporelle par rapport à notre champ de présence au
monde. La sémiotisation du passé repose ainsi sur la coordination d’opérations interprétatives
gouvernées par des phénomènes d’ajustement, constamment renégociés à travers une activité
communicationnelle qui lie perception, savoir et culture partagés. Si « le temps ne se parle
pas »1 et semble « plus impalpable que l’air atmosphérique »2, le passé demeure une catégorie
sémiotique qui se construit dans la souplesse d’une oscillation entre le temps court de
l’interprétation et la pérennité d’un assignement culturel qui permet de le normaliser, malgré
le flou abyssal qu’il recouvre potentiellement.
La médiation du passé dans la publicité ne peut pas se plier à une catégorisation qui
viendrait scléroser le principe de variété propre à toute création publicitaire, ni à un principe
d’unification qui viendrait tisser artificiellement des liens. Cette médiation est caractérisée par
une puissante diversité qui témoigne du pouvoir de modulation du discours publicitaire, et que
nous proposons de comprendre comme une prosodie singulière du passé. La métaphore
phonologique et poétique n’a pas pour objectif d’affirmer qu’il existerait des règles que nous
pourrions découvrir et mettre au jour sous forme de typologie. Au contraire, nous proposons
1 Gonord, Alban, Le Temps, Flammarion, Paris, 2001, p. 47
2 Jankélévitch, Vladimir, L’Irréversible et la nostalgie, Flammarion, Paris, 1974, p. 15

3
de saisir la médiation du passé comme le siège de potentielles inflexions, accentuations,
rythmiques ou encore tonalités toujours renouvelées par un travail créatif propre au discours
publicitaire, mais dans le même mouvement, ancrée dans une reconnaissance de ses formes
sédimentées dans le temps long. Parler de prosodie du passé, c’est donc mettre l’accent sur la
trivialité3 de ses modalités symboliques à travers sa médiation publicitaire.
Cette prosodie devient le siège de croyances d’un certain savoir du passé,
constamment disséminées par la médiation ordinaire qu’est le discours publicitaire. Le
discours publicitaire est en effet un objet d’une banalité désarmante, qui « glisse ainsi autour
de nous, comme nous glissons le long de nos meubles, de nos pièces »4. De cette
omniprésence découle un double sentiment d’évidence : évidence de la publicité, qui à force
de répétition, disparaît par son trop-plein de présence ; évidence aussi de son imagerie, qui
recourt à notre culture et vient dans ce geste constant naturaliser ses représentations. Nous
considérons avec Baudrillard que la publicité est un « effecteur d’idéologies »5, qui se fonde
sur la « selffulfilling prophecy (la parole qui se réalise par sa profération même) […] l’art de
rendre les choses vraies en affirmant qu’elles le sont »6. Dans cette perspective, en tant que
tiers-médiateur du passé, le discours publicitaire devient un « système symbolique
sanctionné »7 du passé, c'est-à-dire qu’il consiste à « attacher à des symboles (à des
signifiants) des signifiés (des représentations, des ordres, des injonctions ou incitations à faire
ou à ne pas faire, des conséquences – des significations, au sens lâche du terme) et à les faire
valoir comme tels, c’est-à-dire à rendre cette attache plus ou moins forcée pour la société ou
le groupe considéré »8. Cela nous conduit à interroger la force médiationnelle du discours
publicitaire à travers sa capacité à faire d’une catégorie phénoménologique le levier de
croyances culturelles naturalisées, et formuler notre problématique de la manière suivante :
3 La notion de trivialité est ici entendue au sens défini par Yves Jeanneret, à savoir en son sens étymologique (du
latin trivium qui signifie carrefour) et non axiologique. Elle désigne « le fait que les objets et les représentations
ne restent pas fermés sur eux-mêmes mais circulent et passent entre les mains et les esprits des hommes » et
« suggère que ces objets s’enrichissent et se transforment en traversant les espaces sociaux. Et même qu’ils
deviennent culturels par le fait même de cette circulation créative. » Jeanneret, Yves, Penser la trivialité. La vie
triviale des êtres culturels, Hermès-Lavoisier, Paris, 2008, p. 14
4 Barthes, Roland, « Société, imagination, publicité », Œuvres complètes. Tome 3, Seuil, Paris, 2002, pp. 60-72,
p. 62
5 Baudrillard, Jean, Pour une critique de l’économie politique du signe, Gallimard, Paris, 1972, p. 207
6 Baudrillard, Jean, La Société de consommation, ses mythes, ses structures, Gallimard, Paris, 1970, p. 197.
L’auteur souligne.
7 Castoriadis, Cornelius, L’Institution imaginaire de la société, Seuil, Paris, 1975, p. 174
8 Ibid., pp. 174-175

4
dans quelle mesure le discours publicitaire, en tant qu’espace de renégociation ordinaire du
passé, construit-il une prosodie singulière qui vaudrait pour savoir du passé ?
Nos hypothèses se déploient autour de trois lieux de médiation du passé, articulés par
effet de porosité avec trois ordres instituants : la mémoire, l’histoire, le patrimoine. Les lignes
de partage entre ces territoires du savoir ne constituent pas seulement des relations
d’oppositions et de distinctions, elles dessinent un paysage raisonné au sein de la trivialité du
passé et rappellent également que le savoir est toujours symboliquement situé : il s’articule
autour d’un lieu de production et d’une forme énonciative spécifique.
Une première hypothèse propose de lire cette médiation à travers ses dynamiques
mémorielles. La mémoire ne constitue pas une essence éthérée de la présence du passé, nous
l’envisageons avec Michel de Certeau comme un support mobile et mobilisable du passé :
« Comme les oiseaux qui ne pondent que dans le nid d’autres espèces, la mémoire produit
dans un lieu qui ne lui est pas propre. […] Sa mobilisation est indissociable d’une altération.
Bien plus, sa force d’intervention, la mémoire la tient de sa capacité même d’être altérée –
déplaçable, mobile, sans lieu fixe »9.
Aussi la mémoire permet-elle de véhiculer matériellement, symboliquement,
fonctionnellement, un certain regard sur le passé. Notre première hypothèse peut être
formulée ainsi : en tant que « tiers-médiateur » du passé, le discours publicitaire opère une
actualisation et un figement de la mémoire culturelle à travers la production d’imaginaires
du passé.
Nous pensons que ces imaginaires du passé produits et actualisés par la publicité
permettent d’envisager celle-ci comme un « médiateur semi-professionnel de l’histoire »10. La
médiation du passé dans la publicité serait alors subordonnée à une croyance en l’histoire,
dont elle mobilise les formes symboliques par effet d’ajustement. En d’autres termes, nous
posons pour deuxième hypothèse que les imaginaires du passé convoqués et stabilisés par la
publicité se donnent à lire comme une forme de savoir historique. L’histoire est ici entendue
hors de son acception disciplinaire ; rappelons qu’« avant d’être une discipline scientifique,
9 de Certeau, Michel, L’Invention du quotidien. Tome 1, Arts de faire, Gallimard, Paris, 1990, p. 131
10 Le Goff, Jacques, Histoire et mémoire, Gallimard, Paris, 1988, p. 222

5
comme elle le prétend et comme elle l’est effectivement jusqu’à un certain point, l’histoire est
une pratique sociale »11.
Enfin, notre dernière hypothèse interroge plus précisément l’acte de médiation du
passé institué par la publicité. Le processus de patrimonialisation provient du geste double de
la rupture de la continuité mémorielle et de la présence d’un objet passé dans le présent12. Le
geste de patrimonialisation se situe dans cet acte qui qualifie le rapport à l’objet et au temps.
Aussi le passé devient-il dans les dispositifs médiatiques tels que la publicité un construit
social et un fait communicationnel qu’il faut interroger en tant que tels. A travers la
cristallisation et la diffusion des représentations du passé, la publicité participe à la
transmission d’un certain patrimoine historique : « C’est parce qu’il est attesté par l’histoire
mais reconstruit par ses médiations ordinaires que l’objet patrimonial a une valeur symbolique
particulière »13. Nous considérerons donc que par son geste de sélection, de mise en visibilité
et de transmission du passé, la publicité opère également une médiation patrimoniale.
L’articulation de ces trois échelles – mémorielle, historique et patrimoniale – permet
de dévoiler les spécificités de la médiation du passé mise en œuvre par le discours
publicitaire. Chacune apporte un regard distinct sur la publicité, et questionne à travers un fil
de trame unique « comment, né du commerce et retournant au commerce, le fait publicitaire
constitue, pendant ce trajet, un exercice général du signe qui dépasse son origine et sa fin ; en
un mot comment l’élaboration publicitaire […] est un travail à la lettre dialectique, visant à
disposer à l’intérieur des limites draconiennes du contrat commercial quelque chose de
proprement humain »14.
A la croisée de la sémiotique du discours15 et d’une approche linguistique du temps16,
la collecte des données repose sur un repérage des embrayeurs du passé dans le discours
publicitaire. L’étude empirique des trois hypothèses se fonde sur un corpus de publicités
télévisuelles, sélectionnées au cours de l’année 2012 et soumises à une analyse sémio-
11 Prost, Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Seuil, Paris, 2010, p. 13
12 Davallon, Jean, Le Don du patrimoine. Une approche communicationnelle de la patrimonialisation, Hermès
Lavoisier, Paris, 2006
13 Jeanneret, Yves, Penser la trivialité, op. cit , p. 192
14 Barthes, Roland, « Société, imagination, publicité », op. cit., pp. 60-61. Nous soulignons.
15 Fontanille, Jacques, Sémiotique du discours, Presses Universitaires de Limoges, Limoges, 2003
16 Benveniste, Émile, Problèmes du langage, Gallimard, Paris, 1966
 6
6
 7
7
1
/
7
100%