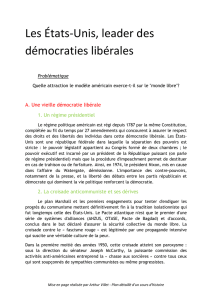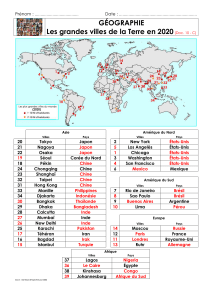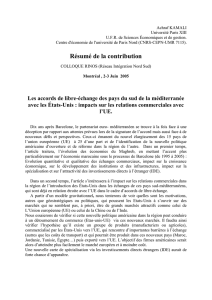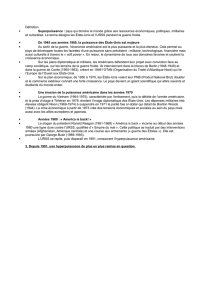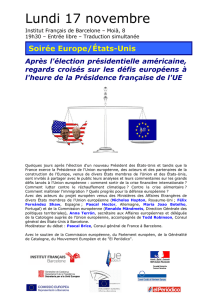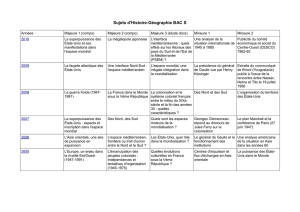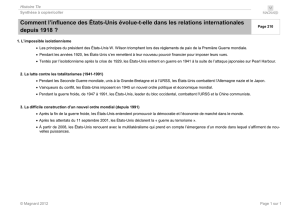France - États-Unis, la grenouilleet le bœuf?

France États-Unis
dossier
18 / octobre 2012 / n°425
Par Philippe Moreau Defarges
Robespierre 1970
Chercheur et co-directeur du rapport
Ramsès à l’Ifri (Institut français des relations
internationales).
L’inégalité domine le
rapport franco-américain.
Au lieu de rapprocher
les deux nations, leurs
similarités les éloignent.
Les États-Unis et la
France sont des États.
Ce qui les rapproche ou
les sépare, ce sont leurs
problèmes d’États.
Les commencements disent tout. Ainsi
est-il pour la France et les États-Unis. En
1775, la France de Louis XVI, faisant fi de
la solidarité monarchique, vole au secours
d’Insurgés républicains en rébellion contre
une métropole tyrannique. La France tient sa
revanche de l’humiliante défaite de la guerre
de Sept Ans en défendant la plus noble des
causes : la libération d’un peuple. Comme
la morale l’exige, l’Angleterre est vaincue,
les États-Unis accèdent
à l’indépendance. Mais
qu’a gagné la royauté
française ? L’opération est
d’un coût astronomique,
la banqueroute et donc la
Révolution se rapprochent.
Pour la jeune République
américaine, le partenaire
de cœur n’est pas, ne peut
pas être la France ; c’est
nécessairement l’Angle-
terre, la grande sœur avec les États-Unis
partagent tant : origine de la population,
langue et culture, passion pour le commerce
et la finance... La France rêve d’un lien
privilégié impossible avec cette Amérique
dont, de Chateaubriand à de Gaulle, elle
ressent vivement ou même durement
la grandeur colossale, qu’il s’agisse de
l’exubérance de sa nature ou de sa force
industrielle. Les États-Unis sont un géant
avec l’égocentrisme d’un géant.
Une insurmontable inégalité
L’inégalité domine le rapport franco-
américain. La France supporte mal de ne
pas être ressentie par les États-Unis comme
leur égal. Elle est la patrie de la Révolution,
escamotant (ou croyant escamoter) la
Glorious Revolution britannique (1689)
et ce que les États-Unis nomment leur
Révolution (guerre d’Indépendance, 1775-
1783). La France veut tant être la première
nation universaliste. Mais les États-Unis
sont ce qu’ils sont : créatifs, brutaux,
généreux et narcissiques. De plus, les deux
siècles de l’ascension des États-Unis (XIXe-
XXe) sont ceux où la France découvre qu’elle
n’est plus la Grande Nation.
Paris attire les Américains décadents :
milliardaires désenchantés, collectionneurs
raffinés, écrivains de la « Génération
Perdue » de Gertrude Stein... L’État
américain, lui, raisonne en première
puissance mondiale. En Europe, il y a
d’abord l’Angleterre, la
vieille complice dont les
Américains apprécient la
proximité si leurs intérêts
supérieurs l’autorisent.
Ensuite vient l’Allemagne,
la puissance qui, en 1917,
fait sortir Washington de
son isolationnisme, et
qu’il faut donc surveiller
attentivement. Et la
France ? C’est une alliée
parfois décevante, une perturbatrice
susceptible. Elle doit avoir sa place mais elle
ne peut effacer ses défaites, ses appels au
secours : en 1940, Paul Reynaud réclamant
en vain à Franklin D. Roosevelt des avions ;
en 1954, le gouvernement français espérant
un bombardement atomique pour sauver
Diên Biên Phu...
Tout au long de la Seconde Guerre mondiale,
Roosevelt et de Gaulle ne se supportent pas.
Pour le président américain, peu intéressé
par les subtilités françaises, le Général,
non élu, n’est qu’un mégalomane, un
aspirant-dictateur. De Gaulle, pleinement
conscient de ce que sont les États-Unis, et
chevalier autoproclamé de la France, est
constamment, douloureusement humilié
par ce mépris non dissimulé de celui qui se
voit devenir le maître du monde. Dans les
années 1980, Ronald Reagan et François
Mitterrand, en dépit de leurs différends
idéologiques, s’entendent admirablement,
le premier s’accommodant avec bonhomie
de son image d’acteur borné, le second
France - États-Unis,
la grenouille et le bœuf ?
Et la France ?
C’est une alliée
parfois décevante,
une perturbatrice
susceptible.

dossier
19
/ octobre 2012 / n°425
Aux États-Unis,
l’individu reste
l’homme de la
frontière, ne croyant
qu’en lui-même
En France, l’individu
s’édifie avec la
société, elle-même
entremêlée à l’État.
apparaissant ainsi comme le successeur
du Roi Soleil (en 1982, sommet du G7 à
Versailles).
Des convergences équivoques
Les similarités franco-américaines, au
lieu de rapprocher les deux nations, les
éloignent.
La démocratie est en principe commune
aux deux pays. En France, la démocratie
ne se dissocie pas de l’État, promoteur et
garant de l’égalité. La démocratie réside
dans la loi – mot le plus fréquent dans
la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789. Aux États-Unis, la
démocratie dépasse l’État et le conteste.
Ce qui fonde la démocratie en Amérique,
c’est la liberté de l’individu. L’oppo sition
de fond entre la conception française et
la conception américaine se manifeste
de manière éclatante sur la question
très significative des armes à feu. Aux
États-Unis, l’individu ne peut être privé
d’une capacité d’autodéfense (deuxième
amendement de la Constitution) ; d’où
l’acquisition très (ou trop) facile d’armes.
Au contraire, en France, la démocratie
requiert des individus désarmés, le recours
aux armes étant le monopole de la police.
Le contrat social démocratique est
radicalement différent
chez les deux peuples. En
France, rien n’échappe à
l’État, l’individu n’existe
que dans une société
étatique. Aux États-Unis,
le pacte reconnaît ses
limites ; la survie ultime
de l’individu dépend et
doit dépendre, dans des
circonstances extrêmes, de
lui seul. Derrière ces deux
représentations, se dessinent deux histoires
opposées : en France, l’individu s’édifie avec
la société, elle-même entremêlée à l’État.
Aux États-Unis, l’individu reste l’homme
de la frontière, ne croyant qu’en lui-même.
Soit l’État comme gardien indispensable,
soit l’État comme mal nécessaire. La crise
des années 2000 révèle pour la énième
fois ce fossé : en France, tout doit être fait
pour maintenir l’État-providence ; aux États-
Unis, le phénomène du Tea Party confirme
une méfiance viscérale de l’État, élément
essentiel de l’esprit américain.
La culture devrait tisser des liens entre
États-Unis et France, tous deux se posant
en terres de culture.
La France ? Cela va, semble-t-il, de soi,
d’abord pour les Français sûrs d’être la
nation culturelle par excellence, mais
aussi pour les Américains, au moins pour
les francophiles anxieux
de rassurer leurs amis
français. Être cultivé,
c’est parler français.
Ainsi Jackie Kennedy
fascinée (ou s’amusant à
être fascinée) par André
Malraux. Les États-Unis,
eux ne reconnaissant que
des preuves chiffrées,
avancent leurs univer-
sités, leurs artistes, leurs
capacités d’intégration, leurs fondations.
Néanmoins la convergence tourne vite à
l’aigre. Pour tant de Français, l’Américain
moyen est inculte, il n’y a pas de culture
américaine. En clair, cela signifie que les
Américains n’ont pas de goût (s’agirait-il
du goût français ?). Les créateurs majeurs
des États-Unis, d’Henry James à Woody
Allen, sont définis comme des Européens
cachés, incompris de leurs compatriotes.
La culture française, surtout depuis les
lendemains de la Seconde Guerre mondiale,
puise beaucoup dans la
richesse américaine. Mais
ces éléments nourriciers
sont décrétés issus de la
contre-culture, donc pas
vraiment « états-uniens » :
romans policiers, bandes
dessinées, hippies...
Ainsi Dashiell Hammett,
Jack Kerouac, William
Burroughs...
Pour les États, tout est
finalement géopolitique
Les États-Unis et la France sont des États.
Ce qui les rapproche ou les sépare, ce sont
leurs problèmes d’États. Les deux pays
n’ont pas toujours été amis. En 1861,
la France de Napoléon III, profitant de
la guerre de Sécession (1861-1865)1,
intervient militairement au Mexique, dans
l’arrière-cour des États-Unis ; ces derniers
sont furieux et soutiennent activement la
résistance mexicaine... jusqu’à la défaite
des Français.
Ce qui façonne l’alliance franco-américaine,
ce n’est pas une convergence philosophique
ou éthique, c’est le défi que, dans les
années 1890-1945, représentent l’Allema-
gne de Guillaume II puis celle de Hitler
pour l’Europe et le monde. La France
est directement menacée dans sa survie
comme État indépendant
par ce voisin vigoureux et
belliqueux. Les États-Unis,
eux, ne sont pas soumis à
un risque existentiel ; ils
sont protégés par deux
océans. Cependant,
alors que, dès la fin du
XIXe siècle, ils sont, très
loin devant les autres,
la première puissance
économique mondiale, ils
ne peuvent accepter une Eurasie dominée
par un ou des empires, susceptibles de leur
fermer cette partie du monde. En 1917,
les États-Unis, se rendant compte que la
Grande-Bretagne et la France ne peuvent
abattre l’Allemagne, entrent dans la guerre.
Face à l’Allemagne de Hitler puis à l’Union
soviétique, les États-Unis restent fidèles
à la même ligne : avoir une Eurasie, de
Brest à Vladivostok, ouverte aux échanges
mondiaux et non tenue par une ou des
puissances hostiles. Dans cette partie
mondiale, la France est un partenaire parmi
d’autres. Pour Washington, la France compte
comme l’un des membres importants de
l’Union européenne et comme un éventuel
fournisseur de troupes.
Comme il est douloureux de ne plus être
exceptionnel ! C’est justement ce que,
non sans mal, les États-Unis sont en train
d’apprendre avec la montée de la Chine et
d’autres... ■
1 - Les États-Unis appellent ce conflit leur « Civil War ». Pour eux, l’enjeu n’est
en rien un éclatement du pays mais, au contraire, la défense inconditionnelle de
son unité. Le qualificatif « guerre de Sécession » ne peut convenir à un citoyen
des États-Unis. Napoléon III envisage un moment de reconnaître le Sud comme
une entité souveraine ; il comprend vite que cet acte serait reçu par le président
Abraham Lincoln comme une déclaration de guerre !
1
/
2
100%