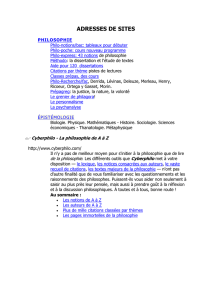cela - CLAS Users

LA PEAU DE CHAGRIN OU L'ACCIDENT FRANCO-EUROPÉEN DE LA
PHILOSOPHIE D'APRÈS JACQUES DERRIDA
Bernard Stiegler
Collège international de Philosophie | Rue Descartes
2006/2 - n° 52
pages 103 à 112
ISSN 1144-0821
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2006-2-page-103.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stiegler Bernard, « La peau de chagrin ou L'accident franco-européen de la philosophie d'après Jacques Derrida »,
Rue Descartes, 2006/2 n° 52, p. 103-112. DOI : 10.3917/rdes.052.0103
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Collège international de Philosophie.
© Collège international de Philosophie. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 24.250.221.134 - 19/04/2012 13h36. © Collège international de Philosophie
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 24.250.221.134 - 19/04/2012 13h36. © Collège international de Philosophie

PÉRIPHÉRIES
Il n’existe au fond que deux procédés permettant
de rendre justice à un penseur. Le premier consiste
à ouvrir ses œuvres pour le rencontrer dans le mou-
vement de ses phrases, dans le flot de ses argu-
ments, dans l’architecture de ses chapitres – on
pourrait dire qu’il s’agit d’une lecture singularisan-
te dans laquelle on considère que la justice est l’as-
similation à l’unique. Elle serait particulièrement
tentante avec un auteur comme Derrida, qui n’a
jamais prétendu être autre chose qu’un lecteur
radicalement attentif des textes, grands et petits,
dont la somme constitue les archives occidentales
– à supposer que l’on donne au mot «lecteur» une
signification suffisamment explosive. L’autre procé-
dé va du texte au contexte et intègre le penseur à
des horizons supra-personnels d’où ressort quelque
chose qui concerne sa véritable signification – au
risque de donner moins de poids à son propre texte
qu’au contexte plus large dans lequel ses mots sus-
citent un écho. Ce procédé débouche sur une lec-
ture désingularisante dans laquelle on comprend la
justice comme sens des constellations. Je suis sans
doute conscient que Derrida a lui-même largement
préféré la première voie et n’attendait rien de bon
de la deuxième, sachant trop précisément que
celle-ci est surtout séduisante pour des gens qui
veulent s’en servir pour se faciliter la tâche. Il s’est
ainsi défendu courtoisement et clairement, lorsque
cela a été nécessaire, contre la tentative de Jürgen
Habermas qui voulait en faire un mystique juif. Il a
noté avec une ironie subtile, en réponse à cette
identification incommode: «Je n’exige donc pas
non plus qu’on me lise comme si l’on pouvait se
placer devant mes textes dans une extase intuitive,
mais j’exige que l’on soit plus prudent dans les
mises en relation, plus critique dans les transposi-
tions et les détours par des contextes souvent très
éloignés des miens1.»
Si, tout en conservant cette mise en garde à l’es-
prit, j’ai choisi d’emprunter la deuxième voie,
c’est pour deux motifs tout à fait distincts.
D’une part, parce qu’on ne manque pas dans le
monde de lectures extatiques et littérales, pour ne
pas dire hagiographiques, de Derrida; de l’autre,
parce que je ne peux me défaire de l’impression
qu’à côté de toute l’admiration justifiée pour cet
auteur, il est rare qu’on trouve un jugement suffi-
samment distancié sur sa position dans le champ
de la théorie contemporaine. On peut naturellement
aussi concevoir la demande de distance comme un
antidote contre les dangers d’une réception relevant
du culte. Mais il faut, plus encore, de la distance
pour se faire une idée du massif dont la montagne
Derrida forme l’un des plus hauts sommets.
traduit de l’allemand par Olivier Mannoni
BERNARD STIEGLER
La peau de chagrin
ou L’accident franco-européen de la
philosophie d’après Jacques Derrida
Pour Marc Crépon
La philosophie, à la fin du XXesiècle, n’est pas
française. Il y a bien sûr une philosophie françai-
se. Il y a évidemment une histoire française de la
philosophie, et il semble clair que, au moins pour
| 103
1. Jacques Derrida, in Florian Rötzer,
Franzosische Philosophen im Gespräch, Munich,
1987, p.74.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 24.250.221.134 - 19/04/2012 13h36. © Collège international de Philosophie
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 24.250.221.134 - 19/04/2012 13h36. © Collège international de Philosophie

1. C’est le fond de la thèse de Marc Crépon dans
Altérités de l’Europe, Galilée, 2006.
BERNARD STIEGLER104 |
la deuxième moitié du XXesiècle, la philosophie
passe en France, ou en tout cas passe toujours
plus ou moins par la France – mais également tou-
jours en relation avec l’Allemagne et les pays ger-
maniques, avec Marx, Nietzsche, Freud, Husserl,
Wittgenstein et Heidegger en particulier, qui sont
les principaux interlocuteurs des Français.
Il faudrait certes analyser le concours de circons-
tances historiques qui conduit à ce fait que la
pensée philosophique passe par ces chemins.
Mais en tout état de cause, ce fait est un acci-
dent. La philosophie n’est pas française : ce
caractère « français » demeure pour moi un acci-
dent – et un accident européen.
S’il faut philosopher par accident, plutôt que par
essence, je veux souligner ici que l’accident «fran-
çais» compte, certes, mais ne doit pas être suréva-
lué, et, surtout, ne doit pas faire oublier que cette
époque française est très pénétrée d’Allemagne et
d’Autriche, et enfin, et surtout, que si la philoso-
phie peut être française accidentellement, c’est
parce qu’elle est historiquement et intrinsèque-
ment européenne. Ce qui fait l’Europe, c’est la phi-
losophie. Mais je ne veux pas dire pour autant, par
là, que ce qui fait la philosophie serait l’Europe. La
question, c’est l’accident européen – et sa nécessi-
té cependant… mais dans l’après-coup.
La philosophie est européenne de façon intrin-
sèque, et l’on aurait certes dit, dans la tradition
européenne, justement, « de façon essentielle ».
Mais je ne le dis pas, et ce non-emploi du mot
« essence » et de la référence à l’« être » signifie
aussi, en l’espèce, que la philosophie est désor-
mais appelée à devenir mondiale, et ce, avec la
technologie qui a quitté l’Europe, qui s’est répan-
due sur tous les continents – ce que médita beau-
coup Valéry. Car la nécessité européenne de la
philosophie est techno-logique. C’est-à-dire hypo-
mnésique. Et accidentelle précisément en cela.
Et l’avenir de la philosophie passe par là.
Bref, l’Europe est appelée à devenir mondiale (à
exister au plan mondial) avec sa philosophie – faute
de quoi elle mourra – et elle ne le deviendra qu’en
se «déseuropéanisant». Elle ne demeurera dans le
monde à venir, elle n’a d’avenir, autrement dit, que
si elle sait faire en sorte que sa philosophie devien-
ne mondiale, et par là même, encourt la pensée
d’un caractère intrinsèquement accidentel de la
pensée – et, en cela, un caractère intrinsèquement
non-européen de l’Europe, et de son avenir 1.
Accidentel veut donc dire, ici, techno-logique. Et
c’est ce qu’il est permis de penser, depuis
Husserl, et depuis la lecture qu’en a tenté
Derrida, à partir de la question de la géométrie.
Si Husserl décrit et écrit La crise des sciences euro-
péennes, c’est parce que la philosophie est à ses
yeux intrinsèquement européenne. Et c’est parce
que l’Europe est philosophique que Catherine II de
Russie et Voltaire s’adressent des lettres. La philo-
sophie européenne, et la République des Lettres,
c’est-à-dire le projet politique contenu dans la phi-
losophie – singulièrement dans le moment des
Lumières –, qu’elle soit anglaise, belge, italienne,
allemande, française, flamande, espagnole,
tchèque, autrichienne, ou autre, sont inscrits dans
l’horizon de l’Europe. L’Europe est donc en cela et
ainsi, c’est-à-dire accidentellement et néanmoins
nécessairement, disons en supplément, et comme
supplément d’origine, le site de la philosophie.
Il est évident que la question de la philosophie se
joue en France de manière singulière par le fait
même que la Révolution Française est l’un des
grands sujets de Kant et de Hegel, par son inter-
prétation, par ses conséquences françaises et
européennes, mais aussi par ses institutions, par
exemple l’École Normale Supérieure, et tant
d’autres éléments constitutifs de l’idée européen-
ne de la raison, le Musée, etc. Tout cela fait qu’il y
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 24.250.221.134 - 19/04/2012 13h36. © Collège international de Philosophie
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 24.250.221.134 - 19/04/2012 13h36. © Collège international de Philosophie

PÉRIPHÉRIES | 105
a un moment français de la question européenne
au cœur de la philosophie. Mais cela n’est qu’un
moment, et surtout, c’est un moment de l’Europe :
la Révolution Française est un événement euro-
péen, et non seulement français.
Et c’est pourquoi la question de savoir si la philoso-
phie française fonctionnera, œuvrera, survivra dans
une Europe politiquement unie à l’avenir, si jamais
elle s’unit, est d’une certaine manière absurde. Je
la comprends… mais je comprends qu’il y a
quelque chose là-dessous comme un soupçon,
comme si, par exemple, on soupçonnait «les philo-
sophes français» de craindre l’européanisation de
l’Europe. Mais «les philosophes français» ne crai-
gnent pas l’européanisation de l’Europe. Parmi les
«philosophes français», moi, pour autant que je
sois philosophe, et pour autant que je sois français,
je crains la destruction de l’Europe par ce qu’on
appelle la «construction européenne» ou la
«constitution européenne» et telles qu’on les
appelle ainsi sans jamais mobiliser une seconde la
pensée philosophique, c’est-à-dire européenne,
dans cette construction et dans sa constitution.
Nous – et dans ce nous, je crois pouvoir parler
aussi au nom d’amis philosophes qui ont voté oui
à cette constitution parce qu’ils pensaient qu’il
valait mieux voter pour elle malgré tout ce que je
dis ici, et ces amis s’inquiètent comme moi de la
perte de la mémoire philosophique de l’Europe
dans ce projet qui a désormais échoué –, nous,
que nous ayons donc voté oui ou non à ce referen-
dum français sur la constitution européenne, le
29 mai dernier, ne craignons pas du tout l’euro-
péanisation et l’avenir philosophique de l’Europe
et du monde. Nous le désirons au contraire.
Car au fond, bien au-delà de ces questions, l’en-
jeu n’est pas tellement la philosophie et l’Europe :
il s’agit de la philosophie et du monde, c’est-à-
dire de la philosophie et du réel.
Du réel… mais encore ?
Il s’agit du réel appréhendé comme un processus
d’individuation psychique et collective. Notre tra-
vail à venir, à nous philosophes encore à venir,
consiste à décrire en termes d’individuation ce qui
advient mondialement, que ce soit l’individuation
de la géométrie, l’individuation de l’art, l’indivi-
duation de la physique, l’individuation du vivant,
l’individuation des nations, l’individuation techno-
logique ou l’individuation psychique au sens freu-
dien. Tout cela s’inscrit dans un processus d’indi-
viduation indissociablement psychique, collective
et technique, et qui va s’élargissant sans cesse –
et ici, le grand penseur encore méconnu est
Simondon, avec lequel on commence seulement à
être capable de penser comment et pourquoi l’in-
dividuation psychique ne se réalise que comme
individuation collective, et réciproquement.
Mais il s’agit alors de penser aussi les raisons pour
lesquelles le capitalisme contemporain rend cette
individuation littéralement impossible, et pour-
quoi il s’agit d’inventer un autre capitalisme,
c’est-à-dire de faire la révolution du capitalisme.
Qu’en est-il de l’avenir dans ce devenir? Telle est la
question, et c’est la question de la raison, mais que
j’entends ici en un sens tout à fait nouveau quoi-
qu’étayé sur son sens ancien (ratio), au sens où
Freud dit que le désir est étayé sur les pulsions:
c’est autre chose, mais c’est fait de ce dont c’est
l’autre. La raison est essentiellement un rapport à
l’avenir. La raison, en français, c’est le motif, ce qui
met en mouvement, ce qui meut: c’est donc le
désir. Cette équivalence de la raison et du motif en
français ne s’entend pas en anglais ou en allemand.
Le rapport entre raison et motif, c’est-à-dire aussi
bien entre logos et désir, qui est la base du rapport
entre âme noétique et theos dans le traité de l’âme
d’Aristote, c’est ce que Hegel a très bien senti après
Spinoza qui lui-même le devait à Aristote.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 24.250.221.134 - 19/04/2012 13h36. © Collège international de Philosophie
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 24.250.221.134 - 19/04/2012 13h36. © Collège international de Philosophie

© Alex van Gelder, 2005.
voir Life and afterlife in Bénin, Phaïdon Press, Londres, 2005.
106 |
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 24.250.221.134 - 19/04/2012 13h36. © Collège international de Philosophie
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 24.250.221.134 - 19/04/2012 13h36. © Collège international de Philosophie
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%