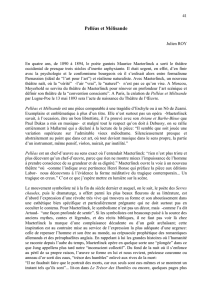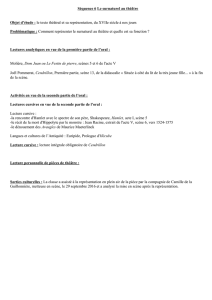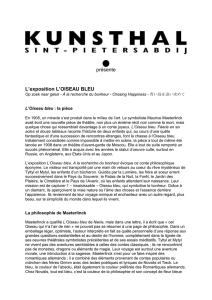maurice mæterlinck et l`invention d`un théâtre de l`image

113
CHAPITRE 1 : DANS LES OBJETS
MAURICE MÆTERLINCK
ET L’INVENTION D’UN THÉÂTRE DE L’IMAGE
Denis Laoureux
Un des mérites de la recherche menée ces dernières années sur l’histoire culturelle
de la Belgique est d’avoir fait apparaître que la relation entre la peinture et l’écriture fut
particulièrement investie sur le plan identitaire1. Bien sûr, ni la Belgique ni l’époque
contemporaine n’ont le monopole des pratiques mixtes. Il est exact, en revanche, que le
croisement des arts et des lettres revient avec une récurrence qui pose tout de même
question. Comment comprendre la régularité, sinon l’obsession, avec laquelle les poètes
francophones de Belgique s’efforcent d’inscrire le lisible dans le visible, sans pour autant
rejeter leur ancrage dans le champ littéraire ?
Théâtre et image
Force est de constater que dans l’œuvre de Maeterlinck, le passage du vers libre au
théâtre, et donc de la poésie à un genre littéraire appelé à s’incarner visuellement sur
scène, s’est fait sans transition, comme si l’écriture dramatique était de la poésie mise en
page autrement. En 1889, Maeterlinck publie son premier drame, La Princesse Maleine,
immédiatement après les Serres chaudes, son premier recueil de poésie. En quelques
années à peine, l’essentiel du corpus des pièces est écrit. On sait que celui-ci a eu pour
conséquence d’offrir au symbolisme la scène qui lui faisait défaut, et dès lors, il est
compréhensible que la critique universitaire ait cherché à saisir les motivations d’un
1 La fortune critique consacrée à cette question en témoigne. Voir : P. Aron, « Quelques propositions
propositions pour mieux comprendre les rencontres entre peintres et écrivains en Belgique francophone », in
Écritures 36, Lausanne, 1990, p. 82-91 ; Cl. Sarlet, Les Écrivains d’art en Belgique 1860-1914, Bruxelles,
Labor, coll. « Un livre, une œuvre », 1992 ; Les mots et les images dans l’art belge de a à z, Anvers,
MUKHA, 1992 ; L. Brogniez & V. Jago-Antoine (dir.), La Peinture (d)écrite, Textyles, n° 17-18, Bruxelles,
Le Cri, 2000 ; V. Jago-Antoine, « Littérature et arts plastiques », in Ch. Berg & P. Halen (dir.), Littératures
de langue française (1830-2000). Histoire et perspectives, Bruxelles, Le Cri, 2000, p. 626-658 ; M. Draguet,
« Les incertitudes de l’écriture. Le mot entre image, objet et concept », in F. Bex, L’Art en Belgique depuis
1975, Anvers, Fonds Mercator, 2001, p. 114-135 ; P. Aron, « L’art des rencontres. Les relations entre
peintres et écrivains en Belgique à la fin du XIXe siècle », in Les Passions de l’âme : les symbolistes belges,
Budapest, Musée des Beaux-Arts, du 12 octobre 2001 au 6 janvier 2002, p. 17-23 ; D. Laoureux, « Langage
et représentation dans l’art moderne et contemporain en Belgique », in Le Livre & l’estampe, n° 166, 2006,
p. 9-90 ; L. Brogniez (dir.), Écrit(ure)s de peintres belges, Bruxelles, Peter Lang, coll. « Comparatisme et
Société », 2008 ; D. Laoureux (dir.), Écriture et art contemporain, Textyles, n°39, à paraître en 2010.

114
auteur qui n’a paradoxalement jamais caché sa méfiance à l’égard de l’épreuve que
constitue, pour un texte dramatique, un passage sur la réalité d’une scène1. Il revient à
Pierre Piret d’avoir montré que si Maeterlinck se propose d’élargir le langage en
intégrant des catégories extérieures au champ linguistique – l’image et le son –, c’est
bien parce qu’il reste dans la logique interne d’une démarche de nature poétique2. Le
dépouillement des archives et l’édition critique des carnets de Maeterlinck révèlent à
quel point ce dernier a pensé, écrit, conçu un théâtre où l’image prenant corps dans le
cube scénique se voit dotée d’un rôle signifiant qui lie indéfectiblement le lisible au
visible3. Cette volonté de sortir d’un périmètre strictement littéraire pour inscrire
l’écriture dans une perspective visuelle, tout en restant dans la logique interne d’un projet
poétique, se fonde sur une critique radicale de la langue, et plus particulièrement, de la
langue française. Sur cette base, la présente contribution voudrait soulever la
problématique du dispositif utilisé par un écrivain pour donner une dimension visuelle à
une littérature forcément immatérielle par son contenu. Autrement dit, dans les pages
qu’on va lire, le théâtre est abordé non pas comme une institution, ni comme un genre
littéraire, mais plutôt en tant que structure offrant à un homme de lettres la possibilité de
se livrer à l’installation d’un texte dans un lieu.
Cette démarche n’est pas restée lettre morte. Elle entraîne aujourd’hui encore des
réactions contrastées. La polémique suscitée au Festival d’Avignon en 2005 autour de la
contribution de Jan Fabre en témoigne. D’aucuns ont vu dans les expériences scéniques
de cet artiste belge le symptôme d’un transfert pour le moins inquiétant « des belles-
lettres vers les beaux-arts ». Tout se passe comme si, à l’origine de cette polémique, se
trouvait une dérive du théâtre vers une forme « bâtarde », hybride, affirmant la
suprématie de l’image sur le texte. Ce débat est ancien. Maurice Maeterlinck y fut lui
aussi confronté à l’occasion de la création parisienne de sa pièce Pelléas et Mélisande en
1893. Le rapport inédit à la langue dans ce théâtre fait de peu de mots, affirmant la
prédominance du visuel sur la parole, suscita des réactions mitigées parmi le public
parisien.
La presse artistique et littéraire de l’époque est émaillée de formules qui expriment
ce transfert du littéraire vers le visuel. « Sensibilité picturale », « culture de l’image »,
« prédestination merveilleuse » des écrivains belges pour les arts plastiques : telles sont
quelques-unes des expressions utilisées par bien des critiques belges et étrangers attachés
1 Sur ce point, voir les essais suivants : P. Aron, La mémoire en jeu. Une histoire du théâtre de
langue française en Belgique (XIXe-XXe siècle), Bruxelles, Théâtre de la Communauté française de Belgique
/ La Lettre volée, 1995 ; P. McGuinness, Maurice Maeterlinck and the making of modern theatre, Oxford,
Oxford University Press, 2000 ; G. Dessons, Maeterlinck, le théâtre du poème, Paris, Laurence Teper, 2005 ;
D. Laoureux, Maurice Maeterlinck et la dramaturgie de l’image. Les arts et les lettres dans le symbolisme en
Belgique, Anvers, Pandora, coll. « Cahiers », 2008.
2 P. Piret, « La genèse de la révolution dramaturgique maeterlinckienne », in Vives Lettres
(Passerelles francophones. Pour un nouvel espace d’interprétation), vol. I, n° 10, 2e semestre, 2000, p. 37-
53 ; P. Piret, « Postérité de la révolution dramaturgique maeterlinckienne », in M. Quaghebeur (dir.),
Présence / Absence de Maurice Maeterlinck, actes du Colloque organisé à Cerisy-la-Salle du 2 au 9
septembre 2000, Bruxelles, Labor, coll. « Archives du futur », 2002, p. 415-431.
3 Voir M. Maeterlinck, « Le Cahier bleu », texte établi, annoté et présenté par J. Wieland-Burston, in
Annales de la Fondation Maurice Maeterlinck, t. 22, 1976, p. 7-184 et M. Maeterlinck, Carnets de travail
(1881-1890), édition établie et annotée par F. van de Kerckhove, 2 vol., Bruxelles, Labor, coll. « Archives du
futur », 2002.

115
à souligner cette singularité, permettant du même coup aux auteurs belges de s’exporter
et de se créer une identité aux yeux du public international. On en déduira que la peinture
a joué un rôle déterminant dans l’émergence de la littérature belge. Le prestige afférent à
la tradition picturale flamande a en effet installé un rapport particulier à la langue au
point de voir naître une représentation spécifique de l’écrivain belge en tant que peintre
qui écrit1. Ceci explique, au moins en partie, l’investissement de Maeterlinck dans le
théâtre, c’est-à-dire dans une discipline intrinsèquement liée au visible, et qui lui permet,
dès lors, de transposer dans le champ de l’écriture des éléments issus du monde de l’art
sans évacuer la logique d’un projet littéraire.
Le corpus des textes dramatiques publiés par Maeterlinck dans les années 1890
tend en effet à « picturaliser » le théâtre en s’inspirant de l’art qui lui est contemporain.
C’est de cette invention d’un théâtre pictural qu’il va être question ici, à travers la mise
en scène d’un texte fameux, Pelléas et Mélisande, le 7 mai 1893 à Paris, au Théâtre des
Bouffes-Parisiens.
Histoire de l’art et dramaturgie
Cette notion d’image scénique, ou de théâtre pictural, est une notion qui ne va pas
de soi, et qui pose d’abord un problème d’ancrage disciplinaire dont il faut rendre
compte. Sous l’emprise de la scène, l’écrit cesse d’être exclusivement un fait de langage.
Le théâtre n’est littéraire que dans l’espace du livre. Projeté sur un plateau de jeu, le texte
devient image puisque le spectacle est visuel. Maeterlinck est conscient du processus qui
métamorphose l’écriture dramatique en « tableau vivant qui parle »2. Cet emprunt au
vocabulaire artistique place le théâtre sous le signe de la peinture. Très vite, avant même
qu’il ne publie son premier drame, Maeterlinck s’interroge sur les conséquences et les
modalités du passage de la page au plateau. En témoigne cet extrait d’une lettre de 1890 :
Au moment où j’ai lu vos frappantes et neuves pensées sur le théâtre – écrit-il à son
correspondant Albert Mockel –, je venais tout juste d’achever, pour la Jeune Belgique,
une brève étude sur le théâtre où j’éprouvais le même mécontentement organique du
spectateur depuis que le théâtre existe, et qui me faisait soupçonner que le théâtre est
un art mort.3
Cette lettre illustre un malaise éprouvé par bien des poètes devant une scène perçue
comme un lieu mortifère où viennent s’éteindre les plus fameux poèmes scéniques au
premier rang desquels notre homme de théâtre place Hamlet et Le Roi Lear. Et pourtant,
un lien se tisse entre l’écriture d’un drame et la perspective de voir ce drame porté sur
scène. Pour le dire vite, Maeterlinck écrit pour la scène. C’est pourquoi il serait fructueux
de compléter l’analyse textuelle du corpus de pièces par l’étude de la mise en scène de
1 Voir la contribution excellente de Laurence Brogniez : « Nés peintres : la “prédestination
merveilleuse” des écrivains belges », in N. Aubert, P.-Ph. Fraiture & P. McGuinness (dir.), La Belgique entre
deux siècles. Laboratoire de la modernité 1880-1914, Oxford, Peter Lang, 2007, p. 85-105.
2 Maurice Maeterlinck, Carnets de travail (1881-1890), op. cit., p. 1110. Il est à noter que
l’expression « tableau vivant » est entrée dans le vocabulaire théâtral pour désigner, précisément, une image
scénique inspirée de la peinture.
3 M. Maeterlinck, lettre à Albert Mockel, Oostacker, 24 août 1890. Gand, Cabinet Maeterlinck, B
LXXXIII 5. L’étude à laquelle Maeterlinck fait allusion est la suivante : « Menus propos. Le théâtre », in La
Jeune Belgique, septembre 1890, p. 331-336.

116
ces dernières. Autrement dit, l’expression scénique est liée aux options esthétiques de la
dramaturgie qui lui est contemporaine, et dès lors on aurait tort de couper les textes de
leur création. Ce postulat se révèle particulièrement stimulant lorsqu’il est question
d’auteurs prenant part à l’expression scénique de leurs propres pièces. C’est le cas de
Maeterlinck.
Suivant ce questionnement, il apparaît que la démarche de Maeterlinck repose sur
un paradoxe. L’auteur de Pelléas et Mélisande émet les plus sérieuses réserves sur le
bien-fondé de la mise en scène, et en même temps, il charge sa dramaturgie d’effets
visuels élaborant un théâtre qui aspire à la scène. Pour sortir de ce paradoxe, Maeterlinck
se consacre à la définition de nouvelles modalités d’expression scénique. En s’inspirant
du modèle que lui offre la peinture. En cela, la théorie dramaturgique de Maeterlinck
soulève la question, centrale pour l’époque, des relations entre la pensée théâtrale et les
avancées de la peinture. Nul doute que le travail de promotion de la peinture moderne à
Bruxelles par le groupe des XX ait contribué à ce genre de rapprochement. Le succès
rencontré par un peintre comme Fernand Khnopff, ou par le sculpteur George Minne,
dans les salons des XX comme dans la critique d’art progressive, a sans doute encouragé
Maeterlinck à puiser dans les arts visuels des éléments pour régénérer une discipline
dramatique qu’il juge régressive.
Cette hypothèse de la « picturalité du théâtre » n’est pas nouvelle. Elle a cependant
été longtemps prisonnière d’un propos littéraire essentiellement attaché aux aspects
rhétoriques, sans percevoir à quel point le travail sur les formes de l’écriture va de pair
avec la recherche d’une image scénique. Il faut dire que cette « picturalité du théâtre »
n’est une évidence ni pour un spécialiste de la littérature, ni pour un historien de l’art.
Pour plusieurs raisons. D’abord, le théâtre se divise en scènes dont la succession tranche
avec l’unité spatiale de l’œuvre d’art. Ensuite, la fixité de la peinture contraste avec le
mouvement des acteurs dans le spectacle théâtral. Enfin, la planéité intrinsèque de la
surface peinte s’oppose à la profondeur du cube scénique. Il est remarquable que la
dramaturgie maeterlinckienne s’inscrive précisément à l’endroit de ces
différences qu’elle entend réduire, comme pour aligner le tableau scénique sur la
peinture en vue d’élaborer un autre théâtre que celui du texte.
Vers un autre théâtre
Les historiens du théâtre voient dans le dernier tiers du XIXe siècle un temps de
mise en question, non pas du spectacle théâtral en tant que tel, mais bien des modalités
de la représentation. Durant la fin de siècle, le théâtre de divertissement connaît un
indéniable succès populaire. La scénographie relative à ce type de spectacle mise son
efficacité sur ce qu’on a appelé la « machinerie théâtrale »1. Celle-ci a pour principe de
camper le décor réel du lieu où se situe le spectacle. Elle doit surtout donner au
spectateur l’illusion que la scène se passe « dans le milieu même où l’auteur a placé ses
1 G. Moynet, La Machinerie théâtrale. Trucs et décors. Explication raisonnée de tous les moyens
employés pour produire les illusions théâtrales, Paris, La Librairie illustrée, s. d.

117
personnages »1. De spectaculaires effets de scène et des décors dessinés selon les lois de
la perspective géométrique donnent à la scénographie le rôle d’une fonction descriptive.
Plusieurs hommes de lettres proches du milieu théâtral réagissent à cette situation.
C’est dans ce contexte que Maeterlinck formule sa vision théorique de la représentation.
Pour cerner celle-ci, on dispose de sources variées : des articles publiés en revue, une
correspondance abondante, des manuscrits et, surtout, des carnets de travail. L’ensemble
permet de saisir les enjeux d’un théâtre de l’image appelé à rémunérer les lacunes d’un
théâtre du texte. C’est que, face à la réalité de la scène, Maeterlinck, on l’a dit, ne
dissimule pas sa perplexité. Dès la parution de ses premiers drames, il s’interroge sur les
limites du réalisme dans la mise en scène :
En somme – lit-on par exemple dans le carnet de 1890 –, le théâtre d’aujourd’hui est
une chose absolument contraire à l’art, parce que c’est la production de l’artificiel par
la nature même, c’est à dire l’inverse de ce qu’il faudrait, comme le serait une statue en
chair ou en graisse – un paysage où les arbres auraient de vraies feuilles, et les toits des
chaumières seraient en vraie paille – de là le dégoût que tout artiste éprouve
instinctivement au lever du rideau comme d’une chose contre nature.2
À cet état de fait, Maeterlinck oppose un théâtre qui soit un « temple du rêve ». Dans ce
contexte, on peut comprendre qu’il se soit moins méfié de la scène en soi que des
pratiques chères au milieu du vaudeville. Cela va l’amener à contribuer activement à la
création de Pelléas et Mélisande en 1893 sur la scène parisienne.
Un décor fait de presque rien
Ces éléments seraient restés purement théoriques si Pelléas et Mélisande n’avait
servi de prototype à la redéfinition d’un espace théâtral dans lequel le dispositif
scénographique se réduit à quelques panneaux mobiles conçus, en l’occurrence, par le
peintre Paul Vogler. Le dépouillement des archives et de la presse d’époque montre que
Maeterlinck suit de très près la conception de la création de Pelléas et Mélisande dont la
mise en scène est attribuée à Aurélien Lugné-Poe. À cette création, qui a lieu le 7 mai
1893, assistent notamment Claude Debussy et Constantin Stanislavski.
Il convient d’insister sur le caractère interventionniste de l’auteur du drame dans le
travail de Lugné-Poe. Car ce qui se met en place d’essentiel lors de cet événement
découle en grande partie de la réflexion menée en amont par Maeterlinck. La critique,
qui s’est appuyée sur les ouvrages fondateurs de Jacques Robichez pour attribuer à
Lugné-Poe l’essentiel des innovations faites lors de cette création, n’a pas suffisamment
insisté sur ce fait3. Si la création de Pelléas et Mélisande est considérée à bon droit par
les commentateurs comme une étape majeure dans l’histoire de la théâtralité, c’est bien
parce que, d’une part, l’auteur du texte s’implique personnellement dans la mise en
1 J. Moynet, L’Envers du théâtre. Machines et décorations, Paris, Hachette, 1875, p. 2.
2 M. Maeterlinck, Carnets de travail (1881-1890), op. cit., p. 1112-1113.
3 J. Robichez, Le Symbolisme au théâtre. Lugné-Poe et les débuts de l’Œuvre, Paris, L’Arche, 1957 ;
et du même auteur : Lugné-Poe, Paris, L’Arche, coll. « Le Théâtre et les Jours », 1955.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%
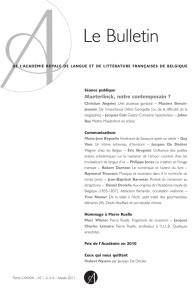
![[Figures et matières animées]](http://s1.studylibfr.com/store/data/003994561_1-b086ff8b758043d9be3ced1c31e536d9-300x300.png)