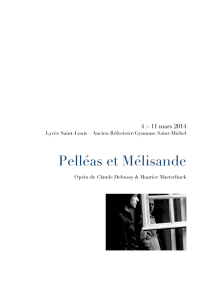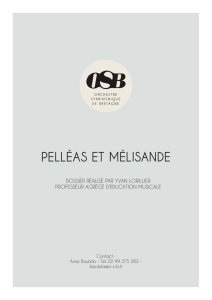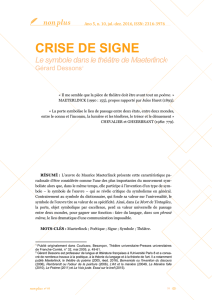Pelléas et Mélisande

41
Pelléas et Mélisande
Julien ROY
En quatre ans, de 1890 à 1894, le poète gantois Maurice Maeterlinck a sorti le théâtre
occidental de presque trois siècles d’inertie asphyxiante. Il était urgent, en effet, d’en finir
avec la psychologie et le conformisme bourgeois où il s’enlisait alors entre formalisme
Parnassien (idéal de “l’art pour l’art”) et réalisme naturaliste. Avec Maeterlinck, un nouveau
théâtre naît, où la “vérité” -l’air “vrai”, le “naturel”- n’est pas ce qu’on vise. A Moscou,
Meyerhold se servira du théâtre de Maeterlinck pour rénover en profondeur l’art scénique et
définir son théâtre de la “convention consciente”. A Paris, la création de Pelléas et Mélisande
par Lugne-Poe le 13 mai 1893 sera l’acte de naissance du Théâtre de l’Œuvre.
Pelléas et Mélisande est une pièce comparable à une tragédie d’Eschyle ou à un Nô de Zeami.
Exemplaire et emblématique à plus d’un titre. Elle n’est surtout pas un opéra -Maeterlinck
savait, à l’occasion, être un bon librettiste, il l’a prouvé avec son Ariane et Barbe-Bleue que
Paul Dukas a mis en musique- et malgré tout le respect qu’on doit à Debussy, on se rallie
entièrement à Mallarmé qui a déclaré à la lecture de la pièce: “Il semble que soit jouée une
variation supérieure sur l’admirable vieux mélodrame. Silencieusement presque et
abstraitement au point que dans cet art, où tout devient musique dans le sens propre, la partie
d’un instrument, même pensif, violon, nuirait, par inutilité.”
Pelléas est un chef-d’œuvre au sens exact où l’entendait Maeterlinck: “rien n’est plus triste et
plus décevant qu’un chef-d’œuvre, parce que rien ne montre mieux l’impuissance de l’homme
à prendre conscience de sa grandeur et de sa dignité.” Maeterlinck ouvre la voie à un nouveau
théâtre “où -comme l’indique avec pertinence Henri Ronse qui préface la pièce aux éditions
Labor- nous découvrons à l’évidence la forme méditative du tragique contemporain... Un
tragique en creux.” C’est ce que j’espère mettre en lumière sur la scène.
Le mouvement symboliste né à la fin du siècle dernier et auquel, on le sait, le poète des Serres
chaudes, puis le dramaturge, a offert parmi les plus beaux fleurons de sa littérature, est
d’abord l’expression d’une révolte très vive qui trouvera sa forme et son aboutissement dans
une esthétique bien spécifique et particulièrement prégnante qui ne doit surtout pas en
occulter le contenu. Pour Maeterlinck, le symbolisme n’est pas un décor, mais -comme l’a dit
Artaud- “une façon profonde de sentir”. Si les symbolistes ont beaucoup puisé à la source des
anciens mythes, contes et légendes, et des récits bibliques, il ne faut pas voir là chez
Maeterlinck la marque d’une complaisance décadente ou d’un goût archaïsant; cette
inspiration est au contraire mise au service de l’expression la plus adéquate d’une urgence:
celle de repenser l’homme et son être au monde, au crépuscule prophétique des romantiques
allemands et des préraphaélites anglais. En rappelant à lui les grandes histoires où l’humanité
se raconte depuis l’aube du temps, Maeterlinck opère en quelque sorte une “plongée” dans ce
que Jung appellera plus tard notre “inconscient collectif”. Du fond de la nuit où il s’enfonce
au péril de sa propre raison, l’œuvre se forme en lui et nous revient, précieuse couronne ou
anneau d’or sorti des eaux, “trésor des humbles” enlevé aux rives de la mort:
“Il ne faudrait faire que le portrait des morts, car eux seuls sont eux-mêmes et se montrent un
instant tels qu’ils sont”... lit-on dans Le Trésor des Humbles ou encore, quelques pages plus

42
loin: “tandis que l’on remue la pierre presque inconnue qui couvre ces mystères, on respire
l’odeur trop forte de l’abîme et les mots en même temps que les pensées tombent autour de
nous comme des mouches empoisonnées”.
Ainsi, les formes choisies par notre auteur sont-elles des figures archétypales mises au service
d’une fable emblématique entièrement destinée à nous faire voir/entendre ce qu’on ne peut
pas regarder, en l’occurrence notre béance psychique. Ce rôle sera entièrement dévolu à la
langue, sommée de dire enfin ce dont on ne peut parler, à savoir, plus précisément pour
Maeterlinck: le secret, l’indicible et l’innommable. Mise en abîme de l’homme par celle de la
langue, à l’épreuve du sens. Kafka, Artaud, Beckett, Adamov, Novarina et bien d’autres, sont
annoncés par lui. Il sera donc le premier, à la fin du siècle dernier, à désapprendre l’usage de
la langue dont il se sert pour écrire, la langue française, pour la forcer à “produire autre chose
que du franc” -comme dit Novarina. Il ira jusqu’à la réduire au balbutiement et à l’écholalie
-qui est le fait de répéter machinalement des paroles entendues- dans une sorte de régression
au stade de pré-parole, pour l’entendre dans son frémissement originel, au bord du vide. Il lui
importe moins de savoir de quoi on parle que de trouver d’où on parle. “Cette musique du
silence ne peut tendre que vers l’utopie d’un silence du mot” (Delphine Cantoni). “Parler est
un drame” (Novarina). Le personnage de L’Innommable de Beckett dit “entendre trop mal
pour pouvoir parler, c’est ça mon silence... Ne plus entendre cette voix, c’est ça que j’appelle
me taire.”
Ecoutons Mélisande au moment où elle meurt: “Je ne comprends pas non plus tout ce que je
dis, voyez-vous... Je ne sais pas ce que je dis... Je ne sais pas ce que je sais... Je ne dis plus ce
que je veux.”
Avec Novarina encore, j’ajouterai que “c’est dessous la langue qu’on est maintenant,
effondré...”
Ainsi Maeterlinck s’attache-t-il à nous faire entendre au plus près de la lettre qui l’excède,
“par-dessus les dialogues ordinaires de la raison et des sentiments, le dialogue plus solennel et
ininterrompu de l’être et de sa destinée”. Son théâtre est une peinture physique de l’invisible
qui autorise des expériences scéniques très passionnantes: avec Anne Beaupain, Muriel
Clairembourg et Cécile Henri qui joueront bientôt les servantes dans Pelléas, j’ai créé au
Nouveau Théâtre de Belgique Aglavaine et Sélysette -pièce qui marque la fin de la période
symboliste de Maeterlinck. Nous avons mis en scène cette pièce sous la forme d’une sorte de
cantate à trois voix où ni les personnages ni les situations n’étaient représentées!... Meyerhold
disait qu’un spectacle de Maeterlinck est un mystère. On est pourtant en présence d’un
“tragique quotidien qui est bien plus réel, bien plus profond et bien plus conforme à notre être
véritable que le tragique des grande aventures.” (Le Trésor des Humbles) De La Princesse
Maleine à Aglavaine et Sélysette, il orientera d’ailleurs son œuvre vers des drames de plus en
plus statiques où les grands événements, s’ils n’ont eu lieu, seront annoncés dès la première
scène, à la manière des tragédies antiques. Ainsi, la première scène de Pelléas, que Debussy
supprime... avec la permission de l’auteur!?
C’est dans un effort désespéré de réconcilier l’homme avec son destin que s’inscrivent et
s’unifient à nos yeux la personnalité multiple et contradictoire de Maurice Maeterlinck d’une
part, la grande diversité de son œuvre d’autre part, l’homme et l’œuvre se fondant finalement
ensemble dans cette quête qui a atteint son plus haut degré d’incandescence avec ce qui
constitue le théâtre symboliste du poète, le seul qu’on retienne vraiment aujourd’hui: La
Princesse Maleine, Pelléas et quelques pièces brèves d’un “théâtre de marionnettes”
-L’Intruse, Les Aveugles, Intérieur, La mort de Tintagile notamment-. Mais la quête est
partout la même et sa mise en lumière, propre à dissiper bien des malentendus; au point de ne

43
plus voir de différence entre le jeune fransquillon de Gand et le vieux belge Nobélisé
d’Orlamonde, le boxeur et le mystique un peu mégalomane, névrosé -voire schizo-, à la fois
poète, traducteur de Ruysbroeck, Novalis et Shakespeare, dramaturge, essayiste, nouvelliste,
librettiste, conférencier international, apiculteur et botaniste distingué. C’est le même homme
en tout, la même longue “fin de partie” d’un apatride des régionalismes, cosmopolite invétéré
qui, n’ayant appartenu à personne de son vivant, appartient à tous aujourd’hui. Comme
l’explique Marc Rombaut dans sa préface au Trésor des Humbles, Maeterlinck a parié sur la
parole et non sur la société. “Ecrire, dit Kafka, n’est-ce pas bondir hors du rang des
meurtriers?”...
Sa propre trajectoire, comparée à celle de l’œuvre, est très éclairante dans la lecture qu’on
peut faire de Pelléas. Après sa période symboliste, Maeterlinck a voulu orienter l’œuvre qu’il
jugeait trop désespérée, vers des formulations plus positives: ce qui se manifeste dans son
théâtre par une prépondérance progressive de la femme, sur l’homme -l’apparition de
Georgette Leblanc dans la vie de l’écrivain n’est sans doute pas étrangère à cette évolution
symptomatique. De L’Oiseau Bleu composé entre 1905 et 1908, aux Bulles Bleues, souvenirs
heureux de jeunesse livrés l’année de sa mort en 1949, on suit la même quête d’un bonheur
fluide mais inaliénable. On apprend pourtant qu’à Orlamonde, au soir de sa vie, Maeterlinck
attend le crépuscule dans une grande salle vide, assis sur un trône, une mitraillette sur les
genoux; qu’il sort la nuit autour de son palais accompagné de ses chiens molosses qui portent
les noms diaphanes des personnages de son premier théâtre, et qu’il tire sur les ombres. Dans
Pelléas, on est au royaume d’Allemonde. Là, ce n’est pas Maeterlinck qui veille, mais le
vieux roi Arkel, presque aveugle; il règne sur Allemonde corrodé par les eaux comme sur un
monde sans ciel en voie d’engloutissement, où il assiste, impuissant, au reflux de la vie sous
la misère physique et morale de ses habitants, et au flux de la mort, que ni porte, ni mur, ni
château, ni digue, ni barrage, nulle forteresse ou cathédrale de pierre ou de fer érigée de mains
d’homme, ne saurait contenir. Au royaume d’Allemonde, des fantômes qui nous ressemblent
surgissent de la nuit, s’y agitent un instant sous nos yeux, et s’y perdent... Je vois Allemonde
à l’image de Golaud qui dit être “fait au fer et au sang”, et à celle du vieil Arkel: un monde
placé sous le signe de l’homme qui l’a érigé au fer et au sang, un monde qui maintenant
chancelle... Je ne pense pas que l’esthétique à donner au spectacle de Pelléas doive être
“liquide”, ni que l’œuvre soit à mettre sous le signe de la femme ou de l’amour et la jeunesse
de Pelléas et Mélisande: à Allemonde l’eau est morte; la femme, perdue; l’amour, toute
jeunesse, condamnés...
On pense au Aveugles, mais aussi à un livret d’opéra mis en musique par Paul Dukas, que
Maeterlinck a écrit plus tard, en 1907: Ariane et Barbe-Bleue. Il y combine génialement le
mythe antique au conte de fées bien connu: Barbe-Bleue n’y tue pas ses épouses, il se
contente de les enfermer. Ariane se laisse enfermer à son tour, décidée à combattre et à
vaincre. Bravant l’interdit d’entrer à la septième porte, elle découvre les premières épouses
qui refuseront la délivrance offerte, préférant leur esclavage familier à la liberté. Or, qui sont-
elles, ces premières épouses de Barbe-Bleue qu’Ariane veut sauver? -On les connaît bien,
elle ont pour nom Mélisande, Alladine, Ygraine, Bellangère, Sélysette, elles sont les
malheureuses victimes du premier théâtre de Maeterlinck, dont Aglavaine, dans Aglavaine et
Sélysette paru en 1896, puis la légendaire Ariane, sonnent le glas.
Il m’apparaît donc que Maeterlinck a cherché -tel Golaud traquant un sanglier dans la forêt-
la lumière d’une aube nouvelle sous le règne de la femme. Elle seule pourrait sortir le monde
de la nuit où il s’enfonce comme en une eau profonde. “Comme on est seul ici... On n’entend

44
rien”, dit Mélisande au bord de la fontaine des aveugles... Les femmes sont “les sœurs
voilées” des grands mystères. Il n’est d’avenir qu’en elles, pour Maeterlinck. D’Orlamonde à
Allemonde, d’un château à l’autre, je vois Arkel-Maeterlinck qui veille aux portes de son
enfer: Golaud devenu vieux, Barbe-Bleue épargné, condamné -jusqu’à quand?- à chasser les
ombres qui hantent sa nuit depuis la mort de Mélisande et celle de son frère Pelléas, mort
tragique de toute enfance perdue au fond d’une fontaine ayant depuis longtemps cessé
d’ouvrir les yeux des aveugles. -On note au passage que Maeterlinck perd accidentellement
son frère l’année où il écrit Pelléas...
L’homme n’est-il pas naturellement enclin à combattre tout ce qui échappe à son contrôle et à
son entendement -notamment la femme qui là, diffère déjà de lui- ? Succombant ainsi à cette
faiblesse de sa nature, ne précipite-t-il pas sa mort, tandis que grandissent en lui les ombres
qui le hantent? Quelle jeunesse alors espérer d’un monde pris ainsi entre l’épouvante du
souvenir et l’épouvante de l’avenir, où l’on ne chasserait l’ombre que par l’ombre, recouvrant
indistinctement d’ombre tout ce qui, venu de l’extérieur ou étranger à soi-même, demanderait
encore à venir? Les femmes elles-mêmes se sont refusées jusque-là à la liberté dont elles ont
la clef. Ainsi Mélisande, Sélysette, mourront-elles sans rien livrer de leur secret. C’est que le
monde qu’elles quittent ne peut pas l’entendre, ni l’homme auquel elles appartiennent, ni
même la femme qui leur serait envoyée pour les libérer. Plus encore: leur secret n’ouvrant
rien en ce monde, elles y vivent et elles y meurent dans l’oubli de ce qu’elles savent... Tandis
qu’Allemonde s’enfonce dans les eaux mortes de son passé, celles d’où viennent pourtant
Mélisande et toutes les créatures ophéliennes du premier théâtre de Maeterlinck, premières
sources de vie, l’homme assoiffé d’eau claire dresse fébrilement pour sa défense de puissants
molosses qui portent leurs noms!... On songe malgré soi à ces abeilles et à ces termites où
Maeterlinck reconnaît les modèles terribles d’une société totalitaire...
“Toutes nos idées sur la vie sont à reprendre à une époque où rien n’adhère plus à la vie”,
écrit Artaud. Qu’est-ce qui pourrait bien sortir l’homme de sa prison mentale? Qu’est-ce qui
serait susceptible de lui rendre sa “simple force d’avoir faim”?... Parlons de l’amour! Il est
présent partout, dans Maeterlinck, qui semble même n’avoir parlé que de l’amour, en tout.
Reprenons la fable de Pelléas:
Golaud poursuit dans la forêt un sanglier qu’il a blessé à mort... il s’égare... il rencontre
Mélisande au bord d’une fontaine... il l’épouse... Mélisande et Pelléas -le demi-frère de
Golaud- tombent amoureux l’un de l’autre... Golaud tue Pelléas... Mélisande meurt, après
avoir mis au monde une petite fille... Golaud reste seul vivant.
Tragique histoire... peut-être la plus emblématique et la plus belle des multiples variations à
trois voix/voies jouées à travers tout l’œuvre, dans l’espoir toujours de réussir une fusion des
trois en un même amour supérieur qui sauverait de l’inéluctable. Maeterlinck se heurte en
effet de manière quasi obsessionnelle à ce nombre “trois”; il sonne partout comme le destin.
Dans Pelléas il met en scène le mari jaloux, la femme et l’amant; plus tard, conformément à
l’évolution que nous avons décrite, il mettra plus volontiers en scène deux femmes, autour
d’une assez pâle figure d’homme, et il ira même jusqu’à chasser toute l’ombre de la jalousie
empoisonnant le rapport amoureux: c’est le cas dans Alladine et Palomides, c’est encore le
cas dans Aglavaine et Sélysette. Là non plus cependant, il ne parvient pas, malgré tant
d’efforts avoués, à éviter la fin tragique. A noter encore que le trio amoureux est
généralement encadré par la vieillesse et l’enfance -on a ainsi les trois âges de la vie fondus
dans la même quête, avec, là aussi, le passage du masculin au féminin: d’Arkel à Méligrane,
d’Yniold à Yssaline...

45
J’en arrive provisoirement à cette conclusion:
- Pelléas, toujours sur le point de partir, cherche un ailleurs.
- Mélisande n’est pas heureuse, on l’entend assez le répéter, elle cherche le bonheur.
- Golaud égaré traque la vérité.
“Ailleurs”, “bonheur” et “vérité” sont les trois voies, les trois quêtes archétypales, que
Maeterlinck a conjuguées sur tous les modes possibles jusqu’au soir de sa vie pour retrouver
les Bulles Bleues de l’enfance dont il prétend ne garder que les bons souvenirs. “La jeunesse
n’est rien que le souvenir de quelqu’un qui n’est pas encore venu” dit La Princesse Blanche,
dans la pièce de Rilke. Pourquoi ne vient-il pas, celui qui rendrait à chacun la jeunesse dont il
a souvenir? En toute impuissance le roi Arkel a assisté au drame; vieux comme le monde et
solitaire, il attend dans sa nuit que ça finisse... Arkel à Allemonde, Maeterlinck à
Orlamonde...
J’en conclus qu’aucune des trois quêtes -ailleurs, bonheur, vérité- ne se fait entendre sans
l’accord des trois, et que cet accord supposerait un amour qui n’est pas de ce monde.
“N’est-ce pas étrange, Sélysette? Je t’aime, j’aime Méléandre, Méléandre m’aime, il t’aime
aussi, tu nous aimes l’un et l’autre, et cependant nous ne pourrions pas vivre heureux, parce
que l’heure n’est pas encore venue où des êtres humains puissent s’unir ainsi.” (Aglavaine et
Sélysette)
“Quel jour deviendrons-nous ce que nous sommes?” (Le Trésor des Humbles)
Ayant parié sur “l’homme-dieu-qui-s’ignore”, Maeterlinck a rêvé pour lui d’une humanité où
il devienne possible de se regarder à trois sans exclure un tiers du regard des deux autres, à
l’aube d’un silence du mot.
Arkel: “Si j’étais Dieu, j’aurais pitié du cœur des hommes...”
1
/
5
100%
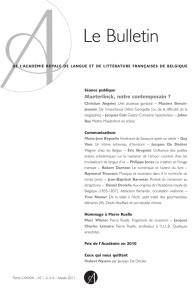
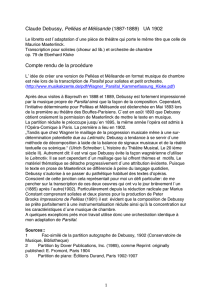
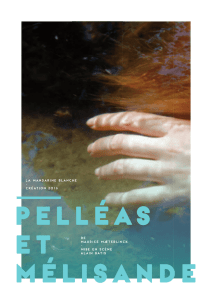


![[Figures et matières animées]](http://s1.studylibfr.com/store/data/003994561_1-b086ff8b758043d9be3ced1c31e536d9-300x300.png)