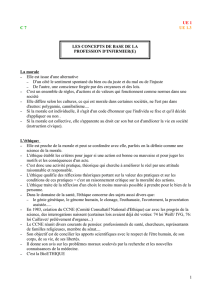Séquence 4 - René Barbier

Sens de l’éducation-2001/2002-René Barbier
1
4 Présentation
Aujourd’hui la question de l’éthique en éducation est une des questions clés de notre
réflexion. Si la fonction de l’éducation, comme le croit Emile Durkheim, est une nécessaire
transmission d’un patrimoine socioculturel d’une génération à une autre, nous nous demandons de
plus en plus, mais pas nécessairement de mieux en mieux, ce qui fait valeur en ce monde et ce qui vaut
la peine d’être transmis à nos enfants.
Dans cette optique plusieurs points sont à discuter :
- Qu’appelle-t-on “valeur” et “éthique”, en fin de compte ?
- Peut-on repérer des “valeurs ultimes” considérées comme indispensables à
transmettre dans un processus éducatif ?
4 Ethique et Education
4.1 Question philosophique
D’emblée il nous faut préciser que la conception de la “valeur” varie en fonction des
cultures. Reste à savoir s’il demeure des valeurs universelles.
4.1.1 Question de la valeur chez les philosophes
Les philosophes ont toujours cherché à réfléchir sur la notion de “valeur”. Chez les
Grecs, la valeur est confondue avec l’Etre dans la notion de Bien : soit le bien-être physique (chez
Aristippe de Cyrène1, disciple de Socrate), Carpe diem dira Horace, soit comme l’harmonie de sa
personnalité. Socrate peut affirmer “Nul n’est méchant volontairement”. La valeur, obtenue par
l’action, coïncide avec l’être, ce qui est obtenu par la connaissance comme représentation.
A partir du détachement et de la contemplation, l’intellectualisme stoïcien débouche sur
un projet de moralité qui vise à rester conforme à l’ordre naturel pour surmonter la souffrance en
distinguant les choses qui dépendent de nous et les choses qui n’en dépendent pas (Epictète2).
Spinoza3, plus tard, proposera l’union de l’âme pensante avec la nature entière comme connaissance
suprême.
Pour Epicure4, la valeur est plutôt identifiée avec l’intérêt parce qu’il fait entrer un calcul
dans l’estimation des plaisirs en qui, hostile à la religion, il voit l’unique fin possible. Rejetant les
plaisirs ni naturels, ni nécessaires, il admet ceux qui sont naturels et non nécessaires et acceptent
comme pleinement valables les plaisirs naturels et nécessaires. Mais n’oublions pas que la voie
épicurienne est ascétique et sa vertu : l’ataraxie, c’est-à-dire l’absence de trouble de l’âme. Jérémie
Bentham (1748-1832)5 reprendra au XVIII° siècle cette valeur utilitariste.
Pour Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)6 comme plus tard pour H. Bergson (1859-

Sens de l’éducation-2001/2002-René Barbier
2
1941), la valeur est une donnée intuitive d’origine transcendentale. A noter que Rousseau dans le
siècle des Lumières rationaliste et mesuré, avec son hostilité à l’esprit poétique, est considéré comme
relativement marginal et précurseur du Romantisme (Nedd, 1963, pp. 18 ss.). Il préconise de se
laisser illuminer par “les lumières qui éclairent le cœur” écrit-il dans l’Emile7, car nous possédons
alors une source d’intuition, juge infaillible du bien et du mal. Bergson8 prolongera la pensée de
Rousseau en parlant de l’aspiration comme produit de l’intuition par laquelle l’homme s’ouvre à la
durée, à la générosité créatrice de Dieu (Bergson, 1932, ch. I et IV). Opposé au “somnambule”, le
“héros” est en expansion spirituelle et seul perméable à la valeur.
E. Kant (1724-1804)9 et J. G. Fichte (1762-1814) voient la valeur comme donnée par
une intuition de la volonté générale, d’où naît l’obligation morale. La valeur est avant tout dans
l’intention qui préside à l’acte. Mais la volonté doit agir car l’“enfer est pavé de bonnes intentions”.
4.1.2 Valeur, expérience morale ?
Pour Max Scheler (1874-1928), disciple de E. Husserl (1859-1938), la valeur est
donnée par un jugement immédiat d’évidence préférentielle. Ce qui caractérise une valeur morale
pour Scheler, c’est d’abord la façon dont elle est saisie antérieurement à toute expérience et a priori.
La valeur, bien qu’inscrite dans les faits, est relativement indépendante du contenu vécu ou d’une
démarche rationnelle. L’expérience d’une valeur morale est celle d’une émotion pure a priori.
L’expérience morale s’appuie sur quatre piliers d’immédiateté et de profondeur croissantes :
- le sentiment pur (distinct de l’épreuve affective) révélateur de valeurs isolées ;
- les évidences préférentielles qui instituent une hiérarchie des valeurs ;
- la sympathie qui saisit l’intériorité des autres personnes ;
- l’amour enfin distinct des inclinations bienveillantes ou malveillantes comme de
l’instinct sexuel et qui incarne les valeurs en les saisissant dans leur vie même au sein
des personnes aimées.
L’éthique du sentiment naturel, par exemple la pitié, l’amour, représentée principalement
par Hutcheson permet de déterminer immédiatement les règles de conduite morale. Ce que Kant
conteste dans “Le Fondement de la métaphysique des mœurs”.
Pour A. Schopenhauer (1788-1860) la valeur est liée au sentiment, en particulier à la
pitié et à la souffrance d’autrui. Justice et Charité, vertus fondamentales de l’éthique, contredisent la
nature et le monde où se joue le vouloir-vivre, la lutte égoïste et la souffrance. Frédéric Nietzsche
(1844-1900)10 s’élève au-dessus de toute morale au nom de l’éthique de Zarathoustra et Emile
Durkheim confond la valeur avec sa nature sociale et fonde un sociologisme moral (dans “l’éducation
morale”) (Daval et Guillemain, 1952, 626 p.).
4.2 Horizon culturel des valeurs
Il se peut que des “valeurs ultimes” soient également « indémontrables », comme le pense

Sens de l’éducation-2001/2002-René Barbier
3
Max Weber (1864-1920)11, ce que conteste Léo Strauss dans une étude sur “le relativisme”. Il lui
paraît absurde de dire “qu’en l’état actuel et futur de nos connaissances sur cette terre, ou devant le
tribunal de la raison humaine, les modes de vie recommandés par Amos ou Socrate ont une valeur
égale au mode de vie de spécialistes sans élévation d’esprit ni hauteur de vues, ou de sybarites sans
cœur” (Strauss, 1986, p. 196).
4.2.1 Valeurs objectives existent-ils ?
G. Lukacs (1885-1971) s’opposait à Max Weber croyant à une science sociale “libérée
des valeurs” en soutenant qu’elle ne pouvait devenir objective et évaluative qu’à condition de
comprendre les phénomènes sociaux particuliers à la lumière de la situation sociale d’ensemble et du
processus historique global. Avec Nietzsche, nous assistons à la limitation essentielle de l’histoire
objective et de la connaissance objective en général. Les diverses valeurs respectées à diverses
époques n’ont pas de support objectif en tant que questions humaines. Elles doivent leur existence à
un libre projet humain qui forme l’horizon d’une culture.
Mais ce que l’homme, dans le passé, faisait inconsciemment et dans l’illusion de se
soumettre à ce qui est indépendant de son acte créateur, il lui faut à présent le faire consciemment. Et
ce projet d’une réévaluation de toutes les valeurs entraîne le rejet de toutes les valeurs antérieures
puisqu’elles ont perdu tout fondement depuis qu’est apparue sans fondement leur prétention à une
validité objective. Mais c’est précisément la compréhension de l’origine de tous ces principes qui rend
possible une création nouvelle, présupposant cette compréhension et en accord avec elle, bien qu’elle
n’en soit pas déductible.
Pour l’existentialisme12, l’homme est un abîme de liberté. Il est contraint de choisir sans
pouvoir fonder son choix d’une manière fondamentale. Cette manière d’être de l’homme face au
néant s’appelle “Existenz” qui peut être authentique ou inauthentique suivant qu’elle assume ou non
ce face à face au néant. Mais elle s’appuie quand même sur une valeur principale : le caractère absolu
de la connaissance finie de la finitude humaine. Chaque culture est ainsi porteuse de valeurs
essentielles.
4.2.2 Valeurs chez l’autre
S’agissant de l’Afrique Noire par exemple, les trois séries de représentations du social,
de la personne et de la sorcellerie ne sont pas arbitraires, mais appartiennent à des univers ayant
chacun leur cohérence interne et une “cohérence transversale, si l’on peut dire, qui tient
notamment à leur présupposé commun : le postulat de la sur-réalité.” (Marie, 1986, p. 183).
Difficile de cerner, chez l’autre, ce qui est du ressort de ses valeurs ultimes.
Au Japon par exemple, sont-ce l’obéissance, la loyauté, l’honneur, le courage du
samouraï sans cesse exaltés par les média ? Jeanne Sigée aurait tendance à contester cette affirmation
rapide pour souligner plutôt les valeurs « Japon » (l’Election d’un peuple élu, le narcissisme, la

Sens de l’éducation-2001/2002-René Barbier
4
vocation impériale) ; « Terrain » (le prix du mètre carré) ; « Combat » (le sens de la vie : chaque
destin individuel, enserré dans d’étroites limites, débouche sur un au-delà ouvert à l’infini). “Ce que
nul ne peut espérer atteindre seul, se gagne, au moins mythiquement, par l’action combattante
concertée, la participation au combat collectif” (Sigrée, 1986, p. 132). Mais “le combat s’inscrit
dans un système où d’autres valeurs telles que le plaisir, ou ce que j’appelle “la fleur” viennent
l’encadrer, le polir” (p.134).
4.3 Valeurs ultimes
J’appelle “valeur” ce que, au nom de quoi, nous acceptons de risquer quelque chose
nous tenant à cœur et “valeur ultime” ce qui est de l’ordre d’un risque essentiel (perdre sa vie, la vie
de ceux qui nous sont proches, perdre des objets sociaux très investis). On comprendra facilement
que les “valeurs ultimes” sont en nombre limité. Quiconque accepte de se regarder en face, admet ce
fait. Nous touchons à nos valeurs ultimes lorsque nous sentons que notre sens de la vie est en cause.
D’une certaine façon chaque individu est porteur de valeurs ultimes spécifiques, mais j’appellerai une
“personne” l’individu qui a découvert que certaines de ses “valeurs ultimes” sont communes à
l’ensemble de la communauté humaine (Reboul, 1989)13.
La philosophie “personnaliste” d’Emmanuel Mounier (1905-1950)14 a largement mis en
lumière la différence entre individualisme, anarchisme et personnalisme. Pour Mounier, la personne
immerge dans la nature. Elle est à la fois et indissolublement corps et esprit. Elle s’oppose ipso facto à
la réduction matérialiste comme à celle du spiritualisme. Mais la personne transcende la nature par sa
dynamique créatrice et complexe, première marche d’un processus de personnalisation universelle
(Mounier, 1967).
La défense des valeurs ultimes d’une personne face aux attaques de son environnement,
constitue ce par quoi elle s’estime “rattachée à la vie”, c’est-à-dire son implication suivant la
pertinente remarque de Jacques Ardoino. Se peut-il, comme le pense Cornelius Castoriadis (1996),
que des “valeurs” soient inventées par l’imaginaire social d’une époque et résistent à la
dégénérescence temporelle, comme l’invention de l’idée démocratique sous la Grèce antique par
exemple ? Se peut-il que l’invention (ou la découverte ?) de l’amour par le Christianisme comme
mouvement social soit établie une fois pour toute dans l’esprit de l’humanité, même s’il n’est que très
provisoirement réalisé, et par le biais d’une victime émissaire (Girard, 1978) ? Se peut-il que l’idéal
révolutionnaire d’égalité, de liberté et de fraternité puisse s’accomplir de mieux en mieux dans
l’histoire des peuples et des nations ? A moins qu’il ne soit, comme le pense Marcel Gauchet
(1997(1985), 306 p.), complètement inadapté à toute réalisation démocratique.
Toutes les valeurs ne sont-elles pas éphémères et conjoncturelles ? Ne constituent-elles
pas, justement, le noyau dur de toute culture dont on sait la relativité, ce qui différencie la culture de la
nature. Ce point de vue n’est pas que théorique, il est fondamentalement philosophique et détermine,
dans une large mesure, l’attitude et les comportements de chacun devant la vie, avec deux risques

Sens de l’éducation-2001/2002-René Barbier
5
majeurs :
- celui du pessimisme radical et de l’idée que “l’homme est un loup pour l’homme”
- celui de l’optimisme béat qui se refuse à évaluer les ruptures, les distorsions, les écarts
avec un idéal absolu de pureté.
Nous n’arrivons pas vraiment à nous prononcer en faveur de l’une ou l’autre option.
Nous ne pouvons pas non plus accepter une altération de chacune de ces deux options dans le
processus de la vie courante, c’est la raison pour laquelle nous restons sans voix et sans projet devant
les interrogations de la jeunesse contemporaine.
4.3.1 Question de l’éthique
J’appelle “éthique” une congruence axiologique réduite aux valeurs ultimes d’un sujet
(personne , groupe social et communauté humaine plus large) permettant à ce dernier de donner un
“sens” à son rapport au monde : sens dans une acception à la fois de significations radicales, de
direction de vie et d’émergence d’une sensibilité incorporée.
Sous cet angle, nous pouvons soutenir qu’une “valeur est intimement liée à l’individu
et à sa conduite. Elle est intérieure à l’individu et elle nomme ses gestes quotidiens… Par
contre il convient de noter qu’une valeur individuelle n’est pas statique. Au fur et à mesure de
nos expériences de vie, elle se consolide ou encore elle se transforme” (Paquette, 1982, p. 22).
4.3.1.1 Valeurs chez C. Paquette
Pour C. Paquette, il faut distinguer les valeurs de préférence et les valeurs de
référence. Les premières sont choisies parmi un ensemble de valeurs mises à la disposition d’une
personne par le corps social et que celui-ci valorise. Il y a une sorte d’articulation de l’individuel et du
collectif dans ce choix.
Mais les secondes valeurs font “référence” pour la conduite d’un individu. Elles
s’intègrent à la personne et la constituent. Elles sont à la fois plus exigeantes et plus engageantes vis-à-
vis d’autrui comme vis-à-vis de soi-même. Pour C. Paquette huit critères permettent l’identification
d’une valeur :
- Elle est un choix pour l’individu.
- L’individu a une connaissance des conséquences du choix de cette valeur.
- Elle est observable dans les gestes quotidiens.
- Elle donne un sens, une direction à son existence.
- L’individu y est attaché.
- L’individu l’affirme publiquement.
- L’individu s’implique publiquement dans des activités qui en font la promotion.
- Pour l’individu, il y a une forte interaction entre sa vie personnelle et professionnelle.
(p. 31). Toute valeur semble provenir d’une conjonction de facteurs : un patrimoine
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%