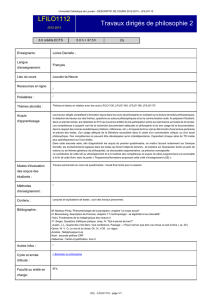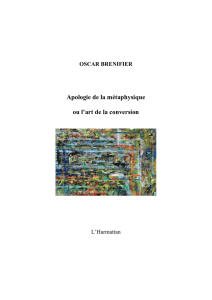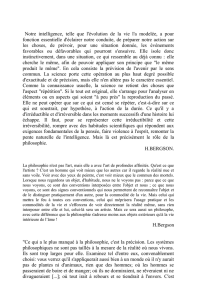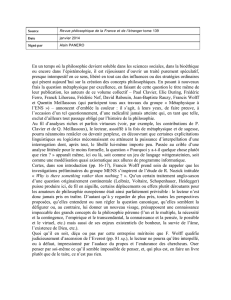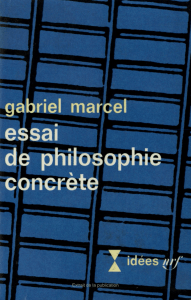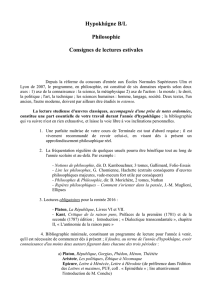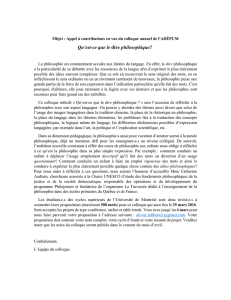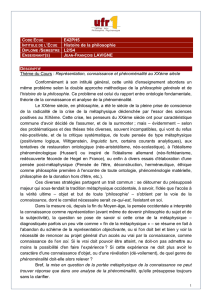Considérations philosophiques sur le fantôme divin, le monde réel

Considérations philosophiques sur le
fantôme divin, le monde réel et l’Homme

Confession, PUF, 1974.
Dans les griffes de l’ours !, Les Nuits Rouges, 2010.
De la guerre à la Commune, Anthropos, 1972.
Dieu et l’État, L’Altiplano, 2008.
Le sentiment sacré de la révolte, Les Nuits Rouges, 2004.
Le Socialisme libertaire, Denoël, 1973.
Œuvres complètes, vol. à , Ivréa, 1973-1982.
Théorie générale de la révolution, Les Nuits Rouges, 2008.
Trois conférences faites aux ouvriers du Val de Saint-Imier, Canevas, 1990.

CONSIDÉRTIONS
PHILOSOPHIUES
SUR LE FNTÔME
DIVIN, LE MONDE
RÉEL ET L’HOMME
Essa
Texte établi et annoté
par Arthur Lehning
Introduion
de Jean-Chriophe Angaut
Genève

Les Considérations philosophiques sur le Fantôme divin, sur le monde rl et sur l’Homme
ont été publis pour la première fois par James Guillaume
en appendice de L’Empire Knouto-Germanique et la Révolution sociale (Œuvres, Tome ,
P.-V. Stock, Paris, 1908). Puis par A. Lehning dans M. Bakounine,
Œuvres complètes (vol. , Paris, Champ Libre, 1982).
:
Entremonde, 2010

INTRODUCTION
B, — Écrites par Bakounine au
cours de l’hiver 1870-71, entre l’échec de l’insurreion lyonnaise à laquelle
il a participé et la Commune de Paris dont il sera un partisan, les Considérations
philosophiques sur le fantôme divin, sur le monde réel et sur l’homme pourraient
surprendre qui ne connaît du révolutionnaire russe que l’image qu’en a
donné l’hioriographie ocielle, dans ses variantes réaionnaire, libérale
ou marxie : celle d’un tenant des « théories irrationnelles de l’emploi
immédiat de la violence » ¹, d’un homme « prêt […] à patauger dans des
fleuves de sang » ² ou encore d’un personnage dont « l’héritage fut cette
seule idée que l’État, c’était le mal et qu’il fallait le détruire » ³. Il n’e
pourtant pas queion ici de donner de Bakounine l’image exaement
inverse et d’en faire l’auteur de théories désincarnées, conçues à l’écart de
toute pratique politique, mais bien plutôt de comprendre le atut et la
teneur d’un texte qui se présente expressément comme philosophique.
La philosophie occupe une place particulière dans le parcours personnel
et politique du révolutionnaire russe. Né en 1814 dans une famille de la
noblesse russe, Mikhaïl Alexandrovitch Bakounine, après avoir échappé
à la carrière militaire à laquelle le deinait sa famille, s’initie à la philo-
sophie allemande dans un groupe d’autodidaes connu sous le nom
de Cercle de Stankevitch. Il se passionne successivement pour Kant,
Fichte et Hegel, et c’e en partie pour approfondir sa connaissance de la
philosophie allemande qu’il quitte la Russie pour l’Allemagne en 1840.
Mais l’Allemagne le guérit de ses passions métaphysiques : commençant
à fréquenter les milieux démocrates et la gauche hégélienne, Bakounine
publie en 1842 « La Réaion en Allemagne » , brillant article dans lequel il
annonce la fin de son parcours philosophique et son abandon de la théorie
pour la pratique révolutionnaire, puisque le point d’aboutissement de la
philosophie, c’e précisément de reconnaître ses propres limites, au-delà
desquelles commence un domaine qu’elle ne peut régir, celui de la pratique
hiorique, sociale et politique.
1. Carl Schmt, Parlementarisme et Démocratie, Paris, Seuil, 1988, p. 83.
2. Isaiah Berlin, Les Penseurs russes, Paris, Albin Michel, 1984, p. 155.
3. Francis Whn, Karl Marx, Londres, Fourth Eate, 1999, p. 318 (traduion ançaise :
Marx – Biographie inaendue, Paris, Calmann-Lévy, 2003).
4. J’ai proposé une traduion et un commentaire de ce texte, ainsi que d’autres de la même
période, dans Bakounine jeune hégélien – La Philosophie et son dehors, Lyon, ENS Édions, 2007.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
1
/
128
100%