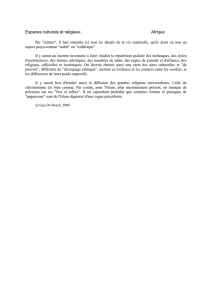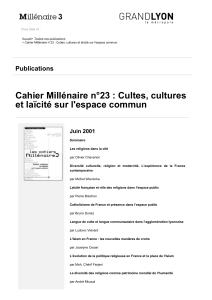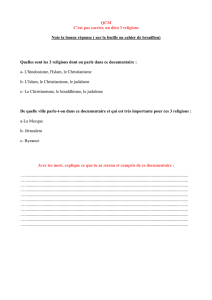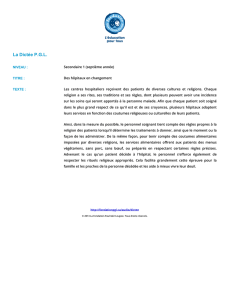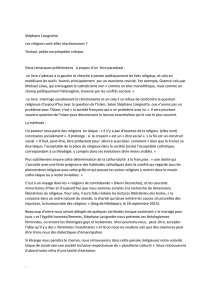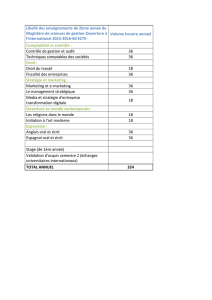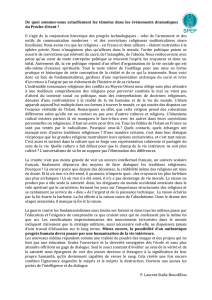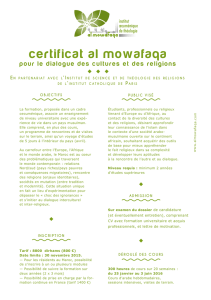Nostra Aetate - Diocèse d`Evry

1
NostraAetate
Larédaction
AudébutduConcile,personnen’estenmesured’imaginerunedéclarationconciliairespécifiquesurlesrelationsdel’Église
aveclesreligionsnonchrétiennes.
Lecontexte
AudébutduConcile,lesreligionsnonchrétiennesnepréoccupentguèrelesévêquesetlesorganismesquiy
travaillent.Aucunévêqued’Europeoud’Amériquen’abordelaquestion.Quantauxévêquesde«paysdemission»,ils
évoquentlargementlesproblèmesmissionnaires,maistrèspeulesreligionsnonchrétiennesentantquereligions.Les
évêquesdesÉglisesorientalesquisontconfrontéesdemanièrequotidienneauxautresreligions,restentégalement
silencieuxsurlaquestion.
Parcontre,lavolontéd’ouverturedePaulVIalargementcontribuéàladéclarationNostraAetateetauxincisessurles
autresreligionsdansLumenGentiumetAdGentes.
‐ SonvoyageenTerreSainteenjanvier1964aétéunmomentimportantavecnotammentsonmessagedepaixadresséde
Bethléempourleschrétiensetlemondeoùils’adresseexplicitementàceuxquiprofessentlemonothéisme.
‐ DanssonmessagedePâquesradiodiffuséaumondele29mars1964,ildéclare:«Toutereligionpossèdeunrayondelumière
quenousnedevonsnimépriser,niéteindre,mêmes’ilnesuffitpasàdonneràl’hommelaclartédontilabesoin,niàréaliserle
miracledelalumièrechrétienneenquiserejoignentlavéritéetlavie.Maistoutereligionnousélèveversl’Êtretranscendant,
uniqueraisond’êtredel’existence,delapenséeetdel’actionresponsable,del’espérancesansillusion.Toutereligionestune
aubedefoi,etnousnousattendonsàcequ’elles’épanouisseenauroreetdanslaradieusesplendeurdelasagesse
chrétienne.1»
‐ Toujoursen1964,enlienaveclesdiscussionsduconcile,ildécidelacréationd’unSecrétariatpourlesNon‐chrétiens2.
‐ Troismoisplustardilpubliel’encycliqueEcclesiamSuamoùilinviteà«reconnaîtreavecrespectlesvaleursspirituelleset
moralesdesdifférentesconfessionsreligieusesnonchrétiennes»etavecellesà«promouvoiretdéfendrelesidéauxquenous
pouvonsavoirencommundansledomainedelalibertéreligieuse,delafraternitéhumaine,delasaineculture,dela
bienfaisancesocialeetdel’ordrecivil3».
‐ Endécembre1964,PaulVIserendenIndeets’entretientavecdesreprésentantsdesdifférentesreligionsdel’Inde,allant
jusqu’àutiliserpourprieruneparoletiréedelivressacréshindous4.CommelereconnaîtPaulVIlui‐mêmedanssesdiscours
prononcésàproposdel’ouverturedusecrétariatpourlesnon‐chrétiens,ilya,àcettepériode,unesaineémulationentreces
différentsactespontificauxetlaréflexiondespèresconciliaires5.
Finalement,lesreligionsnonchrétiennessontévoquéesplusieursfoisdanslestextesduconcile,principalementdansla
déclarationNostraAetatesurlesrelationsdel’Égliseaveclesreligionsnonchrétiennes,maisaussidanslaconstitutionsur
l’Église,LumenGentium,ainsiquedansledécretsurl’activitémissionnairedel’Église,Adgentes.Desexpressionsdeces
documentssontégalementreprisesdansGaudiumetSpes.
Troisétapesdanslarédaction
‐ En1961,JeanXXIII,quiavaitété,lorsdesonministèreauVicariatApostoliqued’Istanbul,spécialementsensibleàla
tragédiedupeuplejuifpendantlasecondeguerremondiale,demandeauCardinalBeadepréparerunbrefDecretumde
Judaeisquiseraitajoutéaudécretsurl’œcuménisme,envued’instaurerunnouveauclimatdeconfianceentrechrétienset
juifs.
‐ Laprésentationdecetexteennovembre63amènebeaucoupdequestions,tantsurleregardportéparl’Églisesurles
juifs,quesurl’opportunitépolitiqued’unteldocument,aumomentoùlestensionsnecessentdes’accroîtreentrel’État
d’Israëletlespaysarabes6.Lesévêquesdumondearabefontremarquerqu’unteldécretdoitêtreséparédudocumentsur
1 Message de Pâques radiodiffusé au Monde, Insegnamenti 1964 II, p. 282 Gi 192.
2 Lettre Apostolique Progrediente Concilio du 19 mai 1964 : « Le déroulement du deuxième concile du Vatican a
montré l’utilité de créer un organisme spécial ou secrétariat dont la tâche serait d’atteindre pour leur bien ceux
qui sont étrangers à la religion chrétienne (…). Cette ardeur de la divine charité doit presser l’Église qui
poursuit l’œuvre du Christ, principalement à notre époque où s’établissent de multiples relations entre les
hommes de toute race, de toute langue et de toute religion ».
3 Ecclesiam Suam n°112 (1964), Gi 134.
4 « Rarement, cette attente de Dieu a été exprimée avec des paroles aussi pleines de l’esprit de l’Avent que celles
écrites dans vos livres sacrés, de nombreux siècles avant le Christ : « De l’irréel, conduis-moi au réel ; de
l’obscurité, conduis-moi à la lumière ; de la mort, conduis-moi à l’immortalité » » in Insegnamenti II 1964, p.
965, Gi n°199.
5 Lettre Apostolique Progrediente Concilio du 19 mai 1964 ; Allocution aux fidèles en la solennité de la
Pentecôte le 17 mai 1964, Insegnamenti II 1964, p.481-482, Gi 194-195 ; Discours au Collège Cardinalice du 23
juin 1964, Insegnamenti II 1964, p.577, Gi 196.
6 Cf. Ricardo BURIGANA et Giovanni TURBANTI, in Giuseppe ALBERIGO, Histoire du concile Vatican II, vol. IV :

2
l’œcuménismeetquesionabordeunereligionnon‐chrétienne,ilfauttouteslesaborder,notammentl’islam.
‐ Cen’estqu’àlaquatrièmesessionduconcile,en1964,queladéclaration,danssaformeactuelle,s’estélaborée,avec
l’aidedesexpertssurlesreligionsnonchrétiennes7.Aumêmemoment,laconstitutionLumenGentiumsurl’Égliseétait
promulguée(21novembre)etledécretAdGentessurl’Activitémissionnaireétaitbienavancé.Iln’estdoncpasétonnant
qu’ilyaituneprofondeunitéentreles§16et17deLumenGentiumsurlesnon‐chrétiensetlecaractèremissionnairede
l’Église,lesquelquesaffirmationsdeAdGentessurlesreligionsnonchrétiennes(aux§3.9.11)etladéclarationNostra
Aetate.
LumenGentiumetAdGentesneconsacrantquepeudelignesauxreligionsnonchrétiennes,n’ontpascherchéà
caractériserlesdifférentesreligions(LumenGentiumcitelejudaïsmeetl’islamdemanièretrèsrapideetregroupeenune
phraselesautresreligions).
Laperspectiveétaittriple:
‐ réaffirmerlapossibilitédesalutdespersonnessesituantendehorsdel’Église8,
‐ soulignerlesvaleursauthentiquesquiexistentchezlesnon‐chrétiensetdansleurtraditionreligieuse;
‐ etbiensûr,donneruneappréciationdecesvaleursparl’Église.
QuantàNostraAetate,laperspectivedespèresn’étaitpasd’élaboreruneréflexiondogmatiquesurlesreligions,maisde
faireunedéclaration,dansuneperspectivevolontairementpositive,pour«favoriseretfairegrandirlapaix,l’unitéetla
concordeentreleshommesetlesnations»9.L’accentestvolontairementmissur«cequeleshommesontencommunetqui
lespousseàvivreensembleleurdestinée»(§1)etnonsurcequidivise.Enjouantsurlesmots,onpeutdirequ’ilyaune
attentionthéologiquedansl’élaborationetlarédactiondeladéclaration,maisiln’yapasl’intentionthéologiqued’élaborer
unedoctrinecomplètesurlesliensquiexistententrelafoichrétienneetlesautresreligions.D’autresdocuments
conciliairesfontaussiallusionauxreligionsnonchrétiennesdemanièreimplicite(DH2‐4,GS22,5.73.75)ouexplicite(DV
25,AA27).
Les débats théologiques discutés pendant le concile à propos de NA :
Considérations générales
‐ La plupart des débats de fond à propos de la déclaration n’étaient pas théologiques, mais portaient davantage sur l’opportunité de
nommer certaines religions plutôt que d’autres ou sur la manière d’évoquer la responsabilité des juifs dans la mort du Christ...
‐ Néanmoins, des opposants irréductibles à la déclaration l’ont fait savoir jusqu’au bout : d’une part des évêques opposés à toute
ouverture de l’Église à des religions non chrétiennes (en particulier le judaïsme), d’autre part des évêques orientaux qui
considéraient que le texte pouvait être interprété comme une position pro-israélienne, enfin quelques évêques qui n’avaient pas
accepté que l’on retire du texte la mention de la culpabilité du peuple juif dans la mort de Jésus et la notion de déicide.
‐ Trois jours avant le vote final, un groupe d’évêques a fait passer un document invitant à condamner sans appel la déclaration10, à
cause d’une opposition aux présupposés mêmes du schéma : l’idée d’un dialogue avec les religions non chrétiennes s’oppose,
selon eux, au devoir « d’annoncer le vérité du Christ ». La recherche d’un « dénominateur commun » ou d’un « terrain
d’entente » est théologiquement injustifiable : comment peut-on laisser sous-entendre qu’il y aurait des éléments communs entre
la Trinité et des « éléments de la mythologie hindouiste » ? Finalement, pour ce groupe d’évêques, « la déclaration atténue les
différences entre le christianisme et les autres religions, ce qui d’une part retarde la conversion des peuples et d’autre part éteint
et affaiblit l’élan vers les vocations missionnaires »11 .
L’Église en tant que communion, ch. 7 : La dernière intersession, Cerf, Paris, 2003, pp. 664-680.
7 Cf. G.M.-M. COTTIER, « L’historique de la déclaration » in A.-M. HENRY (dir), Les relations de l’Église avec
les religions non chrétiennes, coll. Unam Sanctam n°61, Cerf, Paris, 1966, pp. 37-78., voir aussi la chronologie
pp. 285-286. Voir également Maurice BORRMANS, « L’émergence de la déclaration Nostra Aetate au Concile
Vatican II », Islamochristiana n°32, Pisai, Roma, 2006, pp. 9-28.
8LumenGentium16considèrequedansl’ensembledesreligions,«ceuxquicherchentpourtantDieud’uncœur
sincèreets’efforcent,sousl’influencedesagrâce,d’agirdefaçonàaccomplirsavolontétellequeleur
consciencelaleurrévèleetlaleurdicte,ceux‐làpeuventarriverausalutéternel».Demême,ceuxqui«sans
fautedeleurpart,nesontpasencoreparvenusàuneconnaissanceexpressedeDieu,maistravaillent,non
sanslagrâcedivine,àavoiruneviedroite,ladivineProvidencenerefusepaslessecoursnécessairesàleur
salut».Dieu,parsagrâcepeutleurdonnerlesalutenlesassociantaumystèrepascal«d’unefaçonque
Dieuconnaît»(GS22,5)
9 C’est en ces termes que le Cardinal Bea, chargé d’élaborer le texte, invite les pères à accepter sa proposition de
supprimer dans la déclaration la mention du déicide. Cf. G.M.-M. COTTIER, « L’historique de la déclaration » op.
cit. P 77.
10 Cf. Mauro VELATTI, in Giuseppe ALBERIGO, Histoire du concile Vatican II, vol. V: Concile de Transition, ch.
2 : L’achèvement de l’ordre du jour conciliaire, Cerf, Paris, 2005, pp. 264-274. Le document intitulé
Suggestiones circa suffragationes mox faciendas de Schemate : « De ecclesiae habitudine ad religiones non
christianas », était précédée d’une lettre d’accompagnement signée de trois évêques : G. de Provença Sigaud, M.
Lefebvre et L.M. Carli.
11 Ibid. p. 267.

3
Considérations particulières :
La manière de parler des différentes religions a souvent été également l’occasion de désaccords qui laissent apparaître des
divergences de fond sur le regard que les chrétiens doivent porter sur les autres religions. Robert Caspar note ainsi que le
groupe des théologiens chargés d’élaborer les textes sur l’islam12 révèle deux tendances dans la manière de situer l’islam dans
l’histoire du salut. Ces deux tendances se retrouvent, selon lui, de manière plus globale, au niveau de la théologie des
religions non chrétiennes :
‐ « Certains sont plus sensibles aux éléments communs et font de l’Islam un rameau de la tradition biblique. On parlera alors de
l’Islam comme un schisme pré-biblique, d’une hérésie abrahamique, d’une hérésie du judaïsme post-christique ou même d’une
hérésie chrétienne.
‐ D’autres, plus sensibles aux différences et à l’originalité de la lignée biblique, admettent difficilement que l’islam en soit une
dérivation. Il se serait constitué de l’extérieur, en contact certes avec le judaïsme et le christianisme, en leur empruntant de
nombreux traits, mais sans y être vraiment insérés. L’islam serait le fruit d’un effort humain, avec ou sans la grâce divine ; il
serait une « religion naturelle » ou une secte du genre des sectes judéo-chrétiennes des premiers siècles ».
Le texte de Nostra Aetate
Le préambule de Nostra Aetate (NA1)
•L’unitédugenrehumain
Cepointdedépartdelaréflexionsurlesrelationsdel’Égliseaveclesreligionsnonchrétiennesestditd’uneautremanièrepar
LumenGentium16:«Dieului‐mêmen’estpasloind’euxnonplus,puisqu’ildonneàtouslavie,lesouffleettouteschosesetquelesauveur
veutlesalutdetousleshommes.»CetteunitéseretrouveégalementmentionnéeautermedeladéclarationNostraAetatequiinviteà
construireunefraternitéuniverselle.C’estdoncunélémentessentieldansleregardqueportel’Églisesurladémarchereligieusedes
membresd’autresreligions13
•Latâchedel’Eglise:promotiondel’unitéetdelacharitéentretousleshommes
•Regardercequeleshommesontencommunpourvivreensemble
•Labasedecesrelations:l’unitédelacommunautéhumaineetlesquestionsexistentiellescommunes
Lesdiversesreligionsnonchrétiennes(NA2)
Lefaitd’abordernommémentlesreligionsaétéassezdiscutédurantleconcile14.Cependant,unefoisquecela
étaitdécidé,lescritèresdechoixpoursavoirdequellereligionilfallaitexplicitementparleretdequellemanièreonpouvait
lefairen’étaientpasévidents.LeschémaadoptépourNostraAetate15fonctionneparcerclesconcentriquesinversesde
ceuxdeLumenGentium16:ilpartd’uncerclelargequienglobel’ensembledesreligions,distingueensuitelesreligions
«liéesauxprogrèsdelaculture»,c’est‐à‐direlesreligionsquiontunelittératurereligieuseetquidisentquelquechose
d’elles‐mêmes.Sontcitéesparmicesreligions:l’hindouismeetlebouddhisme.Ladéclarationconsacreensuiteun
paragrapheàl’islam,puisunparagraphepluslongaujudaïsme.Celasignifiequecequiestditdanslepremiercercleà
proposdel’attitudereligieusedesreligionsnonchrétiennesengénéralconcerneaussilescerclesplusrestreints.
Leschéman’estévidemmentpassansambiguïté,carilsous‐entendunrapportdeproximitéavecleChristianisme
quivagrandissantdepuislesreligionstraditionnellesjusqu’aujudaïsme,cequiestassezdiscutableetquiaétéd’ailleurs
12 Essentiellement des Pères Blancs de l’Institut Pontifical d’Études Orientales de Tunisie (depuis transféré à
Rome) et des dominicains de l’Institut Dominicain d’Études Orientales du Caire. Cf. R. CASPAR, « La religion
musulmane », op. cit., p. 214.
13 Ce sera d’ailleurs l’élément théologique déterminant pour justifier théologiquement ce qui s’est passé à la
rencontre d’Assise en 1986, lorsque les représentants des différentes religions étaient ensemble pour prier. Dans
le discours à la Curie du 22 décembre 1986, Jean-Paul II rappelait que « En cette Journée, en effet, et dans la
prière qui en était le motif et l’unique contenu, semblait s’exprimer pour un instant, même de manière visible,
l’unité cachée mais radicale que le Verbe divin, «dans lequel tout a été créé et dans lequel tout subsiste» (Col 1,
16; Jn 1, 3), a établie entre les hommes et les femmes de ce monde, ceux qui maintenant partagent ensemble les
angoisses et les joies de cette fin du XXe siècle, mais aussi ceux qui nous ont précédés et ceux qui prendront
notre place ‘jusqu’à ce que vienne le Seigneur’ ».
14 Les pères du Concile ont bien conscience des risques de nommer les différentes religions ; que ce soit le risque
de récupération politique dans la région du Moyen-Orient ou le risque d’une réduction essentialiste (d’une part,
la perception chrétienne de l’autre semble réductible à ce qu’on en dit, et d’autre part, les religions ne sont pas
prises en compte dans leur évolution permanente, dans leur interaction constante avec d’autres religions et
d’autres cultures).
15 Pour simplifier la compréhension, j’utilise le nom usuel par lequel on désigne la déclaration, à savoir les deux
premiers mots latins de la déclaration. En réalité, le nom et l’objet et le statut de la déclaration ont changé
plusieurs fois pendant le concile : « Decretum de judaeis ou pro judaeis », « Du rapport des catholiques aux non-
chrétiens et principalement aux juifs » (qui était le ch IV du décret du l’œcuménisme) , « Déclaration sur les juifs
et les non-chrétiens », puis finalement : « Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non
chrétiennes ».

4
contestéparplusieurspèrespendantleconcile16.Lebutvisén’estplusdedonnerdesélémentsquipermettentd’affirmer
unepossibilitédesalut,maisderepérerlesélémentsquidanscesreligionspeuventfavoriserunemeilleureententeentre
lesmembresdesdifférentesreligionsetpermettreundialogueetunecollaboration(§2).Cesontdoncvolontairementdes
élémentspositifsetanaloguesquisontsoulignés.
Les diverses religions non chrétiennes (NA2)
Cequiestditdanslepremiercercleconcernedoncl’ensembledesreligionsnonchrétiennesetvisenotammentlesreligions
traditionnelles17:
‐«unecertainesensibilitéàcetteforcecachéequiestprésenteaucoursdeschosesetauxévénementsdelaviehumaine»,
‐«parfoisunereconnaissancedelaDivinitésuprême,ouencoreduPère»,
‐«unprofondsensreligieux».
Pourlesreligions«liéesauprogrèsdelaculture»ilestditdemanièregénérale:
‐«elless’efforcentd’aller,defaçonsdiverses,au‐devantdel’inquiétudeducœurhumainenproposantdesvoies,c’est‐à‐dire
desdoctrines,desrèglesdevieetdesritessacrés».
Desprécisionssontdonnéespourl’hindouisme:
‐«Leshommesscrutentlemystèredivinetl’exprimentparlaféconditéinépuisabledesmythesetparleseffortspénétrants
delaphilosophie;ilscherchentlalibérationdesangoissesdenotrecondition,soitparlesformesascétiques,soitparla
méditationprofonde,soitparlerefugeenDieuavecamouretconfiance.»
etpourlebouddhisme:
‐«Selonsesformesvariées,l’insuffisanceradicaledecemondechangeantestreconnueetonenseigneunevoieparlaquelle
leshommes,avecuncœurdévotetconfiant,pourrontacquérirl’étatdelibérationparfaite,soitatteindrel’illumination
suprêmeparleurspropreseffortsouparunsecoursvenud’en‐haut».
La religion musulmane (NA3)
Encequiconcernel’islam,leconciledéveloppedavantagedepointssurlesquelspourraits’appuyerledialogue:
‐LeculterenduauDieuunique:«IlsadorentleDieuun,vivantetsubsistant,miséricordieuxettout‐puissant,créateurdu
cieletdelaterre,quiaparléauxhommes».Lefaitdereconnaîtrequ’ilaparléauxhommesdistinguel’islamdetousles
théismes.Ilyaunerévélationdansl’islam.Cetteaffirmationnecomporteaucunjugementdevaleur,positifounégatif,sur
l’authenticitédecettedéclaration,maisditquelquechosedel’objetdefoidansl’islam:unDieuquiserévèle18.
‐L’attitudederemisedesoiàDieu:«IlscherchentàsesoumettredetouteleurâmeauxdécretsdeDieu,mêmes’ilssont
cachés,commes’estsoumisàDieuAbraham,auquellafoiislamiqueseréfèrevolontiers.»Abrahamn’estpascitéiciavec
l’idéedesoulignerunelignéecommune,maiscommemodèledefoidonnéparlesmusulmanseux‐mêmes.
16 La question est de savoir quel est le critère de proximité : est-ce le fait de pouvoir nommer dans les autres
religions des éléments qui seraient analogues aux nôtres, est-ce le fait d’avoir des Écritures qui font références
aux mêmes prophètes, est-ce la capacité d’ouverture au christianisme ? Au moment des discussions pour savoir
quelles religions la déclaration devait nommément aborder, le cardinal Ruffini déclare : « Il faudrait signaler les
autres grandes religions non chrétiennes, en même temps que la religion musulmane, ou sinon parler de toutes
en général sans en nommer aucune, car les musulmans ne sont pas plus proches de nous que les hindous ou les
bouddhistes ». Mrg Gahamanyi estime que : « la Déclaration est trop louangeuse pour les juifs et les
musulmans. Le Judaïsme et l’Islam sont des doctrines fermées au Christianisme, bien qu’ils présentent avec lui
des éléments communs. Il y a d’autres éléments communs entre le christianisme et d’autres religions non
chrétiennes, parmi lesquelles l’Animisme, qui est plus ouvert au Christianisme que le Judaïsme ou l’Islam ».
(DC n°1435, col 1380.1389, cité par H. MAURIER, in A.-M. HENRY (dir), Les relations de l’Église avec les
religions non chrétiennes, op. cit., p. 125 en note.).
17 Le fait de les opposer aux « religions liées au progrès de la culture » (§2) n’est pas jugée très heureuse par les
chrétiens engagés auprès des religions traditionnelles asiatiques ou africaines, car d’une part la déclaration
semble opposer des manières radicalement différentes de vivre la démarche religieuse, ce qui n’est pas le cas (le
rapport à la transcendance, aux mythes et aux rites est tout aussi fort dans une religion traditionnelle) ; d’autre
part elle peut sous-entendre une minimisation des cultures orales et en déduire une sous-évolution de leurs
religions. Dans le commentaire de la déclaration (A.-M. HENRY (dir), Les relations de l’Eglise avec les religions
non chrétiennes, op. cit.), le P. Dournes, missionnaire auprès des Jörai en Asie, et le P. Maurier, missionnaire en
Afrique, vont tous les deux dans ce sens.
18 230 pères avaient proposé un modus pour LG 16 dans lequel était inséré « il a parlé aux hommes par des
prophètes », mais celui-ci a été refusé par la commission théologique, parce qu’il pouvait laisser croire que les
pères reconnaissait que Dieu avait parlé par Mohammed. (Cf. R CASPAR in (A.-M. HENRY (dir), Les relations de
l’Église avec les religions non chrétiennes, op. cit., p. 218).

5
‐ LaplacedeJésusetMariedansl’islam:«Bienqu’ilsnereconnaissentpasJésuscommeDieu,ilslevénèrentcomme
prophète;ilshonorentsaMèrevirginale,Marie,etparfoismêmel’invoquentavecpiété».
‐Ladimensioneschatologiquedelafoimusulmane:«Deplus,ilsattendentlejourdujugement,oùDieurétribueratousles
hommesressuscités».
‐ Laviemoraleetleculte:«Aussiont‐ilsenestimelaviemorale19etrendent‐ilsunculteàDieu,surtoutparlaprière,
l’aumôneetlejeûne».
LumenGentiuminsistesurlesmêmesaspects,demanièremoinsdéveloppée:ils«reconnaissentleCréateur,»ils
«professentavoirlafoid’Abraham,adorentavecnousleDieuunique,miséricordieux,futurjugedeshommesaudernier
jour»(LG16).
La religion juive (NA4)
Leprojetinitialquiadonnénaissanceàladéclarationétaitdefairementiondupeuplejuif.Deplus,lejudaïsmea
uneplacetoutespécialeparrapportàlafoichrétienne,puisqueleChristianismeenestissu.C’estpourcelaqueNostra
Aetateluiconsacreunlongparagraphe,essentiellementconstruit,commeceluideLumenGentium,àpartirdecitationsdes
lettresdePaul.
‐ L’Églisereconnaîtquelesprémicesdesafoietdesonélectionsetrouvent,selonlemystèredivindusalut,dansles
patriarches,Moïseetlesprophètes.
‐ElleconfessequetouslesfidèlesduChrist,filsd’Abrahamselonlafoi,sontinclusdanslavocationdecepatriarche(Cf.Gal
3,7).
‐Elleconfessequesonsalutestmystérieusementpréfigurédanslasortiedupeupleéluhorsdelaterredeservitude.
‐Ellenepeutoublierqu’elleareçularévélationdel’AncienTestamentparcepeupleaveclequelDieu,danssamiséricorde
indicible,adaignéconclurel’antiqueAlliance.
‐Elleconfessequ’ellesenourritdelaracinedel’olivierfrancsurlequelontétégrefféslesrameauxdel’oliviersauvageque
sontlesgentils(Cf.Rm11,17‐24).
‐ Ellen’oubliepascequePauldisaitdupeupled’Israël«àquiappartiennentl’adoptionfiliale,lagloire,lesalliances,la
législation,leculte,lespromessesetlespatriarches,etdequiestné,selonlachair,leChrist»(Rm9,4‐5).
‐Ellen’oubliepasqueJésus,commesamère,étaitjuif.
LG16évoquelesmêmesaspectsdemanièreplussuccincte:«cepeuplequireçutlesalliancesetlespromesses,etdontle
Christestissuselonlachair(cf.Rm9,4‐5),peupletrèsaimédupointdevuedel’élection,àcausedespères,carDieune
regretteriendesesdonsnidesonappel»(cf.Rm11,28‐29).
La fraternité universelle excluant toute discrimination NA5 :
•Larelationdel’hommeàDieulePèreetlarelationdel’hommeàsesfrèreshumainssontindissociables
•Ladignitéhumaine
•Réprobationdetoutediscriminationetl’exhortationàvivredanslapaix.
‐Leconcilenecherchaitpasàdéfinirun«regardchrétien»surlesautresreligions,mais
− EncequiconcerneLumenGentium,àdonnerquelquesélémentssurlesquelsonpouvaits’appuyerpoursoutenir
quedesmembresdereligionsnonchrétiennespouvaientrecevoirlesalut.
− EncequiconcerneNostraAetate,àrappeler,danslecadred’unedéclaration,desélémentscommunsentrele
christianismeetlesautresreligions,susceptiblesdefavoriserunemeilleureunitéentreleshommes.
CesobjectifsontorientéleConcileàporterunregardvolontairementpositifsurlesautresreligions.NostraAetateappelle
explicitementàuneconversionduregardetdesattitudes.
AdGentesprécisedemanièreplusexplicitequeDieupeutserévélerdanslesecretdesâmes,maisaussiàtravers
des«initiativesreligieuses»(AG3);qu’ilyadesélémentspositifs«devéritéetdegrâce»dans«desritesparticuliers»et
despratiquesde«civilisationsparticulières»(AG9).Làencore,ilnes’agitpasd’unregardgénéralisableàl’ensembledes
religionsnonchrétiennes,maisdelareconnaissanced’unepossibilitéquelesreligionsnonchrétiennescontiennentdes
élémentsdegrâce.
19 Un premier texte était plus explicite : « Ils s’efforcent aussi de mener, en obéissance à Dieu, une vie morale,
aussi bien individuelle que familiale et sociale ». Mais beaucoup de pères s’y sont opposés à cause de la licéité
de la polygamie et du code familial en vigueur dans beaucoup de pays musulmans. (Cf. R CASPAR ibid., p. 226-
227).
 6
6
 7
7
1
/
7
100%