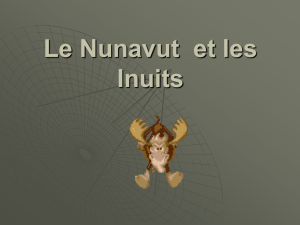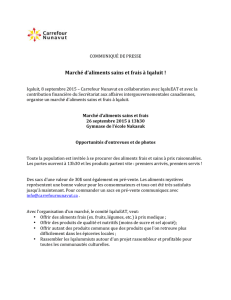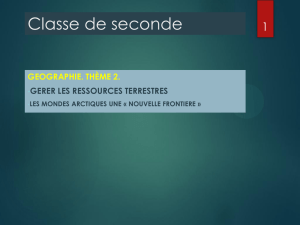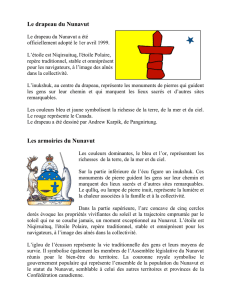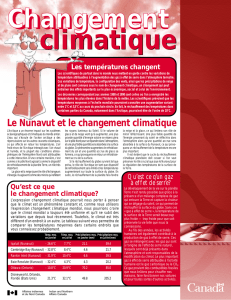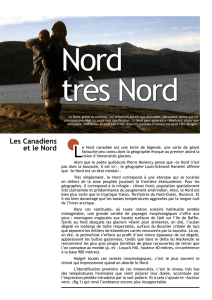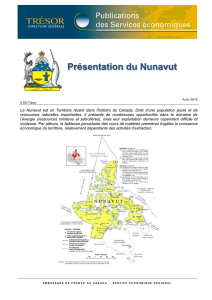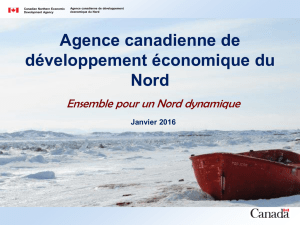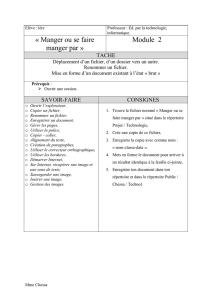Perspectives économiques Nunavut

Perspectives économiques Nunavut Mai 2001
Regard sur l’économie
du Nunavut
RENDEMENT ET TENDANCES ÉCONOMIQUES

Le Conference Board
du Canada
Le Conference Board du Canada est
l’organisme de recherche appliquée
sans but lucratif et indépendant le
plus avancé du pays. Il se donne pour
mission de développer le leadership dans le but
de contribuer à l’avancement du Canada en
aidant, par ses observations, à mieux comprendre
les tendances économiques, les grands dossiers
d’intérêt public et la performance des organisations.
Il crée aussi des liens et assure la diffusion de la
connaissance au moyen d’activités d’apprentissage,
de réseaux, de publications de recherche et de
services d’information taillés sur mesure. Un
large éventail d’organisations des secteurs public
et privé canadiens figurent parmi ses membres.
Créé en 1954, Le Conference Board du Canada
est affilié au Conference Board, Inc. qui dessert
quelque 3 000 sociétés réparties dans 67 pays.
Préambule
Cette étude a été rendue possible grâce à une subvention
du gouvernement du Nunavut, de la Nunavut Tunngavik
Inc. et du ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien. Conformément à ses politiques en matière
de recherche subventionnée, Le Conference Board
du Canada assume l’entière responsabilité de la
conception et de la méthode, ainsi que du contenu
du présent document.
L’étude a été réalisée par Graeme Clinton, Stephen Vail
et Peter Lok, chargés de recherche, sous la direction
de Luc Bussière, directeur des Services économiques.
©2002 Le Conference Board du Canada*
Imprimé au Canada • Tous droits réservés
ISBN 0-88763-531-8
*Constitué sous la raison sociale d’AERIC Inc.
Perspectives économiques Nunavut : Regard sur l’économie du Nunavut
par Stephen Vail et Graeme Clinton

TABLE DES MATIÈRES
Résumé......................................................................i
1 — Introduction ......................................................1
1.1 Historique ........................................................1
1.2 Objet de cette étude ..........................................3
1.3 Plan d’ensemble du rapport ................................3
2 — Approche générale ............................................5
2.1 Méthode ..........................................................6
3 — Processus de développement économique ..........7
3.1 Pourquoi parler de « développement »? ................7
3.2 Quatre éléments essentiels au développement ......7
3.3 Processus et conditions préalables au
développement économique......................................8
3.3.1 Accroissement des réserves de
capital physique..................................................8
3.3.2 Approche axée sur les changements
structurels..........................................................8
3.4 Développement durable ....................................10
3.5 Rôle de l’activité économique de subsistance ......10
3.5.1 Le pourquoi de la croissance économique ....10
3.5.2 Rôle de l'économie de subsistance
dans le développement ......................................11
4 — Regard sur le Nunavut : où en sommes-nous? ..13
4.1 Capital physique/infrastructure ........................14
4.1.1 Le logement..............................................14
4.1.2 Locaux commerciaux..................................15
4.1.3 Services de gestion et de traitement de
l’eau potable, des eaux usées et des déchets ........15
4.1.4 Transports : réseau routier, terrains
d’aviation, ports et navigation maritime ..............15
4.1.5 Télécommunications et connectivité............16
4.1.6 Services de garde et d’enseignement............17
4.1.7 Services de santé et services sociaux ..........17
4.2 Le capital humain ............................................18
4.2.1 Données démographiques ..........................18
4.2.2 Éducation et développement des
compétences ....................................................19
4.2.3 Revenu ....................................................20
4.2.4 État de santé ............................................21
4.3 Le capital naturel ............................................23
4.3.1 Science de la faune et des pêcheries............24
4.3.2 Sciences de la terre dans le secteur public ..24
4.4 Le capital social et organisationnel ....................25
4.4.1 L’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut (ARTN)..........................25
4.4.2 L’établissement du territoire du Nunavut......27
4.4.3 L’établissement du gouvernement
du Nunavut ......................................................27
4.4.4 Le rôle du Qaujimajatuqangit inuit..............28
4.4.5 Les secteurs clés du capital
organisationnel et social du Nunavut ..................28
5 — Aperçu de l’économie mixte du Nunavut ..........33
5.1 L’économie de subsistance et son rôle
dans l’économie mixte............................................33
5.1.1 Estimation de la taille de l’économie
de subsistance ..................................................35
5.2 Aperçu de l’économie basée sur
les salaires du Nunavut ..........................................36
5.2.1 Taux d’emploi ..........................................39
5.3 Analyse du rendement sectoriel du Nunavut
en 1999 (basé sur les salaires) ................................39
5.3.1 Chasse, pêche et piégeage ..........................40
5.3.2 Industrie minière ......................................42

5.3.3 Industrie manufacturière............................43
5.3.4 Industrie de la construction ......................45
5.3.5 Industries du commerce au détail et
de gros et des services aux entreprises ................45
5.3.6 Industrie de l’assurance et des finances ......45
5.3.7 Industrie des services gouvernementaux
et connexes ......................................................46
5.3.8 Industries du tourisme ..............................47
6 — Où va le Nunavut?............................................49
6.1 Le contexte planétaire......................................49
6.2 Perspectives canadiennes ..................................50
6.3 Perspectives du Nunavut ..................................51
6.3.1 Méthode ..................................................51
6.3.2 Population................................................52
6.3.3 Projets d’exploitation minière ....................52
6.3.4 Le développement de l’industrie
du tourisme ......................................................54
6.3.5 Le gouvernement ......................................54
6.3.6 L’expansion de l’économie traditionnelle ......56
6.3.7 Perspectives relatives aux pêches ................56
6.3.8 Risques inhérents aux prévisions ................57
6.4 Perspectives de croissance économique de
l’économie numéraire ............................................57
7 — L’avenir : à nous d’en décider ..........................59
7.1 Résumé des observations ..................................59
7.2 Questions essentielles à l’esquisse de l’avenir
économique du Nunavut ........................................60
7.2.1 Quelles sont les valeurs primordiales
des Nunavummiut? ............................................60
7.2.2 L’importance de mieux connaître
le Nunavut........................................................61
7.2.3 L’importance de l’éducation et du
développement des compétences ........................63
7.2.4 L’impact de l’ARTN sur le développement
économique ......................................................64
7.2.5 Le rôle du gouvernement fédéral ................65
7.2.6 La nécessité de collaborer ..........................65
7.2.7 La définition d’objectifs réalistes ................66
7.3 Conclusion ......................................................66

Résumé
Le Conference Board du Canada
i
Le 1er avril 1999, la création officielle du Nunavut venait
transformer à jamais le visage du Canada. Le Nunavut, dont
le nom signifie « notre terre » en inuktitut, est le fruit de
plus de trente années de planification et de négociations
de la part des Inuit de l’Est et de la région centrale de
l’Arctique canadien. L’Accord sur les revendications territo-
riales du Nunavut (ARTN), conclu en 1993, comportait un
accord politique régissant la création dudit territoire et la
reconnaissance du droit des Inuit à l’autodétermination.
C’est dans ce contexte que les Inuit, soit 85 p. 100 de
la population du territoire, ont opté pour un modèle
de gouvernement populaire autonome, représentant tous
les citoyens du Nunavut, qu’ils soient ou non inuits.
Le gouvernement du Nunavut, la Nunavut Tunngavik Inc.
ainsi que le ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien se sont engagés à appuyer conjointement le
développement durable du Nunavut et, d’un commun
accord, ont reconnu la nécessité d’étudier les perspectives
économiques du nouveau territoire pour mener à bien leur
tâche. Les services du Conference Board du Canada ont donc
été retenus pour qu’il examine l’état de l’économie mixte
actuelle du Nunavut (tant l’économie de subsistance1que
l’économie basée sur les salaires), et évalue les perspectives
économiques à long terme. Cette étude doit s’accompagner
de prévisions économiques sur une période de vingt ans et
d’une énumération des questions structurelles sous-jacentes
au rendement économique à long terme.
Pour cette étude, nous avons adopté une approche globale
en commençant par un aperçu théorique des conditions
nécessaires à la croissance économique dans le contexte
d’une économie de subsistance. La création de richesses,
ou croissance économique, repose sur quatre facteurs clés :
Le capital physique : désigne l’infrastructure nécessaire au
maintien de la production économique, soit les systèmes
de transport et de communication, les stocks de loge-
ments, les hôpitaux, etc.;
Le capital humain : comprend l’activité de la main-
d’œuvre, mais également, au sens plus large, les actifs
d’une société sur le plan de l’alphabétisation et de l’éduca-
tion, des compétences et des connaissances ainsi que
l’état de santé et le bien-être général de la population;
Le capital naturel : soit les matières premières à la base
de l’activité économique qui comprennent la terre, les
ressources fauniques, minérales ou énergétiques, les
fibres ainsi que le savoir dérivé de ce capital;
Le capital social et organisationnel : comprend le milieu
d’interaction des actifs naturels, humains et physiques
contribuant à la création des richesses. Ce capital réunit
les principaux secteurs et participants à la création des
richesses (le gouvernement, l’entreprise privée et les
organisations ou sociétés indépendantes), le cadre
d’élaboration des politiques, la sécurité publique ainsi
que la confiance entre les divers intervenants.
Pour atteindre leurs objectifs de développement et
répondre aux besoins grandissants en biens et services
d’une population qui ne cesse de croître et qui consomme
de plus en plus, les sociétés doivent veiller à leur crois-
sance économique, laquelle passe forcément par les
quatre facteurs mentionnés précédemment. Les systèmes
économiques traditionnels, dits de subsistance, ne peuvent
répondre seuls à l’augmentation de la demande de biens et
de services, produits de l’économie industrielle. L’activité
économique de subsistance peut néanmoins contribuer de
manière importante à l’économie générale et jouer un rôle
fondamental dans la vie sociale et culturelle d’une société.
L’économie de subsistance peut, par exemple, offrir un
moyen essentiel à la population en général, mais aux
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
1
/
80
100%